Défense et Diplomatie
Le coup d’État à Niamey, au Niger, a suscité des réactions antagonistes de la France et des États-Unis, et
enclenché une nouvelle ère. Réévaluant la compétence française sur le continent, Washington signifie
désormais à Paris que l’ère de l’interventionnisme « libéral » est terminée.
Maya Kandel – 16 septembre 2023
Six semaines après le coup d’État du 26 juillet au Niger, la situation politique à Niamey reste incertaine, mais
le putsch a révélé trois évolutions majeures : la fin d’une coopération franco-américaine privilégiée et inédite
en Afrique dans la lutte antiterroriste ; l’échec d’une stratégie antiterroriste qui s’est avérée contre-productive
aussi bien à court terme qu’à long terme, puisqu’il y a davantage de terrorisme et moins de démocratie ; enfin, les
États-Unis confirment, et signifient à la France, que l’ère de l’interventionnisme « libéral », pendant « de
gauche » du néoconservatisme, est terminée.
Le putsch de Niamey a cristallisé une évolution perceptible depuis quelque temps à Washington : la succession de
coups d’État en Afrique francophone (huit depuis 2020), le départ des soldats français du Mali à l’été 2022 et les
réactions de l’Élysée ont conduit à une réévaluation de la compétence française en Afrique, non pas sur le plan
militaire, mais sur le plan politique. Elle explique les réactions opposées des deux principaux acteurs extérieurs
du Sahel face au coup d’État au Niger.
La fin du meilleur domaine de la relation franco-américaine, la coopération dans la lutte antiterroriste
au Sahel
Les Français étudient un départ de leurs soldats, les Américains redéploient leurs troupes, quittant Niamey, où
leurs soldats sont stationnés près des Français, pour leur base d’Agadez, plus au nord. À Washington, une revue
stratégique devrait revoir plus largement le positionnement américain en Afrique de l’Ouest. C’est la fin d’une
parenthèse dans la relation franco-américaine en Afrique : la coopération militaire entre les deux pays dans la
lutte antiterroriste au Sahel était décrite ces dernières années comme le meilleur domaine de la relation
bilatérale.
Après le coup d’État du 26 juillet à Niamey, les deux acteurs extérieurs clés dans le pays, France et États-Unis, ont
en effet suivi deux approches radicalement différentes. Alors que la France avait embrassé la position de la
Cédéao (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest), qui menaçait d’une intervention militaire
pour libérer et restaurer le président Bazoum, les États-Unis ont d’emblée choisi l’approche diplomatique et
dépêché le 7 août à Niamey la numéro deux du département d’État, Victoria Nuland. Washington a même
maintenu l’envoi de sa nouvelle ambassadrice, arrivée mi-août à Niamey, même si elle n’est pas accréditée
puisque les autorités issues de la junte ne sont pas reconnues par les États-Unis. Ces initiatives ont été perçues
comme « des coups de poignard dans le dos » de Paris, comme l’expliquait un officiel français cité par Le Monde.
Rupture
Ces attitudes divergentes reflètent d’abord l’ampleur de l’investissement américain au Niger, devenu le cœur de
leur dispositif militaire en Afrique de l’Ouest, avec des soldats basés à Niamey et surtout à Agadez, tandis que la
CIA opère à Dirkou, une autre base révélée par le New York Times en 2018. Mais elles signalent surtout une
nouvelle rupture dans la relation franco-américaine, après l’affaire des sous-marins australiens, dans un contexte
de rejet de la politique française en Afrique, dont les Américains sont parfaitement conscients.
Le début du redéploiement des soldats américains vers Agadez confirme la fin d’une étroite et inédite
coopération militaire en Afrique, engagée depuis l’intervention française au Mali en 2013. Washington acte le
retrait français de la zone et la fin d’une posture où les États-Unis agissaient en soutien des Français, lesquels
opéraient en première ligne. Les États-Unis n’entendent pas pour l’instant quitter la zone, mais leur politique se
déploie désormais de manière autonome.
Au 6 septembre, le département d’État n’avait toujours pas désigné le coup d’État du 26 juillet comme tel,
désignation qui suspendrait automatiquement certains programmes d’aide et d’entraînement entre militaires. Le
délai est plutôt dû aux lourdeurs bureaucratiques américaines, et de nombreux programmes ont d’ores et déjà été
suspendus. Mais le dialogue est maintenu entre Américains et Nigériens.
Le Niger devrait cependant rejoindre le Mali, la Guinée et le Burkina, où des coups d’État ont renversé les
gouvernements, qui ne reçoivent plus d’aide militaire directe des États-Unis. Cela n’a toutefois pas empêché le
Burkina de participer à l’un des grands exercices conjoints organisés par le Pentagone en Afrique, Flintlock (qui
concerne les forces spéciales), en 2023.
Le Niger avait pris une importance croissante depuis 2013 dans le dispositif américain en Afrique pour
assurer le soutien aux opérations militaires françaises dans le Sahel
Il reste que le débat devrait être plus crucial dans le cas du Niger, en raison des deux bases américaines dans le
pays et des 1 500 soldats qui y sont stationnés, le plus important contingent en Afrique hors Djibouti, principale
base américaine sur le continent.
Le coup d’État pose pour les États-Unis des questions plus larges sur les priorités et les risques de leur dispositif
militaire au Niger, dont l’expansion à partir de 2013 répondait à la nécessité d’assurer à la France le soutien voté
par le Congrès. Le principal enjeu porte sur la base d’Agadez, et plus largement l’investissement de près de 500
millions de dollars depuis dix ans (dont 100 millions pour la base).
En mars 2023, lors d’une visite historique, la première d’un secrétaire d’État américain au Niger, Antony Blinken
avait évoqué un « partenaire clé », « modèle pour la transition démocratique », le Niger étant le premier pays pour
l’aide militaire américaine en Afrique de l’Ouest et le second pour l’ensemble de l’Afrique sub-saharienne. Le
Niger était devenu en quelques années non seulement le cœur du dispositif militaire américain pour l’Afrique de
l’Ouest, mais aussi un exemple de la priorité à la démocratie dans la politique étrangère de Biden.
Le soutien américain à l’intervention française, mis en œuvre par l’administration Obama non sans quelques
atermoiements de départ, avait fait évoluer la relation franco-américaine en Afrique, jusque-là empreinte de
méfiance, vers une étroite coopération militaire dans la lutte antiterroriste. Selon un schéma qui convenait aux
États-Unis, les Français étaient présents en première ligne, prenant tous les risques, tandis que les Américains
fournissaient surveillance, renseignement, et quelques capacités manquantes à l’armée française.
Il s’est ainsi passé huit ans d’exception dans la relation bilatérale en Afrique, mais aussi un moment où la
coopération militaire est devenue l’un des meilleurs domaines de la relation entre les deux pays. Aujourd’hui, la
grande question pour Washington est l’avenir de ce dispositif une fois les Français partis, alors que les États-Unis
n’ont pas d’intérêts stratégiques au Sahel et que leurs priorités se trouvent en Asie.
Une « fatigue de la France »
Les États-Unis se conçoivent toujours comme une superpuissance globale, ils ne vont donc pas quitter l’Afrique,
surtout dans le contexte international actuel de rivalité croissante avec la Chine et la Russie. La Chine commence
à se préoccuper de la sécurité de ses investissements en Afrique de l’Ouest, notamment au Niger, où elle construit
un oléoduc de 2 000 kilomètres (à 4 milliards d’euros), tandis que la Russie, par la voie de Wagner, poursuit ses
offres de garde prétorienne aux nouveaux putschistes de la région.
Dans la dernière audition au Congrès du commandant d’Africom, le commandement militaire pour l’Afrique, la
France a été évoquée, les parlementaires regrettant le repli français, à une douzaine de reprises, quand Chine et
Russie étaient évoquées environ 70 fois chacune. Même si certaines activités sont suspendues ou remises en
question, les États-Unis ne vont pas se retirer entièrement de la zone quand le département d’État reconnaîtra le
coup d’État : « Ne vous attendez pas à un retrait complet », déclarait récemment l’ex-commandant des forces
spéciales américaines au Niger.
Les situations en Libye et au Nigéria demeurent des préoccupations pour Washington, et le Niger reste ce « lieu
stratégique au carrefour de trois fronts terroristes dont les bases sont en Libye, au Mali et au Nigéria », selon les
termes d’Africom. Mais depuis plusieurs années déjà à Washington, on entendait les experts et acteurs Afrique
évoquer une « fatigue de la France » dans la région. Une forme de compétition s’était de fait installée au Niger.
Le putsch de l’été 2023 cristallise donc une nouvelle rupture dans la relation bilatérale franco-américaine. Mais il
illustre aussi les échecs de la stratégie antiterroriste commune aux deux pays, et la faiblesse du volet « bonne
gouvernance » de cette stratégie.
Les effets contre-productifs de 20 ans de contre-terrorisme : l’échec du « laboratoire africain »
Le service de recherche du Congrès estime que les États-Unis ont fourni plus de 6,5 milliards de dollars en
« assistance sécuritaire » aux partenaires africains pendant la dernière décennie, et que 90 % des pays reçoivent
des formations aux droits humains et aux principes tels que le contrôle civil du pouvoir militaire. S’agissant du
Sahel, le Niger était devenu le plus important récipiendaire d’aide, entraînement et équipements américains dans
la lutte contre le terrorisme, suivi de la Mauritanie et du Tchad.
Vingt-deux ans après les attentats de 2001, et dix ans après le début de la coopération franco-américaine, force est
de constater que la lutte contre le terrorisme centrée sur la coopération militaire a produit plus de terrorisme
tout en renforçant les armées au détriment des institutions civiles, et donc de la démocratie.
Pour mémoire, l’Afrique n’a jamais figuré parmi les priorités de la politique étrangère américaine, demeurant
dernière ou avant-dernière des priorités régionales. Du point de vue stratégique, on est passés depuis 30 ans du
désintérêt dans l’immédiat après-guerre froide à une focalisation sur la formation de troupes de maintien de la
paix sous Clinton après le génocide au Rwanda (1994), puis à un accent de plus en plus marqué sur la lutte
antiterroriste sous la présidence Bush, après les attentats du 11 septembre 2001. C’est en 2002 que les États-Unis
ouvrent ce qui reste leur principale base sur le continent, à Djibouti, à côté des Français et, désormais, des Chinois.
Ils décident également de créer le commandement militaire spécifique pour l’Afrique, Africom, en 2007.
En mettant l’accent sur la dimension sécuritaire et la coopération avec les
militaires, les États-Unis (et la France) ont contribué à renforcer les acteurs
militaires au détriment des institutions démocratiques.
La présence militaire américaine sur le continent est restée délibérément limitée, en raison du traumatisme de
Mogadiscio en 1993 : 18 rangers américains avaient trouvé la mort lors de l’opération « Restore Hope » lancée par
le président Bush père en août 1992 et poursuivie par Clinton, épisode raconté dans le film La Chute du faucon
noir. L’approche indirecte a dès lors toujours été privilégiée par Washington, à travers l’aide militaire, les exercices conjoints et des partenariats sur place, où d’autres forces sont en première ligne : dans le cas du Sahel, la France.
La présence militaire américaine sur le continent est restée aux environs de 6 000 soldats, 6 500 aujourd’hui.
Obama avait évoqué un « modèle africain » de lutte contre le terrorisme, alors que les groupes terroristes se
multipliaient en Afrique (quatre identifiés par le département d’État en 2012, seize en 2018) : le continent était
présenté comme un laboratoire de la nouvelle approche américaine de lutte contre le terrorisme, caractérisée par
une « empreinte légère » sur le terrain et le recours aux drones, principalement de surveillance, parfois armés.
Cette approche a eu les conséquences contre-productives actuelles, annoncées depuis des années : en mettant
l’accent en premier lieu sur la dimension sécuritaire et la coopération avec les forces militaires, les États-Unis (et
la France) ont contribué à renforcer les acteurs militaires au détriment des institutions démocratiques. Ce n’est
évidemment pas le seul facteur derrière la désaffection des opinions et les soutiens exprimés aux putschistes. Il
reste que dix ans d’investissements croissants au Sahel ont vu une augmentation des groupes terroristes, des
victimes, et une chute des gouvernements démocratiques, remplacés par des juntes militaires.
L’implication de militaires formés par les États-Unis dans plusieurs coups d’État récents et la nouvelle
fronde des isolationnistes au Congrès
Parmi les acteurs de cette « épidémie de coups d’État » dont parle le président Macron, se trouvent nombre de
militaires africains ayant bénéficié de programmes de formation américains. Les parlementaires américains se
sont déjà emparés du débat, car le Niger n’est que le dernier de la série. Quand Victoria Nuland s’est rendue à
Niamey le 7 août, elle s’est entretenue avec le général Barmou, que les militaires américains connaissent bien : un
mois avant le putsch, il rencontrait le commandant des opérations spéciales américaines sur la base d’Agadez.
Le journaliste américain Nick Turse a relevé « au moins 15 officiers militaires ayant bénéficié de programmes de
formations américains » parmi les putschistes de 12 coups d’État récents dans la région : sont concernés le
Burkina, le Tchad, la Gambie, la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Niger. Dans le cas du Niger, au moins cinq
militaires impliqués dans le putsch du 26 juillet ont bénéficié de « formations des armées partenaires ». Le général
Joseph Votel, ancien commandant des forces spéciales américaines en Afrique de 2014 à 2016, exprimait
récemment sa « grande déception ».
C’est précisément là-dessus que le républicain Matt Gaetz, élu de Floride et membre du groupe d’extrême droite
Freedom Caucus à la Chambre, avait déjà interpellé le commandant d’Africom en avril dernier, lors de la requête
budgétaire annuelle, l’apostrophant sur ces putschistes « formés » aux frais des contribuables américains.
Quelques semaines plus tard, il s’alliait à des élus d’extrême gauche pour réclamer le départ des États-Unis de
Somalie. Début septembre, c’est le sénateur Rand Paul, l’un des chefs de file isolationnistes au Sénat, qui déposait
un projet de loi exigeant le retrait de tous les militaires américains présents au Niger depuis 2013.
Quelle que soit l’évolution des débats à Washington, le putsch au Niger marque la fin d’une parenthèse
franco-américaine en Afrique.
En refusant d’intervenir, alors que la France semblait caresser l’option d’un rétablissement par la force du
président nigérien, l’administration Biden rappelle à Paris que l’ère de l’interventionnisme libéral, la version
démocrate du néoconservatisme du Parti républicain pré-Trump, est morte. Mais la faillite du « modèle de
résilience et de démocratie » nigérien célébré par Blinken il y a moins de six mois à Niamey est aussi l’échec d’une
approche politique commune aux deux pays.
Maya Kandel
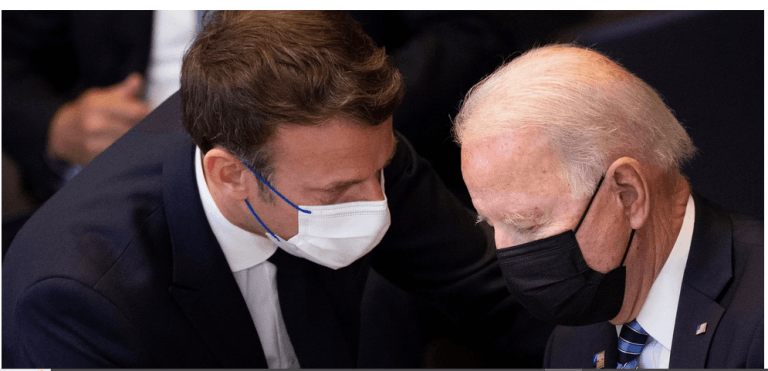

Commentaires Facebook