Par Connectionivoirienne | Sylvie Kouamé
En Côte-d’Ivoire, le débat sur la constitutionnalité d’un nouveau mandat (le 3e) présidentiel du Chef de l’état sortant Alassane Ouattara est relancé suite au décès «prévisible» du grand malade Amadou Gon, et les appels de pieds des militants du RDHP pour une nouvelle candidature d’Alassane Ouattara.
À l’occasion, un texte du professeur en Droit constitutionnel Bléou Martin, ancien ministre de la Sécurité, publié en 2018 a été réchauffé, et remis au goût du jour par les contestataires d’un nouveau mandat du champion des Républicains.
Ce débat aussi vieux que le rétablissement des démocraties en Afrique au début de la dernière décennie du siècle dernier, n’est pas unique à la Côte-d’Ivoire. En effet, dans une tribune publiée en 2017, Issaka K. Souaré revenait en long et en large sur la question de la limitation des mandats en Afrique.
Dans cette phase de ce débat excitant, nous faisons volontairement omission des cas sous d’autres contrées de Vladimir Poutine, président de la fédération de Russie (par intérim de 1999 à 2000, et de plein exercice de 2000 à 2008 et depuis 2012, ou encore d’Angela Merkel, chancelière de l’Allemagne depuis 2005.
Bonne lecture
Pourquoi la limitation des mandats présidentiels est utile dans l’Afrique d’aujourd’hui
Par Issaka K. Souaré publié le 16 decembre 2017 dans Jeune-Afrique
La disposition de limitation du nombre des mandats présidentiels était une des mesures phares des nouvelles constitutions de la majorité des pays africains au début des années 1990.
Tribune. Aujourd’hui, sur les 55 États membres de l’Union africaine, 35 pays disposent encore de cette clause, alors que six pays (Togo, décembre 2002 ; Gabon, juillet 2003 ; Tchad, mai 2005 ; Cameroun, avril 2008 ; Ouganda, septembre 2008 ; Djibouti, avril 2010) l’ont supprimée.
Les leaders du Congo-Brazzaville (octobre 2015) et du Rwanda (décembre 2015) l’ont fait modifier sans la supprimer, en apportant d’autres modifications à la constitution pour ainsi arguer qu’on commençait un nouvel ordre politique, nécessitant la remise des compteurs à zéro. Abdoulaye Wade au Sénégal (2012) et Pierre Nkurunziza au Burundi (2015) ont simplement réinterprété le point de commencement du compteur, prenant pour premier ce que leurs détracteurs ont considéré comme leur second mandat. Lansana Conté de la Guinée, Zine el-Abidine Ben Ali de la Tunisie, Mamadou Tandja du Niger et Abdelaziz Bouteflika de l’Algérie avaient aboli la disposition avant que leurs successeurs ou eux-mêmes (Algérie) ne la rétablissent.
Les 12 autres pays (Érythrée, Éthiopie, Gambie, Guinée-Éq., Lesotho, Libye, Maroc, Maurice, RASD, Somalie, Soudan du Sud et Swaziland) n’ont jamais eu cette disposition dans leur Constitution. Il sied, cependant, de noter que les nouvelles autorités à Banjul promettent de l’établir très prochainement.
Deux camps s’affrontent dans un débat à propos du bien-fondé ou non de cette disposition : ceux qui s’y opposent et ceux qui chantent ses avantages.
Pour les disciples des mandats illimités, l’on soutient, d’abord, que les textes juridiques, comme les constitutions, doivent se prêter aux amendements périodiques, car ils sont le reflet de contextes spécifiques de la vie des sociétés, lesquels contextes changent et les lois doivent s’adapter aux nouvelles réalités. On argue ensuite que la disposition limitative des mandats est « non démocratique », car elle priverait des citoyens de l’opportunité de garder des leaders « performants ». Ils avancent, enfin, que plusieurs vielles démocraties occidentales, comme la Grande-Bretagne et l’Allemagne, n’ont pas de telles dispositions dans leurs constitutions, et personne ne leur met la pression pour l’y introduire.
Les partisans du principe de limitation des mandats en Afrique d’aujourd’hui, dont fait partie l’auteur de ces lignes, tout en reconnaissant le droit des sociétés à adapter leurs textes juridiques aux contextes dynamiques, tentent de contrer ces arguments dans le cas d’espèce. D’abord, l’on soutient que la gestion d’un pays n’est pas l’affaire d’un seul homme. Si un leader n’a pas pu convaincre ou partager sa vision ne serait-ce qu’avec quelques membres de son entourage direct pour s’assurer de sa survie sans et/ou après lui, alors ce leader a peut-être échoué sa mission, car il n’a aucune promesse de Dieu (ou du destin) qu’il sera préservé pour tout le temps qu’il estime nécessaire pour mettre en œuvre « sa vision ».
L’on argue, ensuite, que presque tous les leaders africains ayant supprimé ou amendé cette disposition l’ont fait après avoir passé plusieurs années à la tête de leur pays, et certains, de surcroît, n’ont aucun bilan positif à défendre. Quoi de neuf pensent-ils encore prouver, se demande-t-on ? Un troisième argument est de dire que la plupart des pays africains étant encore « démocratisant », l’on a besoin d’une telle disposition jusqu’à ce que la démocratie s’enracine et que l’on soit sûr que les processus électoraux sont aussi transparents et sincères qu’ils le sont généralement dans les pays occidentaux suscités.
Il s’agit d’un moyen important de faciliter l’alternance au pouvoir sur le continent. Et pour le chef d’État de quitter le pouvoir avec les honneurs.
Constatons aussi que dans les pays dont les leaders ont aboli ou modifié cette disposition, certains sont morts au pouvoir (Eyadéma, Conté et Bongo), alors que d’autres (Tandja et Ben Ali) ont été contraints de le quitter en disgrâce. Tout ceci prouve qu’il s’agit d’un moyen important de faciliter l’alternance au pouvoir sur le continent, ne serait-ce qu’au sein du parti au pouvoir.
Son respect est aussi, de nos jours, un moyen de quitter le pouvoir avec les honneurs. Ainsi, 21 leaders ont sagement quitté le pouvoir dans 14 pays africains grâce à cette disposition depuis 1990. J’en ai côtoyé quelques-uns. Ceux-ci ont compris et réalisent aujourd’hui qu’il peut y avoir une vie dorée après la présidence.
Il faut admettre cependant que l’alternance peut s’effectuer avec ou sans une telle disposition, au cas où un leader penserait que faire sauter cette disposition le prémunirait contre les affres des urnes. Le fait qu’au moins 26 chefs d’État sortants ont été battus aux élections par des candidats de l’opposition depuis 1990 illustre bien ce constat. Les plus récents de ces cas incluent ceux de Jammeh en Gambie et de Mahama John Dramani au Ghana (décembre 2016), de Jonathan au Nigeria (mars 2015), de Marzouki en Tunisie (décembre 2014), de Joyce Banda au Malawi (mai 2014), de Abdoulaye Wade au Sénégal (avril 2012), et de Rupiah Banda en Zambie (septembre 2011).



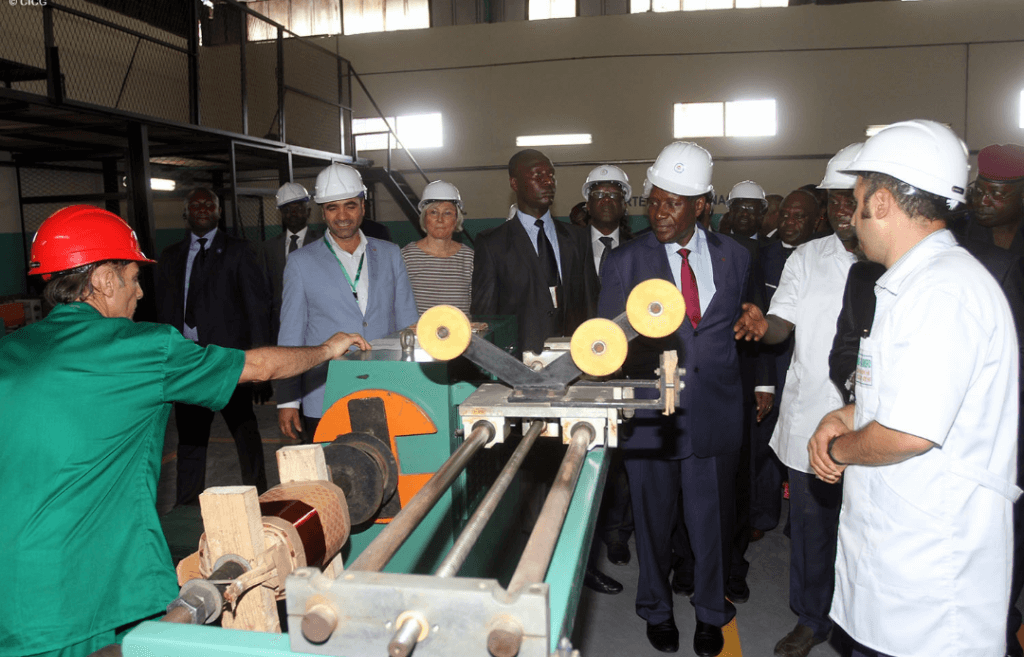



Commentaires Facebook