Par Pierre Soumarey
La facilité déconcertante avec laquelle a resurgi le débat sur l’éligibilité à l’élection présidentielle dans les médias, à la circonstance de la démission du Président du Conseil Constitutionnel, démontre, si besoin était, que la conflictualité politique de la société Ivoirienne se trouve à la fois, concentrée et codifiée dans la Constitution. L’expérience traumatique de la dernière élection de 2010, a introduit dans la conscience nationale, la problématique de son application exacte et de la qualité des décisions qui peuvent en découler, renforçant ainsi, la focalisation sur son intérêt politique, plutôt que juridique. La démission du Professeur Wodié à la tête de l’institution, a libéré par le caractère brutal et inattendu de celle-ci, des inquiétudes et des doutes, sur les intentions supposées ou réelles du pouvoir, et sur la capacité de l’Institution à dire désormais, en toute indépendance et impartialité, le droit. Ce procès d’intention traduit un déficit de confiance à l’égard de l’État et une demande sociale, quant au respect de la lettre et de l’esprit de la volonté populaire, contenue dans la Loi fondamentale. Cette situation convoque le Conseil Constitutionnel, pour l’interroger sur l’application de cette dernière dans le contexte actuel, en raison des évolutions intervenues depuis les élections de 2000, afin de faire taire ces appréhensions dans l’opinion publique. Justifiées ou pas, elles participent au climat électoral actuel, et à ce titre, elle doivent trouver des réponses adéquates, afin d’éviter que d’autres, nous en proposent de fausses, par intérêts politiques et stratégiques, avec un impact négatif sur ce climat, déjà délicat. Les questions purement techniques, relatives aux concepts, règles et procédures, sont une affaire de spécialité. Aussi, il convient de les laisser aux spécialistes du droit constitutionnel (théoriciens et professionnels), pour nous intéresser uniquement qu’à sa philosophie générale, son histoire locale, et ses mécanismes d’application dans le cas de l’élection Ivoirienne. Notre analyse bien que superficielle, pointe de manière critique, ses faiblesses, pour bien indiquer, que la Constitution dans sa configuration actuelle (inféodation à des intérêts politiques), n’offre pas de solutions totalement satisfaisantes, aux préoccupations, légitimes ou surdimensionnées, de la communauté nationale, parce que trop complexes. Néanmoins, ces difficultés peuvent être résolues, avec des solutions plus fluides, si nous acceptons d’ouvrir des pistes simples et novatrices en son sein, sous le sceau, de la seule logique.
1- De l’état de la Constitution actuelle à l’état de la question de l’éligibilité, au visa de l’article 35, en sa partie relative à la nationalité
On oublie un peu facilement que la Constitution pour fondatrice qu‘elle soit, est d’abord un acte politique, avant d’être un acte juridique, et qu’en Côte d’Ivoire la primauté donnée au politique dans son élaboration, a rompu ce nécessaire équilibre. Cette perversion a permis de dénaturer son objet, en recherchant auprès d’elle, de manière sélective, une qualification très particulière, pour autoriser un citoyen à représenter le peuple à la magistrature suprême de l’État, alors que l’élection a ordinairement pour finalité, de confier au peuple souverain, et à lui seul, le pouvoir de désigner librement ses représentants : «Le peuple exerce sa souveraineté par la voie du référendum et par ses représentants élus… » (Art. 32). C’est une régression démocratique que de lui retirer ce pouvoir et cette liberté, en réduisant le périmètre de son choix. La volonté des autorités constituantes, s’est substituée à la volonté constituée du peuple, car il existe un décalage manifeste, entre la volonté populaire, exprimée à travers le référendum, qui a adopté la Constitution de 2000, et l’écriture de celle-ci, qui arroge au politique, la maîtrise du mécanisme d’accession au pouvoir, en dépouillant son mandant (le peuple), de la prérogative de sa souveraineté, sans lui avoir expliqué au préalable, cette conséquence fâcheuse. Cette « judiciarisation de la politique », nous confirme, que l’histoire politique précède toujours la Constitution, et que celle-ci est, en quelque sorte, son reflet. Or, l’histoire récente de la Côte d’Ivoire est tumultueuse et très conflictuelle. Aussi, c’est tout naturellement, suivant ce principe, que nous la retrouvons dans la Constitution, comme le passif d’un héritage. Cette curieuse façon de transférer au droit notre conflictualité, par facilité et sécurité, non seulement déplace le problème et le prolonge sur un autre plan, mais hypothèque aussi la marge d’action du juge constitutionnel. Vouloir ensuite, demander à celui-ci, de régler un conflit politique, que les politiques eux-mêmes, ont échoué à solutionner de manière satisfaisante et durable, est tout simplement hypocrite. Tous les juristes et la classe politique en son entier, en conviennent et reconnaissent cette instrumentalisation du droit dans notre pays. Ce fait étant acquis, il n’est pas utile de s’y attarder. Il suffit pour nous en convaincre, de nous rappeler le boycotte actif de 1995 (FPI, PIT, RDR) et les termes des Accords de Linas-Marcoussis, qui dénonce l’utilisation de concepts dépourvus de toute valeur juridique, comme la notion « d’origine » qui y figure en bonne place. Aussi et dès lors, que la Constitution de 2000, qui a transposé en son sein, les dispositions litigieuses de l’article 56 du Code électoral de 1994, en accentuant son caractère discriminatoire, demeure en l’état, les reproches qui lui étaient naguère adressés, restent inchangés. Les motifs n’ont pas disparus par enchantement. La date de signature de ce protocole d’accord, ne comporte en lui-même rien d’exceptionnel, pour qu’on s’y attache. Ce qui l’est, est le fait d’accepter, nonobstant cet obstacle majeur, d’aller à des élections en l’absence de l’indispensable réforme de l’outil constitutionnel, qui doit servir lesdites élections. Aussi, de ce point de vue, nous sommes toujours dans une exceptionnalité, caractérisée par l’inadéquation d’un texte à l’évolution de la réalité sociopolitique, qu’il est réputé encadrer. Il s’en suit, par raisonnement analogique, qu’une mesure d’exception peut être valablement envisagée, au visa de l’article 48 (parallélisme avec le passé), sans toutefois préjuger de son contenu et de sa licéité. En effet, nous sommes mécaniquement passés d’une crise politique à une crise constitutionnelle, tout au moins apparente (blocage), puisque nous avons transporté notre conflit politique dans le droit, sans véritablement le résoudre entièrement. Nous observons que si l’article 48, donnait réellement le pouvoir de modifier la Constitution, sans passer par le Référendum, pourquoi alors, ne pas avoir tout simplement modifié l’article incriminé, plutôt que d’autoriser une dérogation partielle temporaire à son application, qui laisse persister cette tension ? A-t-on voulu suspendre pour un temps limité, les effets de cet article, comme une sorte de parenthèse dans notre histoire politique et institutionnelle, plutôt que de réellement le modifier ? Pour quels motifs et dans quel but ? Contrainte juridique, souci de forme, ou volonté ? Au total, la philosophie et les intentions de cet article demeurent inchangées à ce jour.
Pour dire un mot, sur la justification du reproche unanimement adressé à l’article 35, il convient de rappeler que l’objet d’une constitution dans une démocratie, ne se limite pas à fixer les règles qui organisent le fonctionnement de l’État et les relations entres ses organes, ou entre l’État et la Nation. Il vise aussi, et principalement, à protéger les libertés et les droits individuels et collectifs des citoyens, contre les abus et les dérives des gouvernants, comme ceux qui nous occupent, et à assurer au peuple, l’exercice effectif de sa souveraineté. L’instrumentalisation politique de la Constitution est une perversion, dès lors qu’elle déroge à ce objectif. La conquête du pouvoir s’effectue à travers une compétition ouverte et équitable entre les partis et les candidats, et non à travers le détournement de la légitimité du suffrage, sous le couvert de l’autorité du droit. Plus concrètement, une élection se gagne dans les urnes et non au Conseil Constitutionnel, par le suffrage du peuple souverain, et non par « l’onction » de celui-ci. Ce serait instituer « une dictature constitutionnelle » que de donner force de loi, à la volonté politique d’un pouvoir ou à des intérêts particuliers. L’élection est une institution qui assure la permanence du référendum populaire, en tant que consultation directe du peuple. C’est par elle, que le peuple, exprime à travers un processus continu, sans cesse renouvelé, sa volonté souveraine, quant aux représentants et gouvernants qu’il se choisit librement, tout au long de son histoire. « La souveraineté appartient au peuple. Aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s’en attribuer l’exercice.» (Art. 31). Rien ne peut s’opposer à cette souveraineté, ou entraver cet exercice démocratique, ou encore restreindre cette liberté fondamentale du citoyen, des partis et du peule. C’est cette réalité, par opposition à la construction abstraite d’une fiction juridique, qui permet précisément d’exprimer, le caractère démocratique d’un régime, d’une société, en ce sens, qu’elle permet d’avoir un « gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple ». Le politique n’a pas à se réfugier sous le manteau du droit. Ce n’est pas sa place, et nous en mesurons les effets par l’expérience.
Après ces observations sur le déficit démocratique, découlant des dispositions de l’article 35, en sa partie relative à la nationalité, il convient de pointer également les incohérences et contradictions internes des textes de l’arsenal de notre appareil électoral. Ceux-ci posent un sérieux problème de constitutionalité, dans certaines de leurs dispositions. Ce conflit apparaît d’emblée entre l’article 2 de la Constitution, qui pose en son alinéa 2, le principe rigoureux et inflexible de l’égalité des citoyens devant la Loi, qui exclut de fait, toute discrimination entre les citoyens « Tous les êtres humains naissent libres et égaux devant la loi. … », et les dispositions de l’article 35 de la même Constitution, imposant une distinction entre les nationaux, sur la base de l’histoire, qui en délaissant sa dimension dynamique, opère de fait, une catégorisation entre eux. Les uns étant éligibles suivant qu’ils sont nés de père et de mère Ivoiriens (droit du sang), les autres pas, suivant qu’ils ont acquis la nationalité par l’un des parents (filiation) ou par attribution (naturalisation : droit du sol). Cette contradiction l’est d’autant plus encore, que l’alinéa 2 de l’article 30 de la même Constitution, dispose que la République « assure à tous, l’égalité devant la loi, sans distinction d’origine …». Le second conflit apparaît à partir de l’article 48 du Code électoral qui pose, que « tout Ivoirien qui a la qualité d’électeur peut être élu Président de la République… ». Manifestement, cette disposition lie la condition d’éligibilité à la possession de la qualité d’électeur » (Commentaire de Vincent N’GBESSO de la Décision N°CI-2009-EP/028/19-11/CC/SG du 19 Novembre 2009 du Conseil Constitutionnel Ivoirien). Or, au visa de l’article 3, alinéa 1er du même Code « Sont électeurs les nationaux ivoiriens des deux sexes et les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne, soit par naturalisation, soit par mariage, âgés de 18 ans accomplis, inscrit sur une liste électorale, jouissant de leurs droits civils et civiques et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévus par la loi ». Dès lors, les conditions d’éligibilité édictées par la Constitution, qui y ajoute des dispositions plus restrictives ne sont plus en adéquation avec celles du Code électoral. Même si la théorie de la hiérarchie des normes place les prescriptions de l’article 35 au dessus de celles du Code électoral, il ne demeure pas moins qu’en se heurtant à la Loi fondamentale, ces dernières perdent leur légitimité, faute de conformité. Preuve que le contrôle de constitutionalité n’a pas pu s’exercer, sur l’ensemble des lois (droit électoral, droit de la nationalité, ..) participant à la construction de notre système électoral, qui devrait être théoriquement, l’émanation de la Constitution, auprès de laquelle ces différentes branches du droit, puisent leur source, pour en traduire l’expression. Dès lors, l’édifice ne devrait pas souffrir d’incohérences, voire de contradictions flagrantes, entre les différentes branches de droit, sur lesquelles il s’appuie, pour conduire des élections crédibles.
2 – Les dispositions de l’article 35, en sa partie relative à la nationalité sont inopérantes
a) l’inapplicabilité : Le Professeur Wodié (Ancien Président du Conseil Constitutionnel) et au tard, M. Tia Koné (Ancien Président de la Cour Suprême) ont tous deux reconnu l’impossibilité d’établir par un acte juridique, la possession de la nationalité Ivoirienne, avant l’existence même de l’Etat Ivoirien, dont la naissance date de 1960, soit une histoire de 55 ans, en l’an 2015. Cette durée, rapprochée à la limite plancher de l’âge requis pour l’éligibilité à la Présidence de la République, soit 40 ans, implique d’avoir des pères et mères Ivoiriens, ayant conçu leur enfant à un âge inférieur à 15 ans. Voyez l’usage en la matière. Pour la limite supérieure, soit 75 ans, il n’est tout simplement pas possible d’avoir des parents Ivoiriens nés après 1960, sauf à être plus âgé qu’eux.
b) La jurisprudence du Conseil Constitutionnel avec le cas du Sieur Adama DALO, surnommé Dahico
Par décision N° CI-2009-EP/028/19-11/CC/SG intervenue le 19 Novembre 2009, le Conseil Constitutionnel a accordé le bénéfice de l’éligibilité à l’intéressé, en méconnaissance flagrante des exigences posées par l’article 35, qui établissent pourtant très clairement, que la candidature à l’élection présidentielle est strictement réservée aux Ivoiriens d’origine, puisqu’elles prescrivent que le candidat « doit être ivoirien d’origine, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d’origine », alors que le concerné, a acquis la nationalité Ivoirienne par naturalisation. Il s’en suit qu’il n’est pas Ivoirien d’origine, et que ses parents étant Maliens, ne le sont pas eux-mêmes non plus. La conséquence logique de cet état civil, est qu’il s’est nécessairement prévalu d’une autre nationalité, avant d’être naturalisé. Cette décision qui n’a fait l’objet d’aucune réclamation contentieuse, de la part des candidats et des partis politiques en compétition, ni provoqué l’ire des populations, est définitive, et revêt l’autorité de la chose jugée. Cette jurisprudence élimine de fait, toute discrimination dans l’éligibilité aux élections présidentielle futures, et démontre l’extrême politisation du système et de la population. Était-ce réellement l’intention cachée du Conseil Constitutionnel ? On est autorisé à le penser, au vu de ses motivations, qui se limitent à justifier uniquement la levée des incapacités qui frappaient ce dernier, aux termes du Code de la Nationalité, en son article 43-1, relatif à sa qualité d’électeur. En effet, 5 années sont nécessaires, à compter du Décret de naturalisation, pour l’acquérir, et 10 années, pour la possibilité d’être « investi de fonctions ou de mandats électifs pour l’exercice desquels la qualité d’ivoirien est nécessaire ». Il apparaît ainsi, que le Conseil Constitutionnel a lié exclusivement l’éligibilité à la qualité d’électeur. Nous observons à nouveau, un conflit interne entre les textes, puisqu’aucune restriction n’est prescrite, pour le mandat électif à la fonction présidentielle, aux termes du Code Électoral. En statuant ainsi, le Conseil Constitutionnel confirme pleinement cette lecture.
Si telle était son intention, cette audace a un énorme mérite, car l’analyse de ses décisions dans la configuration des autres candidatures, démontre avec constance, une réelle volonté, de ne pas rompre le principe d’égalité des candidats (réflexe de juriste, déformation professionnelle ?). En effet, même en présence de la Décision Présidentielle N°2005-01/PR du 5 mai 2005 relative à la désignation, à titre exceptionnel, des candidats à l’élection présidentielle d’octobre 2005, prise sur le fondement de l’article 48, alors que celle-ci prescrivait en son Article 1er, que les candidats issus des partis signataires des Accords de Linas-Marcoussis étaient dispensés, à la différence des autres candidats, de la productions des actes administratifs et juridiques requis pour le contrôle et la validation de leur éligibilité, le Conseil Constitutionnel, les a néanmoins réclamé, et a déclaré par la suite, après examen de ces éléments, les candidats concernés, parfaitement éligibles. Puisque d’une part, « … les candidats présentés par les partis politiques signataires de l’accord de Linas-Marcoussis sont éligibles… ». Ceci entend qu’ils le sont d’entrée et de facto, sans aucune condition et sans qu’il ne soit besoin d’un contrôle de conformité, puisqu’ils sont d’ores et déjà réputés éligibles ; et que d’autre part, « Considérant qu’en application des textes en vigueur et par décision n° CI-2009-EP-026/28-10/CC/SG, le Conseil constitutionnel a arrêté la liste des pièces exigibles des candidats à l’élection présidentielle comme suit: …Que par la même décision, le Conseil constitutionnel a publié la liste provisoire des candidats, et invité ceux-ci, à compléter leur dossier au plus tard le mardi 10 novembre 2009 à 16 heures », il résulte, que ladite décision ne revêt aucun caractère exceptionnel. Celle-ci étant manifestement prononcée sur la base des conditions générales de contrôle d’éligibilité, « normales » et communes à tous les candidats, il convient de la considérer également et pleinement, comme une jurisprudence.
Aurait-il voulu juger implicitement la décision présidentielle évoquée, comme étant nulle, et de nul effet (illégale suivant le mot du Professeur Mamadou Koulibaly), qu’il ne saurait mieux s’y prendre, car en effet l’article 48, prévoit une concentration des pouvoirs (exécutif, judiciaire et législatif), par opposition au principe de la séparation des pouvoirs, et non une extension de ceux-ci, qui aurait pour effet de les placer au-dessus de la souveraineté du peuple, qui était le seul à pouvoir valider ou invalider ladite décision, par la voie référendaire, car en dernier ressort, comme nous l’avons souligné précédemment, « La souveraineté appartient au peuple… » (Art. 31, Al 1). Le strict respect de l’esprit et de la lettre de la Constitution, ne permettait à « … Aucune section du peuple, ni aucun individu… » quel que soit son rang (Président de la République ou Conseil Constitutionnel) de modifier les dispositions relatives à l’élection du Président de la République. En effet, « Est obligatoirement soumis au référendum le projet ou la proposition de révision ayant pour objet l’élection du Président de la République, l’exercice du mandat présidentiel, la vacance de la Présidence de la République et la procédure de révision de la présente Constitution. » (Art. 126, Al.2). Certains parlent de dérive présidentialiste (Cf. Stéphane Bollé ou le Président Mamadou Koulibaly). Par ailleurs, un acte ou une procédure sont réputés entiers, ils ne sauraient être partiels, valable pour les uns, et pas pour les autres. Ce vice entache l’acte de nullité relative. Était-ce l’appréciation du juge, sans le dire, puisqu’il n’a tenu aucun compte dudit acte.
Il est remarquable également que ladite décision, mentionnait expressément et de manière restrictive, sa validité « A titre exceptionnel et uniquement pour l’élection présidentielle d’octobre 2005, … » (Art. 1, Déc. N N°2005-01/PR du 5 mai 2005). Du fait de cette limitation expresse, celle-ci ne pouvait plus s’appliquer aux élections de 2010, au regard de la caducité qui la frappe. La nullité absolue de l’acte s’opère ici, de plein droit, du fait de la disparition de la date exclusive et impérative à laquelle la Décision était attachée. Le Professeur Mamadou Koulibaly qui soutient la même analyse, ajoute que celle-ci aurait dû être renouvelée, en vertu de son caractère ponctuel et dérogatoire. Pour être tout à fait complet, j’aurais dit, sous réserve de licéité. Cet ensemble de faits, a pour conséquence immédiate, de donner portée générale, aux délibérations du Conseil Constitutionnel, ayant prononcé l’éligibilité des candidats à l’élection présidentielle de 2010, sur la base des dispositions antérieures, autres que le dispositif de la Décision querellée. Cet axe d’analyse renforce dans le même sens, et de plus fort, la jurisprudence précédente. En conclusion, notre Conseil Constitutionnel en développant une doctrine jurisprudentielle contraire au formalisme d’une volonté politique au service des intérêts des pouvoirs successifs, a réussi, volontairement ou involontairement, la prouesse de débarrasser définitivement notre Loi fondamentale de la politique. Ceci constitue une avancée notable vers « la construction d’un État de droit démocratique pluraliste », tout en inaugurant le risque d’une nouvelle crise constitutionnelle, sauf à confirmer en 2015, cette jurisprudence. Ainsi, il n’y aurait rien à faire, dans l’attente d’une révision formelle.
2 – Le Débat sur l’éligibilité, en sa partie relative à la nationalité, est dans le contexte actuel, pernicieux
a) Au plan de la morale publique et du devoir civique :
Dans une interview, qu’il accordait, en sa qualité de Président du Conseil Constitutionnel, à un quotidien local, le Professeur Wodié, a fermement invité, avec raison, les journalistes à ne pas réintroduire, la politique dans le Droit. Non seulement la perspective d’un tel débat défie l’entendement, du fait qu’il dissimule un questionnement sur la déclaration de candidature du Président de la République en exercice, à sa propre succession (comment justifier ou expliquer cette singularité unique au monde), mais surtout, parce qu’il fait écho à un lourd contentieux politico-juridique qui nous a entrainé dans une profonde crise socio-politique, dont nous nous relevons à peine. Après tous les efforts et sacrifices consentis pour sortir de cette crise, tant par l’opposition que par la majorité, d’hier et d’aujourd’hui, nous ne pouvons pas nous permettre de la faire resurgir, sous la forme d’une crise constitutionnelle. De ce seul chef, nous avons l’obligation de tirer tous les enseignements de cette expérience. Nous avons en effet, l’obligation de nous interroger constamment sur la finalité et les conséquences de nos actes (dires, écrits, actions) dans l’environnement électoral actuel, pour que celui-ci soit apaisé et serein, en dépit des difficultés qui subsistent ici et là, notamment dans le délicat chantier de la réconciliation nationale. Le Professeur Ibrahima Baba Kaké, disait qu’un peuple qui perd la mémoire de ses éditions antérieures, est le signe d’une société malade. Les spécialistes parlent d’amnésie rétrograde de forme pathologique, lorsqu’il s’agit d’individus.
b) Au plan strictement juridique :
Le rejet de la candidature du candidat Alassane Dramane Ouattara par la Cour Suprême (CS, Chbre C., Arrêt N°E 0001-2000 du 06/10/2000), au motif que son certificat de nationalité ivoirienne présentait « un doute sérieux », est une appréciation fondée sur une interprétation, et non sur le droit formel en vigueur. « Cette pratique vise à faire dire au texte constitutionnel ce que l’on souhaite qu’il dise… » (Eveline RODRIGUES PEREIRA BASTOS, « Conditions d’éligibilité du président de la république et démocratie en Afrique subsaharienne »). Par ailleurs, cette décision outrepasse les limites de la compétence de la Chambre Constitutionnelle, car celle-ci avait une compétence attributive, qui exclut de son champ, le contrôle des actes administratifs, réservée à la Chambre Administrative, bien que rien n’empêche la première, de procéder à ses propres investigations si émerge en elle, un doute raisonnable à propos d’un acte. Sa décision située au sommet de la hiérarchie des normes, s’impose à tous les pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. C’est le cas de figure typique du détournement du droit par un excès de pouvoir, qui préfigurera, par similitude de procédé, celui de 2010, toujours au motif inavoué qu’une telle « attitude décisionnelle » ne saurait être valablement contestée. Dès lors, cette incertitude peut être dissipée en 2015, puisqu’il ne s’agit pas de rejuger un même fait, et que le juge de l’élection peut ne pas suivre une jurisprudence. En l’espèce, il s’agira d’un nouvel acte de candidature, ouvrant l’opportunité de rechercher en cette circonstance, une réponse pertinente, à la définition juridique de l’expression « Ivoirien d’origine », auprès du Code de la Nationalité. Or que dit celui-ci ? « « Est ivoirien : L’enfant légitime ou légitimé, né en Côte d’Ivoire, sauf si ses deux parents sont étrangers …» (Art 6, Al. 1). Nous observons parallèlement, qu’au nombre des pièces et documents réclamés aux candidats, ne figurent pas les Certificats de Nationalité de leurs pères et mères, et que jusque là, aucun candidat n’a jamais pu en fournir un, pour répondre à l’exigence de « nés de père et de mère, eux-mêmes Ivoiriens ». Serait-ce une illusion ?
3 – Le débat sur l’éligibilité pour les élections de 2015 est dépassé
La justice est un service public répondant à une demande sociale. Aussi, nous gagnerions davantage, dans un premier lieu, à sortir de ce débat passéiste et surréaliste, pour avancer vers une exigence qualitative, favorisant la démocratie et la bonne gouvernance, car les conditions à remplir par les futurs candidats, pour les « pré-qualifier » à l’aptitude à l’exerce de la fonction présidentielle, dans le cadre d’une « prédéfinition légale » des profils adéquats, indiquent ce qui est considéré comme primordial, dans une société donnée, à un moment donné de son histoire, pour la gouverner. Dans cette perspective, nous serions plus en droit d’attendre, en complément de la nationalité, des critères additionnels, autres que la nationalité des parents, tel que la compétence (expérience professionnelle dans la gestion des affaires) ou la moralité (distincte des incapacités générales), ou encore la représentativité (soutiens significatifs à la candidature). Dans un second temps, il conviendra de remédier aux failles et faiblesses constatées dans le système électoral (organes, textes, et procédures), en les harmonisant, et à prévoir des dispositions qui fassent obstacle à l’entrée de la politique dans le droit, et assure à ses organes une indépendance accrue. La Constitution Ivoirienne ne consacre pas, contrairement à une fausse idée, la « suprématie » de celle-ci, sur tous les actes de la vie publique, car ceux-ci ne sont pas tous soumis à son contrôle de constitutionalité (Cf. Francis WODIÉ, Nouveaux Cahiers du Conseil Constitutionnel » 3-2013, N°40, PP 137). Il ne dispose pas non plus d’un « pouvoir de police » sur la vie publique (Cf. procédures de saisine), bien qu’étant l’organe régulateur de celle-ci. En cela, plus qu’une demande, l’urgence d’une révision constitutionnelle se pose. Elle pourrait être satisfaite, dès que les conditions sociopolitiques le permettront, en couplant par exemple, le Référendum qu’elle nécessite, aux prochaines élections législatives, pour en réduire le coût.
Enfin, il convient de rappeler quelle est la fonction de l’instrument constitutionnel dont se dote un État, pour parvenir à organiser par ce moyen, le fonctionnement paisible de la société qu’il dirige, en recherchant les objectifs poursuivis par celui-ci (démocratie, paix et cohésion sociale, équilibre des pouvoirs, protection des droits et des libertés individuels et collectifs, égalité des citoyens). Ainsi, il apparaît à l’évidence, que l’outil constitutionnel n’a pas vocation à susciter des crises et des conflits, mais au contraire à les éviter, par son rôle régulateur. Il convient de ne pas gêner ou parasiter cette haute mission par des considérations politiques ou des enjeux de pouvoirs. C’est pourquoi, dans la conception moderne, le juge constitutionnel, est débiteur d’une obligation vis à vis de la communauté nationale (efficacité, compétence, indépendance, équité, transparence, apaisement des tensions socio-politiques et culturelles, information). C’est sans doute, ce rôle de rapprochement et de réconciliation entre le citoyen et l’institution qu’avait tout juste débuté à mettre en œuvre, le Professeur Wodié, qui avait rassuré, tant les pouvoirs publics que les populations, et fait de sa personne, le gage de la qualité du travail constitutionnel, d’où le vacarme provoqué par sa démission. La Constitution, devient sous cet rapport, un espace social et politique du droit, situé au coeur même de la société, et non en dehors d’elle, qui doit trouver un équilibre entre ses différents plans, pour maintenir la paix et la cohésion sociale, face aux difficultés des situations nouvelles. «La justice est un juste milieu, si le juge en est un » disait Aristote. Son autorité découle donc également de son utilité, en tant que service public, et surtout en tant qu’arbitre dans la résolution pacifique des conflits d’intérêts ou de pouvoirs, qui peuvent surgir dans la société, au moyen du droit. Ce dernier est au service de l’intérêt général. Cette conception du rôle de l’instrument constitutionnel est plus proche de celle du Conseil des Sages ou des Anciens des communautés villageoises africaines, où la justice repose sur une philosophie de médiation, que de celle d’une conception abstraite du droit, où la loi est « sourde et aveugle », parce que fermée aux contingences environnementales. C’est un débat entre Anciens et Modernes, entre conformisme et progressisme. La tendance de la « post-modernité » (développement des nouvelles théories du droit, essor de la justice transactionnelle, …) est de considérer, que la fidélité aux textes n’exclut pas nécessairement la souplesse dans l’application du droit aux faits, faute de quoi, la justice continuera à fabriquer malgré elle, de « l’injustice », alors que ce que recherche avant tout le citoyen, est la justice et non la lecture du droit. Autrement dit, si l’on peut faire cette violence à la langue, il faut que la justice soit « juste et intelligente », donc qu’elle « se socialise ». C’est ce que nous attendons d’elle, pour les élections de 2015, afin que celles-ci soient suffisamment apaisées, pour nous permettre d’entendre, de manière audible, la voix du peuple. Encore et encore, l’organe vocal de ce derniee, est l’urne et non le droit. Il reste à faire en sorte que le corps électoral, soit le plus représentatif que possible de celui-ci (proportion des inscrits rapportée à la population, et pluralité politique), car là aussi, un réel effort démocratique est à produire. C’est notre acte de foi dans la démocratie, comme instrument de progrès de l’homme et des sociétés, et notre attachement à la philosophie Africaine de la justice, dans sa capacité à résoudre les difficultés et les différends, de manière « juste » et équilibrée. Au total, il n’y a pas lieu d’avoir peur ou de se crisper. Nous devons accorder un crédit de confiance à nos Institutions, jusqu’à preuve du contraire.




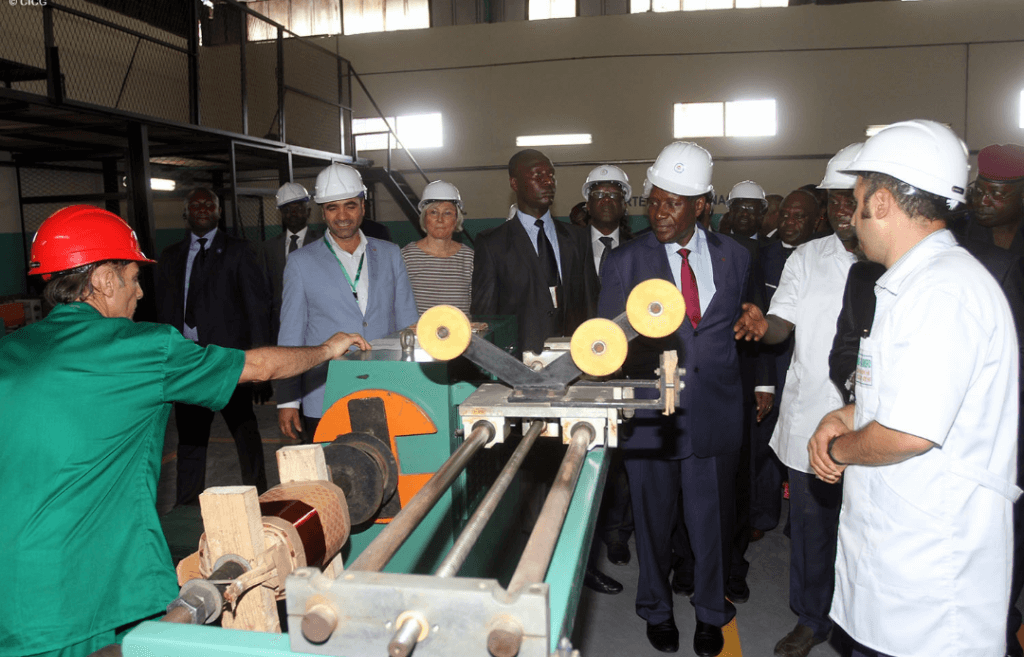



Les commentaires sont fermés.