Dans de nombreux pays africains, lorsque l’État offre une ambulance ou construit un hôpital, un pont, un château d’eau, un marché ou une école, ces réalisations sont parfois présentées comme des dons généreux du ministre ou du chef de l’État. Par conséquent, on organise des cérémonies, on multiplie les remerciements publics et on célèbre le dirigeant comme un bienfaiteur. Cette manière de voir repose sur une confusion fondamentale entre le devoir de l’État et la logique du don personnel.
En réalité, un président, un ministre ou un maire n’est pas un donateur. Il est un serviteur public. Sa mission consiste précisément à répondre aux besoins de la population qui l’a élu. Ces infrastructures et services ne sont pas des faveurs accordées par bonté d’âme, mais des obligations liées à la fonction. Comme le rappelle Jean-Jacques Rousseau, « les magistrats ne sont que les officiers du peuple » (cf. « Du contrat social »). Autrement dit, le pouvoir ne leur appartient pas. Il leur est confié temporairement par les citoyens afin qu’ils l’exercent dans l’intérêt général. Dans une République, il n’y a donc ni bienfaiteurs ni sujets reconnaissants, mais des citoyens et des serviteurs de l’État. Frantz Fanon dénonçait déjà cette personnalisation abusive du pouvoir dans « Les damnés de la terre ». Pour Fanon, un pouvoir qui exige gratitude et adoration trahit sa mission fondamentale qui est de répondre aux besoins concrets des masses populaires. Abraham Lincoln résumait parfaitement cette idée en parlant du « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». Servir tous les citoyens, sans distinction de religion, d’ethnie ou d’opinion politique, n’est pas une option morale; c’est l’essence même de la fonction publique. Un élu est payé par l’argent public pour accomplir cette mission et il doit rendre compte de ses actes.
C’est pourquoi il est totalement inacceptable d’entendre certains responsables politiques affirmer qu’une région ne bénéficiera d’aucune action de l’État si elle ne vote pas pour le président ou pour un parti donné. Une telle attitude va à l’encontre de la liberté politique et du principe d’égalité entre les citoyens. Sur ce point, Montesquieu avait raison de penser que « le suffrage suppose l’égalité entre les citoyens » (cf. « De l’esprit des lois »). Conditionner l’accès aux services publics à un choix électoral, c’est transformer l’État en instrument de chantage et trahir sa mission fondamentale.
Si ces dérives sont possibles, c’est en grande partie parce que la population ignore souvent ses droits et le rôle réel de l’État. Beaucoup de citoyens s’imaginent que ce qui est fait pour eux relève du cadeau ou de la faveur personnelle. Cette ignorance politique entretient la dépendance et favorise le culte du chef. Le philosophe béninois Paulin Hountondji dénonçait cette illusion politique en soulignant que l’attente d’un dirigeant providentiel empêche l’émergence de citoyens responsables (cf. « The struggle for meaning: Reflections on philosophy, culture and democracy in Africa », Ohio University Press, 2002). Mettre fin à cette ignorance est une urgence démocratique. Le sociologue et théologien camerounais Jean-Marc Ela insistait sur la nécessité d’une conscience critique des populations africaines, affirmant que le citoyen doit cesser d’être un simple spectateur pour devenir un acteur de sa propre histoire politique (cf. « Quand l’État pénètre en brousse. Les ripostes paysannes à la crise », Karthala, 1990). Dans la même veine, le philosophe Fabien Eboussi Boulaga critiquait la sacralisation du pouvoir et appelait à une désacralisation de l’État, condition indispensable pour que les gouvernants soient perçus non comme des bienfaiteurs, mais comme des responsables comptables de leurs actes devant le peuple (cf. « La démocratie de transit au Cameroun », L’Harmattan, 1997). L’égyptologue et intellectuel sénégalais Cheikh Anta Diop insistait sur l’importance de la conscience politique et civique des peuples africains, sans laquelle l’État ne peut être qu’un instrument de domination et non de service public. Cette responsabilité incombe d’abord aux enseignants, qui doivent transmettre une véritable éducation civique, mais aussi aux partis politiques, censés former politiquement les citoyens. Pourtant, on a souvent l’impression que la formation politique est reléguée au second plan. Ce qui semble primer, c’est la conquête du pouvoir d’État et le culte du chef, dont on arbore fièrement l’image sur des pagnes, des affiches ou des tee-shirts.
Comme l’écrivait Hannah Arendt, « le pouvoir naît lorsque les hommes agissent ensemble » (cf. « La crise de la culture », Gallimard, 1972). Cette idée souligne que le pouvoir politique véritable ne réside pas dans la figure d’un chef célébré comme un bienfaiteur, mais dans l’action collective de citoyens conscients de leurs droits et de leurs devoirs. Une démocratie vivante suppose donc des citoyens capables de comprendre que l’État n’est pas une personne généreuse, mais une institution au service de tous. Tant que cette prise de conscience n’aura pas lieu, les dirigeants continueront d’être célébrés pour avoir simplement accompli ce pour quoi ils ont été élus. Or, exiger des comptes et refuser la logique du don, c’est déjà faire un pas essentiel vers une citoyenneté véritablement libre et responsable.
Jean-Claude Djéréké





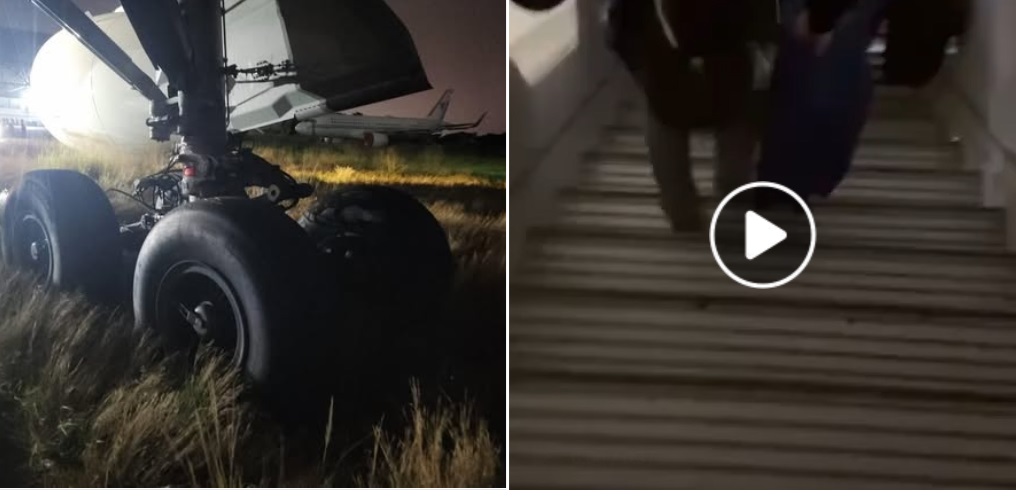
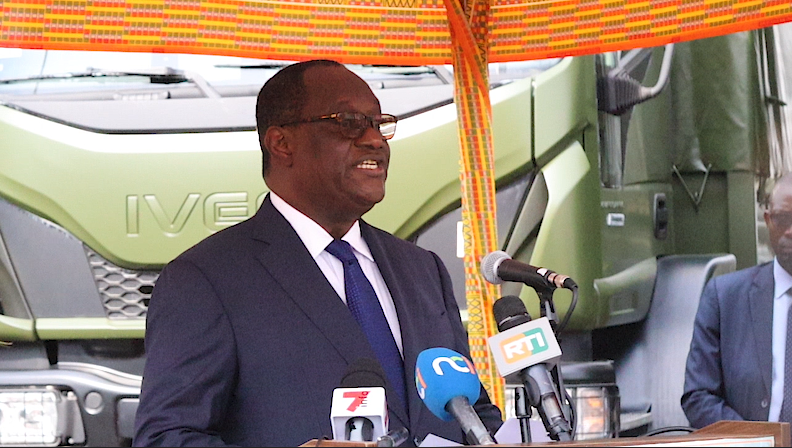
Commentaires Facebook