Le lundi 10 novembre, Nicolas Sarkozy est rentré chez lui après vingt jours d’incarcération à la prison de la Santé. Peu de citoyens étaient présents à sa sortie, ce qui traduit, selon plusieurs observateurs, le profond dégoût d’une partie du peuple français à l’égard de son système judiciaire. Ce désintérêt n’est pas le signe d’une indifférence, mais bien celui d’une désillusion collective: la conviction grandissante que la justice française n’est ni indépendante ni impartiale, surtout lorsqu’il s’agit de juger les puissants.
Dans une démocratie authentique, où la justice se veut autonome vis-à-vis du pouvoir politique, la clémence ne devrait jamais s’appliquer à un individu dont les actions ont gravement porté atteinte à la souveraineté et à l’éthique nationale. En 2008, en effet, Nicolas Sarkozy a trahi la volonté populaire en imposant le traité européen de Lisbonne, pourtant rejeté massivement par référendum en 2005. Ce geste a marqué une rupture entre la France et le principe même de souveraineté populaire. À cela s’ajoutent les guerres illégales dans lesquelles il a engagé le pays, notamment en Libye, au nom d’intérêts géostratégiques et économiques que beaucoup jugent contraires aux valeurs républicaines.
Par ailleurs, l’ancien président est accusé d’avoir perpétué un système néocolonial, notamment à travers la vente de l’or africain confisqué par la France, consolidant ainsi une tradition d’exploitation et de domination sur les anciennes colonies. On peut citer aussi la réintégration de la France dans l’OTAN, décision contestée qui a réduit l’indépendance diplomatique du pays et aligné sa politique étrangère sur celle des États-Unis.
Malgré ces fautes politiques et morales, Sarkozy jouit encore d’avantages matériels colossaux: un salaire annuel de 630 000 euros, une retraite de 553 000 euros et des bénéfices non commerciaux estimés à 2,3 millions d’euros.
Qu’un homme ayant tant bénéficié du système puisse être libéré après seulement vingt jours d’incarcération apparaît, pour beaucoup, comme une insulte à la justice sociale et aux petites gens. Cette situation illustre l’une des plus grandes failles du modèle républicain français: l’inégalité devant la loi.
Mais faut-il réellement s’en étonner ? L’histoire judiciaire française, marquée par de multiples affaires d’État, démontre que la balance de la justice penche souvent du côté des puissants. Les scandales politico-financiers, les non-lieux récurrents et les peines symboliques accordées à certaines élites alimentent une perception d’impunité généralisée. Dans ce contexte, la libération rapide de Nicolas Sarkozy n’est pas une anomalie, mais la continuation d’un système de privilèges profondément enraciné dans les institutions.
Cette situation rappelle les vers célèbres de Jean de La Fontaine dans « Les animaux malades de la peste ». La Fontaine écrit ceci: “Selon que vous serez puissant ou misérable,
Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.”
Ces lignes, écrites au XVIIᵉ siècle, résonnent aujourd’hui avec une actualité troublante. Elles traduisent la permanence d’un double standard moral et juridique: celui qui distingue le citoyen ordinaire du personnage influent. En France, les “petites gens” paient souvent lourdement le prix de la loi, tandis que les détenteurs de pouvoir bénéficient de la clémence d’un appareil judiciaire politisé et complaisant.
Ainsi, le cas Sarkozy dépasse la simple question d’un individu. Il révèle la crise morale et institutionnelle d’une République qui, tout en se proclamant égalitaire, entretient des mécanismes d’inégalité. Libérer un ancien chef d’État après vingt jours de détention, malgré des accusations graves, c’est envoyer un message désastreux à la société: celui de l’impunité des élites et de la résignation des masses.
En définitive, le scandale Sarkozy n’est pas seulement celui d’un homme, mais celui d’un système où le pouvoir politique neutralise le pouvoir judiciaire. Il questionne la cohérence de la devise républicaine — Liberté, Égalité, Fraternité — à la lumière d’une pratique institutionnelle où la loi semble avoir deux visages. Tant que cette justice sélective persistera, la France restera un pays où la morale publique s’efface devant la puissance et l’argent et où l’État de droit n’est plus qu’une formule rhétorique, vidée de sa substance.
Jean-Claude DJEREKE



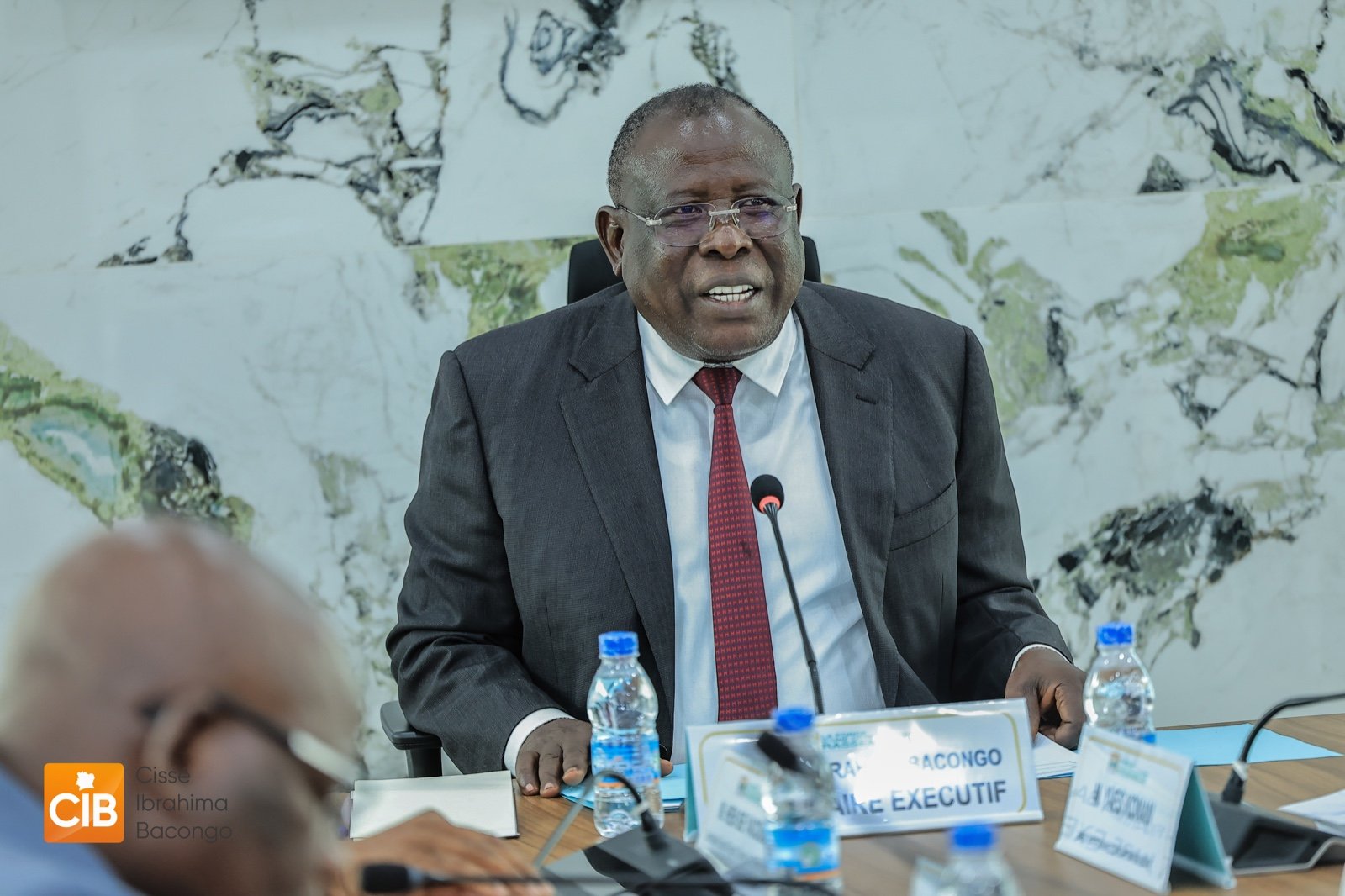

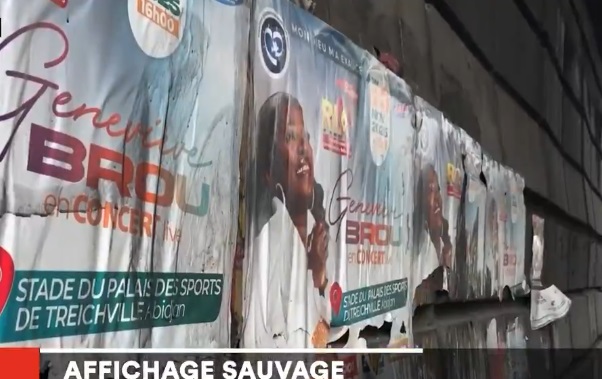

Commentaires Facebook