L’élection de Zohran Mamdani, Américain d’origine indienne, à la tête de la mairie de New York continue de susciter des débats à travers le monde. Inspirés par cet exemple, certains Libanais vivant en Côte d’Ivoire ont exprimé le souhait qu’un des leurs puisse, un jour, devenir maire, député, voire ministre dans notre pays d’accueil. Pourquoi pas ?, pourrait-on dire, car la Côte d’Ivoire a toujours été un pays ouvert, hospitalier, généreux à l’égard des étrangers. Peu de nations au monde ont accueilli autant d’étrangers que la nôtre, et peu leur ont offert autant d’opportunités économiques et sociales.
Pourtant, un tel rêve paraît difficile à concrétiser aujourd’hui, et cela pour quatre raisons principales qui tiennent moins à la loi qu’à la mémoire collective et aux rapports humains. Ces raisons ne relèvent pas de la haine ni du rejet, mais d’une série de comportements, d’attitudes et d’histoires qui ont nourri la méfiance.
La première raison est morale. Les Libanais sont souvent perçus, en Afrique de l’Ouest, à travers le prisme de ce que subissent les Africains subsahariens au Liban. Les reportages, les témoignages et les enquêtes d’ONG ont révélé les traitements inhumains infligés à de nombreux travailleurs africains, en particulier des femmes venues du Ghana, du Nigéria, d’Éthiopie, du Sénégal ou de Sierra Leone.
Les images d’Africaines battues, privées de salaire, retenues contre leur gré, parfois poussées au suicide, ont profondément choqué les consciences africaines. Ces pratiques, largement documentées, sont liées au système dit de la kafala, qui donne à l’employeur un quasi-pouvoir de propriété sur le travailleur. Même si tous les Libanais n’y participent pas et que certains dénoncent eux-mêmes ces abus, le symbole reste violent: comment comprendre que ceux dont les compatriotes maltraitent des Africains au Moyen-Orient puissent aujourd’hui prétendre les diriger politiquement en Afrique ?
Ce passé récent crée une blessure de confiance. Il faut la reconnaître et la soigner avant d’espérer bâtir une fraternité civique solide.
Les conditions de travail en Côte d’Ivoire: une injustice prolongée
Le deuxième obstacle tient aux conditions de travail imposées, dans certains cas, aux employés ivoiriens par des employeurs d’origine libanaise. Beaucoup se plaignent de salaires très bas, d’horaires épuisants, de l’absence de contrats en bonne et due forme, ou du non-respect des congés et des droits sociaux. Ces pratiques, bien que non généralisées, ternissent l’image d’une communauté souvent prospère et économiquement influente.
Le ressentiment social se nourrit de cette impression d’exploitation. Dans une société où la pauvreté reste élevée, voir des étrangers s’enrichir tout en payant mal leurs employés crée une fracture morale et politique. On ne peut prétendre à la direction d’une commune ou d’une circonscription si une partie importante de la population vous perçoit comme injuste ou insensible à la souffrance des travailleurs.
Troisième critique: la corruption.
De nombreux Ivoiriens accusent certains opérateurs économiques étrangers — parmi lesquels des Libanais — de corrompre des agents de l’administration, des collecteurs d’impôts, voire des forces de l’ordre, afin d’échapper à leurs obligations fiscales ou de régler des litiges à leur avantage. Même si ces pratiques ne concernent pas tous les entrepreneurs, elles alimentent le sentiment que la loi ne s’applique pas de la même manière à tous. Dans l’esprit du citoyen, le pouvoir économique se confond alors avec l’impunité. Or, pour prétendre à des responsabilités politiques, il faut être au-dessus de tout soupçon. Tant que ce climat de méfiance persistera, les ambitions politiques des ressortissants libanais resteront limitées, quel que soit leur mérite individuel.
Le repli communautaire: obstacle à la confiance
Le quatrième frein est sociologique. Les Libanais, en Côte d’Ivoire, forment une communauté soudée, mais souvent fermée. Ils vivent entre eux, se marient entre eux, se fréquentent majoritairement entre eux. Ce choix de préserver leur identité culturelle et religieuse est compréhensible. Toutefois, il renforce l’idée d’un repli communautaire, d’une distance sociale qui empêche la véritable intégration.
Dans l’imaginaire populaire, cette séparation volontaire se traduit par une suspicion: “Ils ne veulent pas vivre avec nous, mais ils veulent nous diriger.” Or, la politique repose avant tout sur le lien social, la proximité et la confiance. Tant que les barrières symboliques ne tomberont pas, la conquête du cœur électoral ivoirien sera difficile.
Un dialogue de vérité pour dépasser la méfiance
Ces quatre raisons n’ont pas vocation à nourrir la haine, mais à rappeler une vérité: la confiance politique ne se décrète pas, elle se mérite. Si un jour un Libanais souhaite se présenter à une fonction publique en Côte d’Ivoire, il devra incarner une autre manière d’être, un rapport nouveau aux citoyens, fondé sur la justice, le respect et la transparence.
Il faudra aussi que la communauté libanaise, dans son ensemble, s’engage dans un processus de réconciliation symbolique avec l’Afrique subsaharienne. Cela passe par la condamnation claire des mauvais traitements infligés aux Africains au Liban, par des gestes de solidarité envers ces victimes et par un effort visible pour améliorer les conditions de travail de leurs employés ici.
De leur côté, les Ivoiriens doivent éviter la tentation de la généralisation. Tous les Libanais ne sont pas coupables des abus constatés. Beaucoup vivent paisiblement, respectent la loi, paient leurs impôts et participent au développement du pays. Reconnaître ces différences, c’est aussi une marque de maturité.
La politique, miroir de la justice sociale
Un Libanais maire en Côte d’Ivoire ? L’idée n’est pas impensable. Elle pourrait même symboliser une nouvelle étape de notre ouverture. Mais cette ouverture exige d’abord la vérité, la justice et la réciprocité. L’Afrique ne peut pas tendre la main à ceux qui la méprisent ailleurs, ni confier le pouvoir local à ceux qui exploitent ses enfants sur place.
Les Libanais de Côte d’Ivoire ont, pour beaucoup, contribué à la vitalité économique du pays. À eux maintenant de montrer, par des actes, qu’ils partagent nos valeurs de respect et d’égalité. Alors, peut-être, un jour, les Ivoiriens verront en eux non plus des étrangers fortunés, mais des compatriotes de cœur, capables de servir la cité avec loyauté et humanité. Car la vraie intégration ne se mesure pas au nombre d’années passées dans un pays, mais à la qualité du lien tissé avec ceux qui l’habitent.
Jean-Claude Djéréké


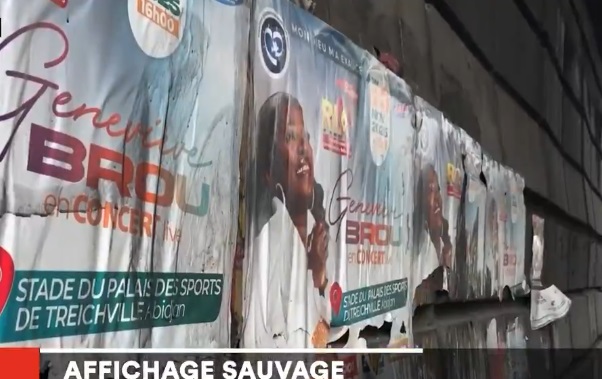




Commentaires Facebook