L’élection de Zohran Mamdani au poste de 111ᵉ maire de New York a suscité un étonnement planétaire. Fils d’immigrés, né en Ouganda de parents indiens, arrivé aux États-Unis à l’âge de sept ans, il incarne une Amérique métissée, diverse, qui revendique l’héritage d’une ville bâtie par des mains venues d’ailleurs. Quoique les Démocrates aient perdu mon estime depuis 2011 — l’année où Barack Obama soutint l’action criminelle de Nicolas Sarkozy en Libye et en Côte d’Ivoire, au prix de milliers de vies innocentes et d’un chaos durable —, je ne peux m’empêcher de me réjouir de cette victoire, et ce, pour deux raisons essentielles.
La première raison tient à une déclaration de Mamdani qui a fait le tour du monde: il a promis, s’il en avait l’occasion, de faire arrêter Benjamin Netanyahu pour crimes de guerre et génocide contre le peuple palestinien, au cas où ce dernier mettrait les pieds dans sa ville. « Nul n’est au-dessus de la loi », a-t-il rappelé, en référence à la longue impunité dont bénéficient certains dirigeants internationaux. Une telle prise de position est rare dans la classe politique américaine, dominée par le calcul diplomatique et la crainte de froisser les alliés stratégiques. Elle révèle un courage moral et une intégrité que beaucoup de dirigeants, dans le Nord comme dans le Sud, semblent avoir perdus.
La seconde raison de ma satisfaction est sa manière d’avoir rappelé une vérité historique trop souvent refoulée: New York est une ville d’immigrants. De fait, la majorité des Américains sont issus de l’immigration — Donald Trump y compris, lui dont les ancêtres venaient d’Allemagne. Il est donc profondément indécent, pour un immigrant ou un descendant d’immigrants, de faire la chasse à d’autres immigrants. C’est là une forme d’amnésie morale et d’hypocrisie politique que Mamdani a eu le mérite de dénoncer avec vigueur. En le faisant, il a rendu à New York un peu de sa conscience, de sa mémoire et de sa dignité.
Le miroir de notre propre société
Cette élection américaine, aussi lointaine qu’elle puisse paraître, a eu un écho inattendu en Côte d’Ivoire. Certains Libanais vivant chez nous, inspirés par l’exemple Mamdani, ont souhaité que le même scénario puisse se produire ici: qu’un étranger ou un fils d’immigrés puisse, un jour, devenir maire, député, voire président dans le pays qui les a accueillis. La comparaison a de quoi faire sourire, mais aussi réfléchir.
La Côte d’Ivoire a toujours été un pays d’accueil. De Félix Houphouët-Boigny à nos jours, notre hospitalité a été célébrée, parfois même enviée. Nous avons ouvert nos bras à ceux qui fuyaient la guerre, la misère ou le désespoir. Nous avons accueilli des Burkinabè, des Maliens, des Guinéens, des Ghanéens, des Libanais, des Français, et bien d’autres encore. Cette ouverture a façonné notre économie, notre culture et nos villes. Elle a fait de nous un carrefour, un creuset, un lieu d’échanges.
Mais cette générosité a aussi eu son revers. Certains étrangers, installés ici depuis plusieurs générations, refusent de reconnaître la place qui leur a été faite. Ils se croient désormais plus ivoiriens que les Ivoiriens eux-mêmes, méprisent parfois ceux qui les ont accueillis et se permettent de piétiner leurs hôtes, comme si la gratitude n’était plus de ce monde. D’autres, à force d’avoir accumulé richesses et positions, oublient qu’ils sont les fruits d’une hospitalité, et non les maîtres des lieux.
Aujourd’hui, selon certaines estimations, les étrangers constitueraient près de 26 % de la population ivoirienne. Ce chiffre, à lui seul, illustre notre capacité d’accueil, mais aussi les tensions qu’elle peut générer. Certains de nos compatriotes estiment que nous sommes « trop hospitaliers », que nous avons ouvert trop grand nos portes. D’autres rappellent que la fraternité africaine impose la solidarité et l’ouverture. Entre ces deux postures, la vérité se situe sans doute dans la mesure : accueillir, oui, mais sans perdre le sens de la souveraineté et du respect mutuel.
Pourquoi le cas Mamdani est différent
Il serait toutefois simpliste de comparer la situation américaine à la nôtre. Le cas de Zohran Mamdani est particulier, et sa légitimité politique repose sur un parcours exemplaire. Il est arrivé aux États-Unis à l’âge de sept ans ; il a grandi, étudié, travaillé et milité dans ce pays avant de briguer une fonction publique. Il a donc eu le temps de se faire connaître, de s’intégrer, de convaincre, de prouver sa valeur. Il incarne à merveille ce dicton qui veut qu’il soit nécessaire d’être éprouvé avant d’être approuvé.
Mais la différence la plus significative réside ailleurs : Mamdani n’a jamais renié ses origines. Il n’a jamais cherché à effacer son passé, ni à se dissoudre dans une identité artificielle. Il se présente comme Américain d’origine ougandaise et indienne, fier de ce qu’il est, conscient de ce qu’il doit à son histoire. C’est cette honnêteté identitaire qui lui vaut aujourd’hui respect et admiration. Il n’a jamais prétendu vouloir dépouiller les Américains de leurs biens pour en faire cadeau aux étrangers. Son engagement politique est fondé sur la justice sociale et la responsabilité collective, non sur le ressentiment ou la revanche.
Dans le cas ivoirien, c’est cette attitude que beaucoup d’étrangers gagneraient à adopter. Être fier de ses origines n’a jamais été un défaut. C’est au contraire une preuve d’équilibre intérieur. Ce que les Ivoiriens reprochent, ce n’est pas la présence de l’autre, mais son arrogance, son ingratitude, son refus de reconnaître la main qui l’a nourri. Les peuples ne rejettent pas les étrangers parce qu’ils sont différents, mais parce qu’ils se comportent comme des conquérants plutôt que comme des invités.
Étranger, un mot qui ne devrait pas être une insulte
Dans le débat public ivoirien, le mot « étranger » a souvent été déformé, instrumentalisé, chargé d’émotion. Or, dire de quelqu’un qu’il est étranger n’est pas l’insulter. C’est simplement nommer une réalité administrative, culturelle ou juridique. Mamdani lui-même ne s’est jamais offusqué d’être traité d’étranger. Il en a fait une force, une identité, un point d’ancrage. Seuls les esprits faibles, ou les cœurs rancuniers, se vexent quand on leur rappelle qui ils sont.
Être étranger n’est pas une honte. Ce qui est honteux, c’est d’être étranger à la gratitude, à la loyauté, au respect du pays d’accueil. L’Ivoirien qui s’exile en Europe ou en Amérique espère être accueilli avec respect, mais il sait qu’il doit se conformer aux lois de son hôte. Il ne s’imagine pas devenir, du jour au lendemain, maître du pays qui l’a reçu. Il en est de même pour quiconque vit ici: la reconnaissance de l’autre commence par la reconnaissance de soi.
Dans cette perspective, le cas Mamdani est une leçon d’équilibre identitaire et de maturité civique. Il nous rappelle qu’il est possible de servir un pays sans trahir ses origines, de s’intégrer sans s’effacer, de participer sans dominer. Sa victoire à New York est une victoire de la diversité authentique, celle qui unit sans confondre, celle qui enrichit sans avaler.
Pour une nouvelle vision de l’hospitalité ivoirienne
La Côte d’Ivoire ne doit pas renier son hospitalité. Elle doit la repenser. Accueillir ne signifie pas s’effacer. L’ouverture n’exclut pas la fermeté. Nous devons retrouver le juste équilibre entre l’humanité et la responsabilité nationale. L’étranger qui vit parmi nous doit comprendre que son intégration passe par le respect de nos lois, de notre culture et de nos priorités économiques. Et l’Ivoirien, de son côté, doit comprendre que la fermeture totale est contraire à notre histoire et à notre vocation africaine.
Le rêve ivoirien n’est pas d’exclure, mais de construire ensemble, dans le respect mutuel. À cet égard, l’exemple de Zohran Mamdani devrait nous inspirer : non pas pour accepter que des étrangers marchent sur nous, mais pour montrer que l’intégration est possible quand elle repose sur la vérité, la loyauté et la reconnaissance. C’est ainsi qu’une nation se renforce, qu’une société trouve la paix et que l’hospitalité cesse d’être un fardeau pour redevenir une richesse.
La Côte d’Ivoire est un pays d’accueil et elle le restera. Mais cet accueil ne doit pas être compris comme une abdication. Il suppose des devoirs autant que des droits, de la reconnaissance autant que de la tolérance. Être étranger n’est pas une tare. C’est un statut. Ce qui compte, c’est la manière dont on l’habite. Zohran Mamdani a prouvé qu’on pouvait être fils d’immigrés, étranger d’origine, et pourtant devenir le symbole d’une ville-monde.
Souhaitons que cet exemple inspire à la fois les étrangers qui vivent parmi nous et les Ivoiriens eux-mêmes, afin que chacun retrouve le sens du respect, de la mesure et du vivre-ensemble. Car ce n’est qu’à cette condition que notre hospitalité continuera d’être une force — et non une faiblesse.
Jean-Claude Djéréké

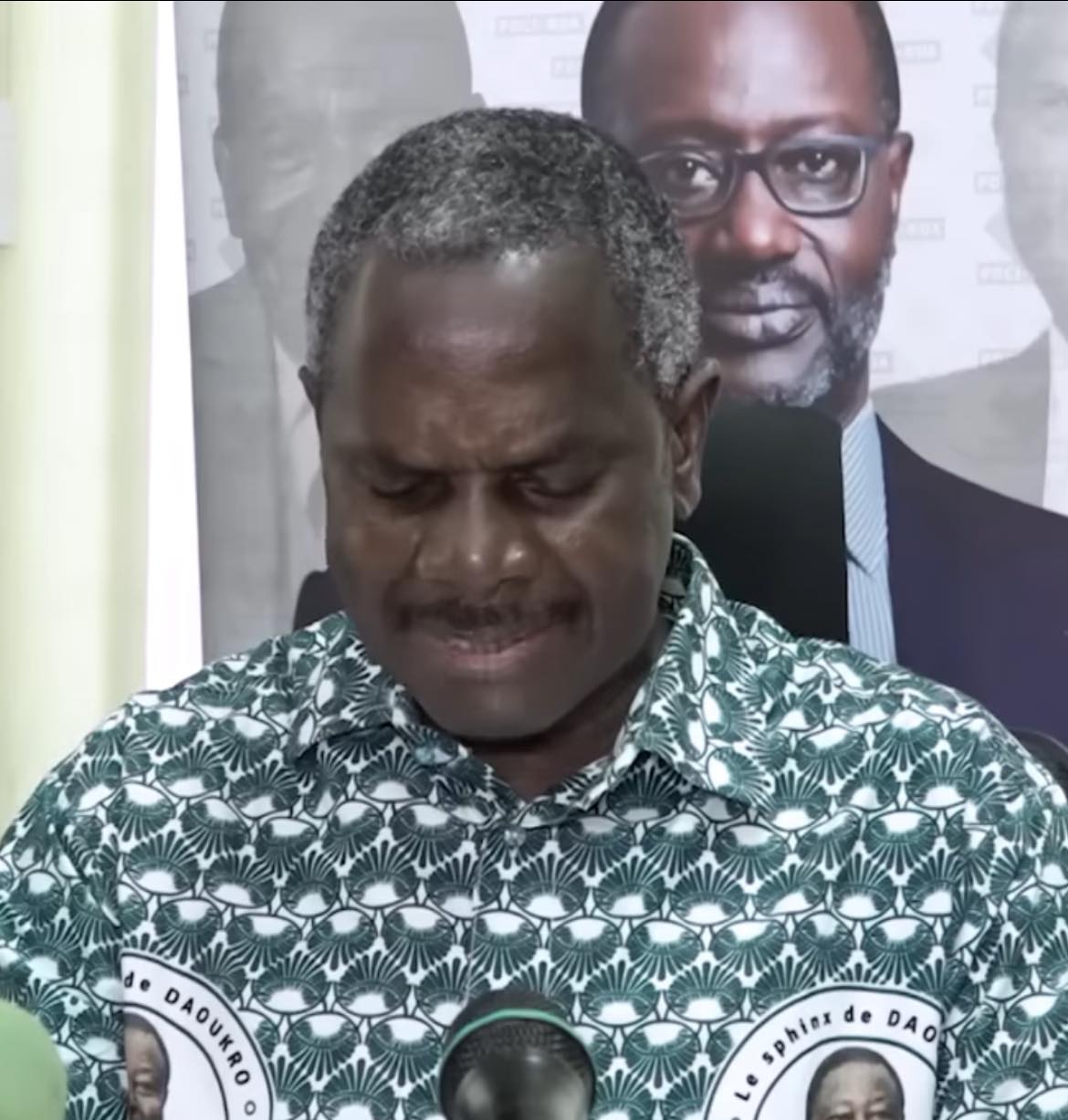



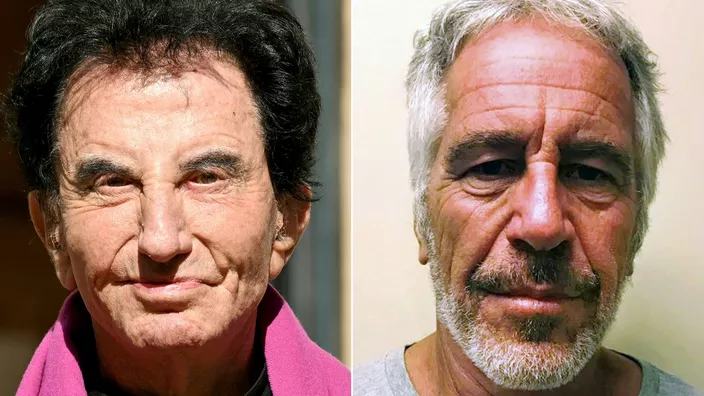

Commentaires Facebook