À trop tirer sur la corde, elle finit toujours par se rompre. Et souvent, ce n’est pas un simple craquement, mais une déflagration : un bruit sourd qui résonne dans les rues, secoue les institutions, fissure les certitudes, renverse les masques.
La Côte d’Ivoire avance aujourd’hui sur une corde raide : entre l’apparente stabilité d’un pouvoir centralisé et la colère contenue d’un peuple qui sent monter l’étau autour de sa liberté dans son propre pays.
Depuis plusieurs mois, les interdictions de manifester se succèdent à un rythme inquiétant. Préfets, ministres, forces de l’ordre invoquent les « risques de trouble à l’ordre public », comme un refrain devenu réflexe. Mais derrière la formule administrative, il y a autre chose : la peur. La peur du peuple. La peur du réel.
Le droit de manifester : un thermomètre démocratique
Dans toute démocratie, la rue est un baromètre. Ce n’est pas un ennemi, c’est un instrument de mesure. Elle dit la température d’un pays, son degré de frustration, d’espérance, de tension. En Côte d’Ivoire, la rue a toujours été politique. De 1990 à 2011, des marches ont souvent précédé les grandes transformations : la chute du parti unique, la naissance du multipartisme, les revendications estudiantines, les luttes syndicales, les appels à la souveraineté nationale.
Empêcher la rue de parler, c’est comme casser le thermomètre et prétendre que la fièvre a disparu.
Mais la fièvre reste là. Elle circule dans les veines du pays. Elle se lit dans les marchés, dans les gbakas, dans les bureaux, dans les visages de ceux qui se sentent trahis par un pouvoir qui parle au nom du peuple mais n’écoute plus personne.
La peur du désordre comme prétexte politique
Le mot magique — « trouble à l’ordre public » — revient à chaque communiqué officiel. Mais que signifie-t-il réellement ?
Qu’une société vivante, diverse, revendicative, serait une menace pour elle-même ?
Qu’il faudrait empêcher tout mouvement, toute voix dissonante, au nom d’une paix imposée d’en haut ?
Dans la pratique, cette « paix » n’est qu’une façade. Elle sert à maintenir l’ordre établi, à protéger les intérêts en place, à éviter que les clarifications sociales, politiques et économiques ne se révèlent au grand jour. Car derrière la peur de ce qui est qualifié de désordre, il y a une autre peur, plus profonde : celle du jugement populaire.
Un pouvoir qui interdit de manifester ne craint pas le désordre : il craint la vérité. Il sait que la rue ne ment pas.
Que les pancartes disent ce que les sondages dissimulent.
Que les cris du peuple, quand ils se lèvent, balayent les discours écrits dans les salons climatisés.
De la démocratie encadrée à la démocratie bâillonnée
Le discours officiel parle d’une démocratie en progrès, d’un État de droit consolidé, d’élections libres et régulières. Mais à quoi sert le droit de voter si le droit de manifester est supprimé ?
À quoi sert la liberté d’expression si la liberté de rassemblement est criminalisée ?
Petit à petit, le multipartisme ivoirien se transforme en un multipartisme de façade. Les urnes existent, mais les voix sont surveillées.
Les partis existent, mais leur expression publique est filtrée, bâillonnée. Les citoyens existent, mais on les contraint à se taire.
Cette dérive en cours en Côte d’Ivoire confond stabilité et autoritarisme. On prétend préserver la paix civile, alors qu’on l’impose au prix du silence. On érige la sécurité en fétiche, alors qu’on en fait un outil de contrôle.
Quand la rue devient un crime
Interdire la manifestation, c’est transformer un acte citoyen en délit.
C’est faire de celui qui marche pour un idéal un suspect.
C’est donner aux forces de l’ordre un rôle politique qu’elles ne devraient jamais avoir : celui d’arbitres du débat public.
Or, la répression engendre toujours l’effet inverse.
À force d’interdire, on radicalise. À force de surveiller, on provoque la clandestinité. À force d’étouffer, on fabrique la colère.
L’histoire ivoirienne nous enseigne qu’aucun pouvoir ne gagne durablement contre son peuple. On peut arrêter les leaders, censurer les médias, disperser les foules. Mais on ne peut pas éteindre une idée, surtout lorsqu’elle s’enracine dans la frustration, la pauvreté, le sentiment d’injustice.
Le silence comme stratégie politique
Ce qui se joue ici dépasse le cadre d’une simple mesure administrative. L’interdiction de manifester traduit une conception du pouvoir : celle d’un État, vertical, centralisé, où le citoyen n’est pas un acteur mais un sujet. Un État qui ne dialogue pas, qui décrète. Un État qui ne négocie pas, qui impose. Un État qui confond la loyauté avec la soumission.
Mais, attention, le silence n’est pas la paix. Le calme apparent des rues n’est pas synonyme de satisfaction.
Les régimes qui se sont effondrés brutalement, dans l’histoire, étaient souvent ceux qui se félicitaient d’une « stabilité exemplaire » peu de temps avant leur chute.
Un peuple en attente d’écoute
Ce que réclament les Ivoiriens, ce n’est pas le chaos. Ce n’est pas la confrontation. C’est l’écoute. Le droit de dire leur souffrance, leur désaccord, leurs aspirations. C’est le besoin d’être reconnus comme citoyens adultes, capables de parler sans permission. Mais à chaque interdiction, c’est un peu de cette confiance qui s’éteint. Le citoyen finit par se sentir étranger dans sa propre nation.
Le patriotisme devient suspect, la critique devient offense, la vérité devient menace. Et quand un peuple n’a plus le droit de parler, il cesse d’appartenir à lui-même.
Les conséquences d’un verrouillage permanent
Le danger n’est pas immédiat, mais il est profond.
Car une société où l’expression publique est verrouillée devient une société instable. Les tensions non exprimées ne disparaissent pas — elles s’accumulent. Et un jour, elles explosent.
L’histoire récente de la Côte d’Ivoire — crises politiques, violences électorales, révoltes sociales — prouve que chaque étouffement du débat finit par coûter cher : en vies humaines, en confiance, en cohésion nationale. Un État qui interdit la contestation prépare, sans le savoir, sa propre contestation.
Vers un sursaut démocratique ?
Il est encore temps de rompre avec cette logique de peur.
Le pouvoir ivoirien gagnerait à comprendre que la force d’un État ne réside pas dans sa capacité à interdire, mais dans sa maturité à gérer la liberté. Permettre au peuple de s’exprimer, ce n’est pas céder du terrain : c’est renforcer le lien civique. Encadrer les manifestations, oui ; les interdire, non. Il ne s’agit pas de chaos, mais de catharsis.
Une nation qui se parle se répare. Une nation qui se tait se déchire.
En conclusion :
Oui, à trop tirer sur la corde, elle finit par se rompre. Mais avant de rompre, elle grince. Et dans ce grincement, il y a tout le chant du peuple qui s’efforce encore de prévenir avant de punir, d’alerter avant de se soulever. La Côte d’Ivoire n’a pas besoin de plus d’interdits : elle a besoin de plus de confiance.
Elle n’a pas besoin d’une paix muette : elle a besoin d’une paix juste.
Et disons-le clairement pour que cela s’entende clairement, la justice commence toujours par la liberté.
©Dr KOCK OBHUSU
Économiste – Ingénieur


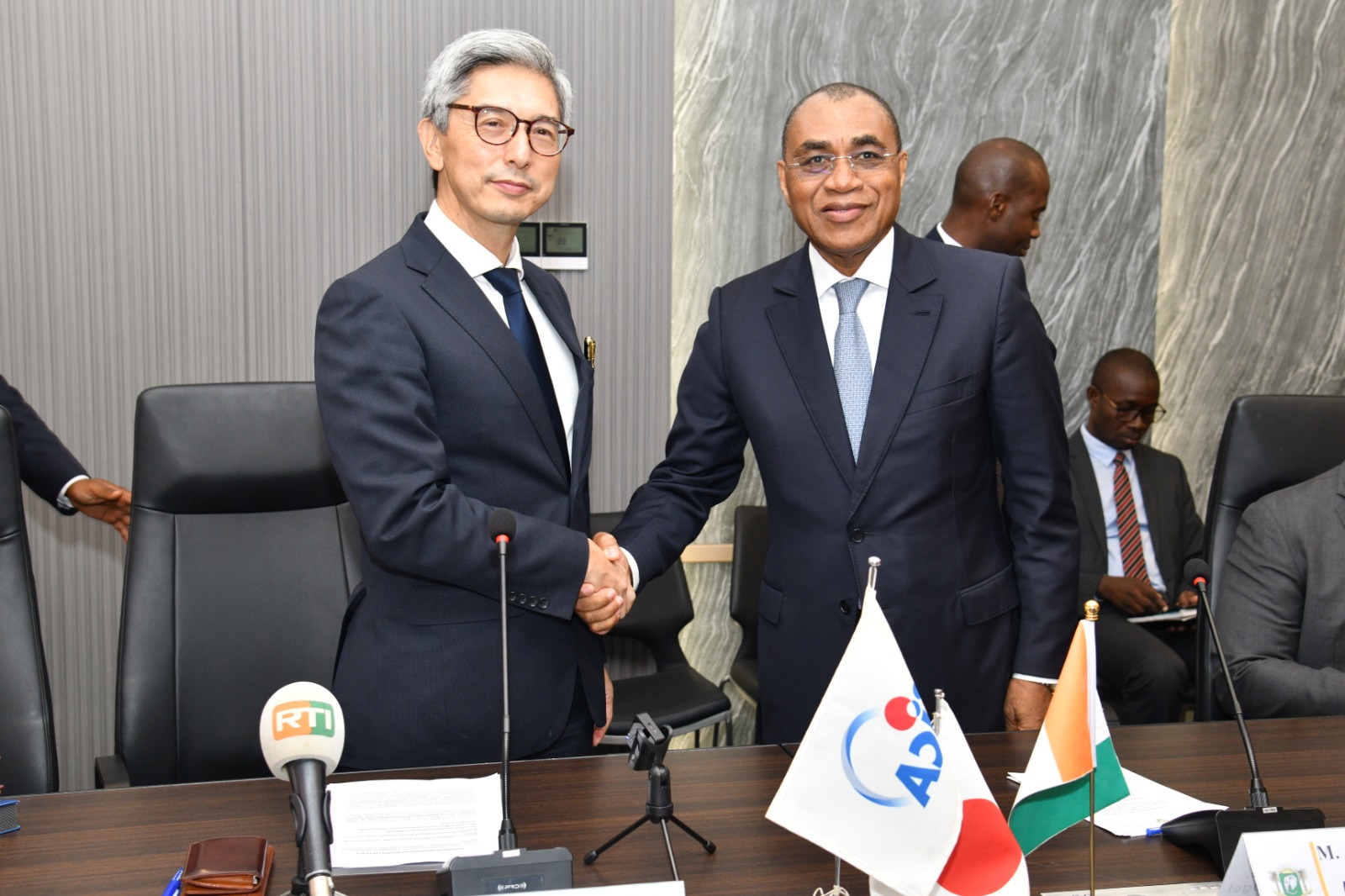

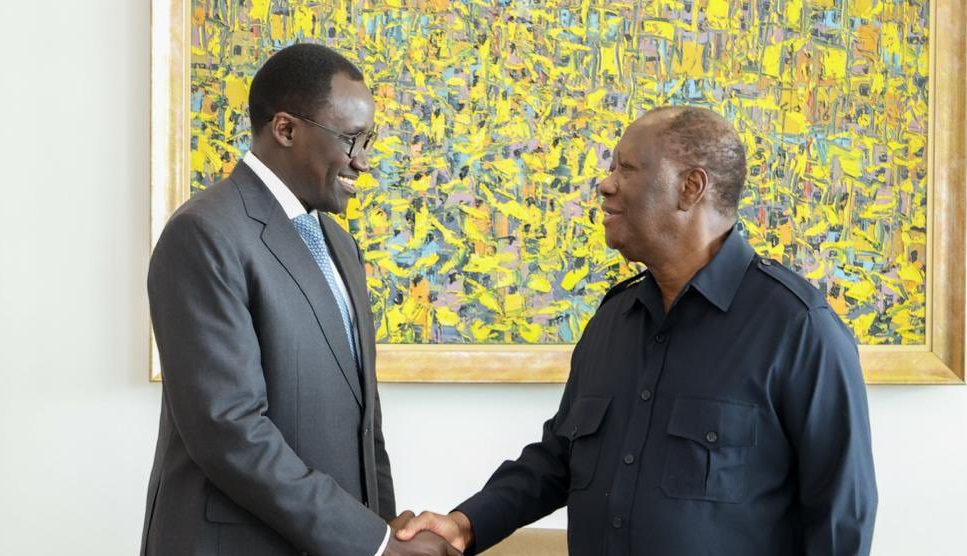


Commentaires Facebook