
Les récentes mobilisations de la jeunesse dans plusieurs pays, au Maroc avec le mouvement GenZ212, à Madagascar et au Népal, illustrent une tendance mondiale, une génération qui refuse le statu quo et cherche à imposer ses revendications sociales et politiques. Ces contestations, portées par une jeunesse nombreuse, instruite et connectée, trouvent leurs racines dans des causes universelles le chômage, la corruption, la vie chère et le manque de perspectives.
En Côte d’Ivoire, alors que l’élection présidentielle du 25 octobre 2025 approche, la question se pose, le pays pourrait-il connaître un mouvement similaire, capable de fédérer une jeunesse désabusée mais encore prudente, consciente du lourd héritage des crises passées ?
Des révoltes qui se ressemblent malgré la distance
À Rabat, Antananarivo ou Katmandou, les ressorts des mobilisations de jeunesse sont proches. Au Maroc, la GenZ212 a mis en avant l’idée que l’argent public devait être mieux investi dans la santé et l’éducation plutôt que dans de grands projets sportifs. Le slogan « des hôpitaux, pas des stades » a marqué les esprits. À Madagascar, la jeunesse a dénoncé le coût de la vie, la corruption et l’incapacité du système politique à offrir des perspectives crédibles. Au Népal, les protestations étudiantes et citoyennes se sont multipliées face à la montée du chômage et au sentiment que seules les élites bénéficient de la croissance.
Ces mouvements montrent que la jeunesse, où qu’elle se trouve, partage un même diagnostic : celui d’un avenir bloqué par l’injustice sociale et la captation des ressources nationales par une minorité.
Côte d’Ivoire : un terrain favorable mais particulier
En Côte d’Ivoire, les ingrédients d’une contestation existent potentiellement avec une jeunesse nombreuse, près de deux tiers de la population a moins de 25 ans, un chômage persistant chez les jeunes diplômés, souvent contraints à la débrouillardise, des inégalités sociales criantes malgré une croissance économique continue et une méfiance envers les élites politiques, perçues comme déconnectées des réalités quotidiennes.
Pour autant, l’histoire récente a laissé des traces profondes. Les crises post-électorales de 2010-2011 et 2020 ont marqué une génération entière, qui associe encore la contestation politique à la violence, aux divisions communautaires et à la perte de vies humaines. Cette mémoire collective rend l’hypothèse d’un mouvement massif de rue plus complexe que dans les autres pays cités.
Avant et après le scrutin : deux scénarios contrastés
La perspective d’un mouvement de type GenZ212 en Côte d’Ivoire doit être envisagée en deux temps. Avant l’élection présidentielle, il est peu probable qu’une mobilisation de grande ampleur voie le jour avant le scrutin. Le climat électoral est déjà tendu, et beaucoup de jeunes hésitent à s’exposer. Cependant, il faut s’attendre à une intensification de la contestation numérique avec des dénonciations d’irrégularités, des campagnes virales contre l’achat de voix et le partage de vidéos accusant la corruption ou les violences politiques. Les réseaux sociaux deviendront sans doute le théâtre principal de la mobilisation pré-électorale. C’est après l’annonce des résultats que la dynamique peut basculer. Si le scrutin est jugé transparent et inclusif, la jeunesse pourrait canaliser son énergie vers des initiatives citoyennes pacifiques : mouvements associatifs, plateformes de veille démocratique, revendications sociales ciblées. En revanche en cas de résultat perçu comme truqué ou confiscatoire, un risque réel de mobilisation à la manière du GenZ212 existe. Cela pourrait se traduire par des manifestations ponctuelles dans les grandes villes, amplifiées par un activisme numérique puissant. Mais, compte tenu du souvenir douloureux des crises passées, il est peu probable que cette contestation prenne la même ampleur qu’au Maroc.
Le rôle central et ambivalent des réseaux sociaux
Les réseaux sociaux ont redéfini la manière dont les jeunes s’expriment et se mobilisent. En Côte d’Ivoire, leur rôle est encore plus déterminant qu’ailleurs, car Facebook, WhatsApp et TikTok constituent les canaux d’information principaux pour une grande partie de la jeunesse.
On peut ici identifier les forces des réseaux sociaux, une rapidité de mobilisation et diffusion virale des messages, le contournement des médias traditionnels, qui sont souvent accusés de parti pris et la visibilité internationale des causes locales. Mais aussi les faiblesses et dangers, avec la désinformation et les rumeurs, les intox et les montages qui circulent vite et attisent la colère. Des influenceurs qui pratiquent la manipulation politique et pouvant exploiter les frustrations pour servir des agendas partisans et les ingérences extérieures, certains acteurs étrangers utilisent les plateformes pour semer la division, attiser la méfiance envers les institutions et déstabiliser les processus électoraux.
Le cas marocain a montré la puissance de la mobilisation numérique, mais aussi sa vulnérabilité face aux tentatives de récupération. La Côte d’Ivoire, déjà confrontée à un activisme numérique intense et parfois malveillant, n’est pas à l’abri de telles dérives.
La jeunesse ivoirienne entre exaspération et prudence
La différence majeure entre la Côte d’Ivoire et les autres pays est la mémoire des crises. Si les jeunes Marocains, Malgaches et Népalais osent occuper la rue massivement, les jeunes Ivoiriens restent partagés entre l’envie d’exprimer leur ras-le-bol et la crainte de replonger le pays dans un cycle de violences. Cette ambivalence pourrait expliquer pourquoi une contestation ivoirienne serait probablement plus numérique que physique, plus diffuse et moins structurée qu’un mouvement comme GenZ212.
Un message d’apaisement nécessaire
L’analyse des mobilisations de jeunesse dans le monde montre une chose : les frustrations ignorées finissent toujours par se transformer en contestation. La Côte d’Ivoire doit en tirer les leçons. La jeunesse a besoin d’être écoutée, intégrée et valorisée, non réprimée ou stigmatisée.
Mais la jeunesse elle-même porte une responsabilité : celle de faire entendre sa voix de manière pacifique et constructive. Les réseaux sociaux ne doivent pas devenir des armes de division ou des relais d’ingérences étrangères. Ils doivent au contraire servir d’espaces de débat, d’innovation et de proposition.
À l’approche du scrutin d’octobre, il est crucial que les jeunes Ivoiriens privilégient le calme et la responsabilité. L’avenir du pays dépend de leur capacité à transformer la colère légitime en force de proposition, et non en spirale de chaos.
Fleur Kouadio
Rédactrice en chef – Cap Ivoire Info

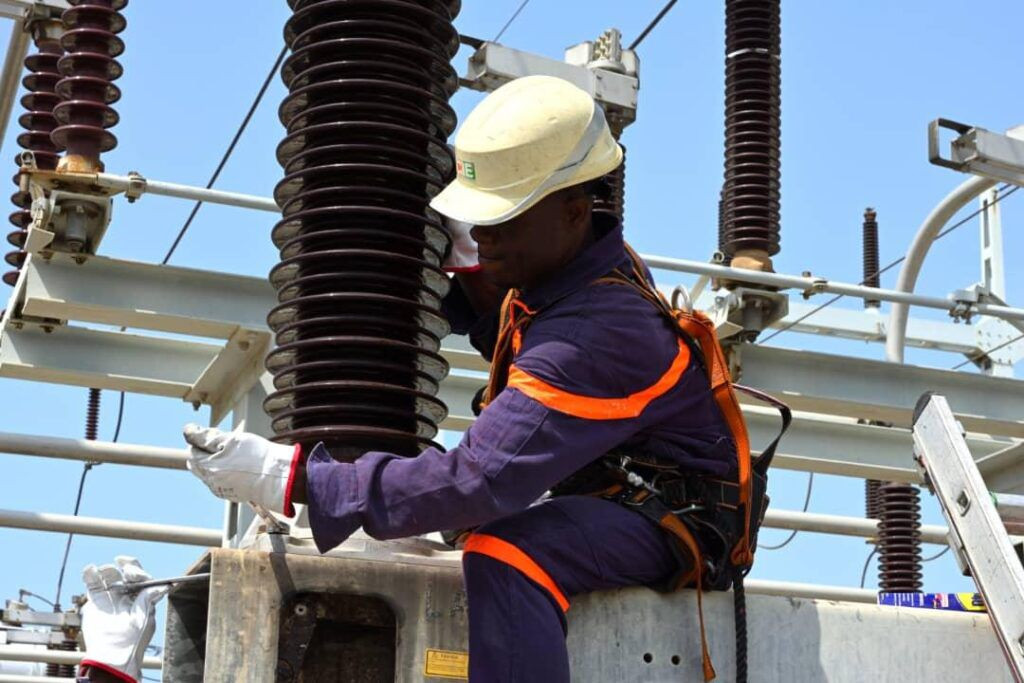



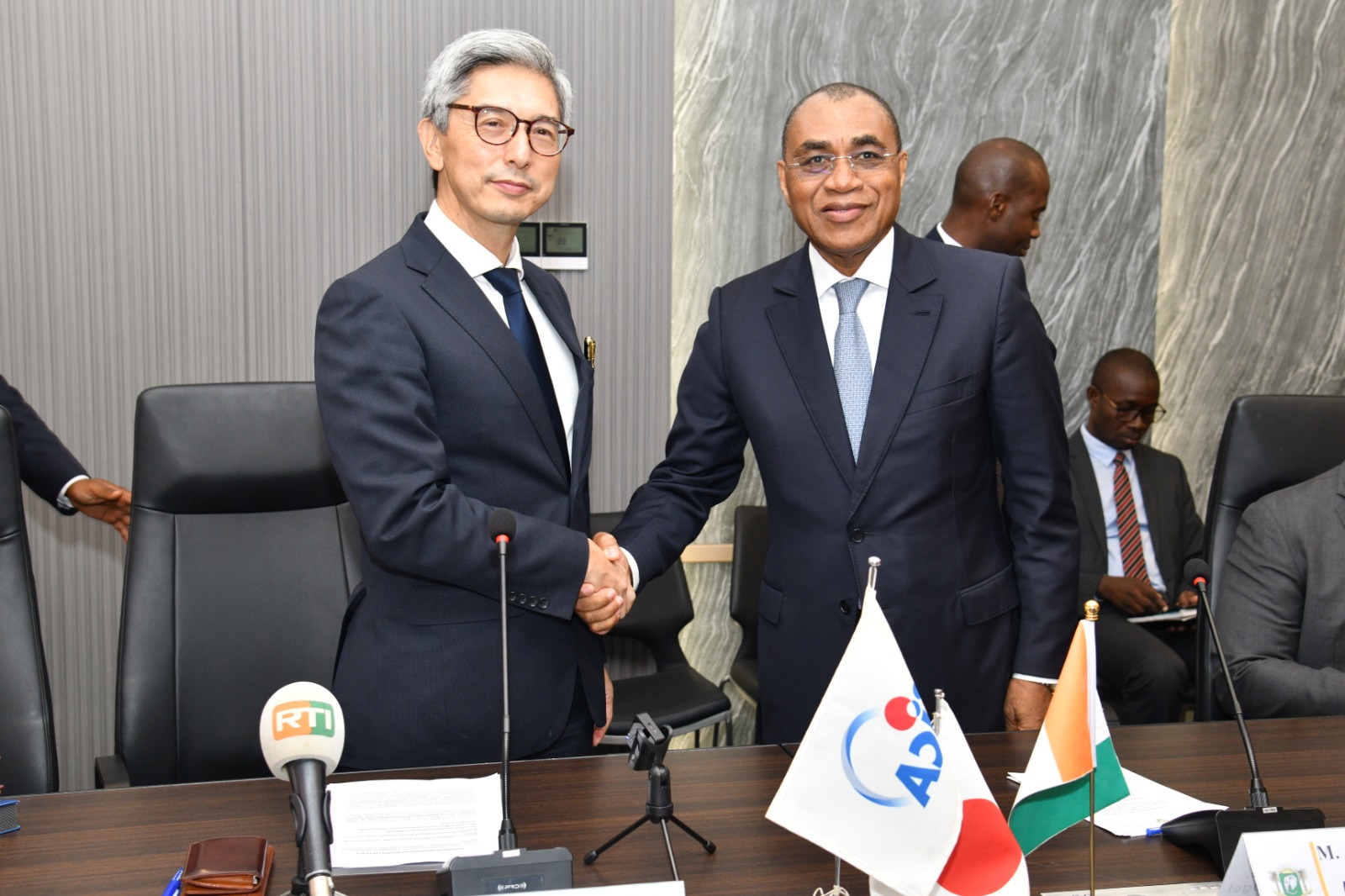

Commentaires Facebook