Le Sahel, autrefois présenté comme l’épicentre de la lutte contre le terrorisme, est devenu aujourd’hui le théâtre d’une rivalité stratégique entre les États-Unis et la Russie. Derrière le vernis des discours « anti-coloniaux », l’Afrique s’enfonce dans une nouvelle guerre par procuration, où les grandes puissances se disputent l’influence et les ressources, sans considération réelle pour les populations locales.
Washington revient à Bamako
Le 14 septembre dernier, The Washington Post révélait que les États-Unis avaient discrètement entamé des discussions avec la junte malienne sur la coopération antiterroriste. Une série de visites officielles a confirmé ce rapprochement : délégations du Congrès, rencontres diplomatiques, et échanges militaires après cinq ans d’interruption.
Ce revirement illustre une évidence : Washington ne cherche pas tant à combattre le terrorisme qu’à reconquérir un terrain occupé désormais par la Russie.
De la France à la Russie : un faux départ colonial
En 2022, Bamako avait réussi à forcer le départ de l’armée française, présentée comme une « victoire anti-coloniale ». Mais à peine les troupes françaises parties, les mercenaires russes du groupe Wagner ont pris leur place. Loin de représenter une libération, ce remplacement n’a fait que substituer une tutelle par une autre.
Les accusations de violations massives des droits humains contre les forces maliennes, épaulées par Wagner, se multiplient : exécutions sommaires, disparitions forcées, fosses communes. Dans le même temps, les sociétés russes étendent leur contrôle sur l’or malien, privant les populations locales des bénéfices de leurs richesses.
Les Américains séduits par le « pragmatisme »
Face à ce basculement, Washington tente désormais de courtiser le général Assimi Goïta, pourtant issu de deux putschs successifs et investi d’un mandat présidentiel sans élection. La condamnation initiale des coups d’État a cédé la place à un « pragmatisme » géopolitique dicté par la peur de perdre du terrain face à Moscou.
Les Africains, grands perdants
Dans ce bras de fer, ni Washington ni Moscou ne se préoccupent des droits, des libertés ou de l’avenir démocratique des Maliens. L’argument sécuritaire, qu’il soit brandi par Paris, Moscou ou Washington, n’a fait que renforcer la militarisation, la corruption et la dépendance.
Un phénomène régional
Le cas malien illustre une dynamique plus large. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré suit une trajectoire similaire, se rapprochant de Moscou au nom de la souveraineté, mais au prix d’une fragilisation croissante de l’État et d’un isolement diplomatique.
Conclusion
Derrière les slogans de libération et les promesses de sécurité, le Sahel s’installe comme l’un des champs majeurs de la nouvelle guerre froide. Les Africains, eux, restent les otages d’une confrontation qui ne dit pas son nom : une guerre par procuration où leurs vies, leurs terres et leurs ressources sont les véritables enjeux.
Avec Tafi Mhaka
Al Jazeera columnist






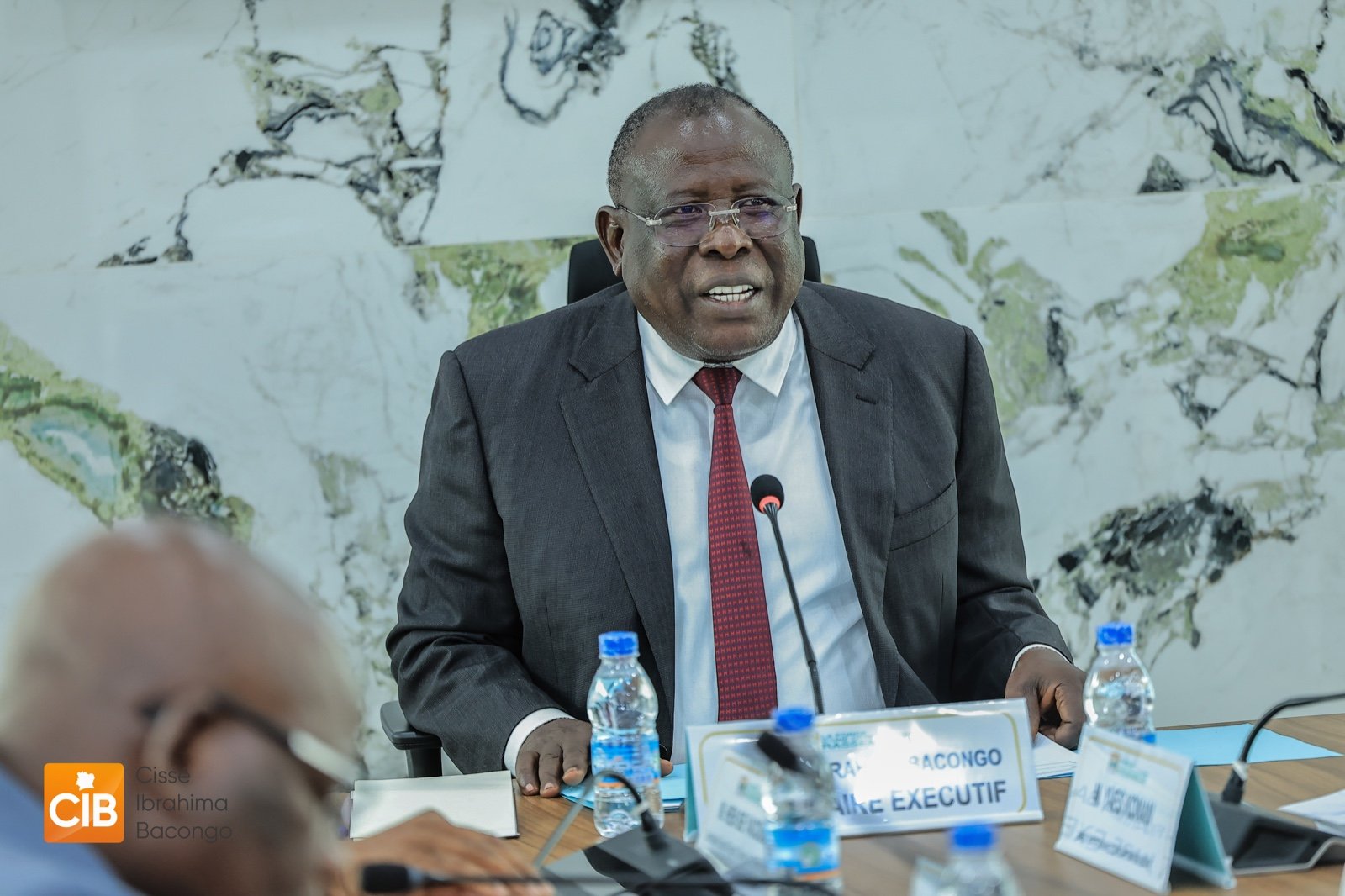
Commentaires Facebook