La démocratie n’est pas une dévotion, encore moins une adoration. C’est une exigence de débat, de contradiction, de remise en cause. C’est, surtout, la capacité d’un groupe humain à faire vivre la vérité, même quand elle dérange. Pourtant, une certaine manière de militer en Côte d’Ivoire semble ignorer cette réalité. Il suffit de regarder ce qui se passe autour de Laurent Gbagbo et de ses partisans les plus intransigeants, ceux qu’on appelle les « Gbagbo ou Rien » (GOR).
Quand quelqu’un critique Emmanuel Macron, Alassane Dramane Ouattara, Tidjane Thiam, Pascal Affi N’Guessan, Simone Ehivet Gbagbo ou encore Ahoua Don Mello, et qu’en parallèle il dit du bien de Laurent Gbagbo, les GOR applaudissent à tout rompre. Ils crient au courage, à la lucidité, à l’honnêteté intellectuelle. Mais il suffit que cette même personne ose poser une question sur une décision de Gbagbo, ou dénonce une incohérence dans ses propos, pour que le même camp se retourne contre lui avec une virulence inquiétante. D’un héros, il devient traître. D’un compagnon de route, il devient un infiltré. D’un intellectuel engagé, il devient un vendu.
Où est donc passée la pensée politique ? Où est passée la vision démocratique que des hommes comme Harris Memel-Fotê, Barthélemy Kotchy, Mamadou Koulibaly, Zacharie Séry Bailly ou d’autres ont voulu incarner au sein du Front Populaire Ivoirien (FPI) ? N’avons-nous pas collectivement trahi l’héritage intellectuel qui devait être la boussole du combat démocratique en Côte d’Ivoire ?
Quand aimer devient interdire la critique
Il est devenu presque impossible, dans certains cercles militants, d’exprimer un désaccord avec Laurent Gbagbo sans être immédiatement suspecté de trahison. Pourtant, ceux qui critiquent Gbagbo aujourd’hui sont parfois ceux qui, hier, ont risqué leur sécurité pour défendre sa légitimité, ses idées, son combat. Je fais partie de ceux-là. Comme Théophile Kouamouo, Ferro Bally et bien d’autres, j’ai souvent pris la plume pour défendre l’ancien président, non pas par culte de la personnalité, mais par conviction politique. Mais aimer un homme politique ne signifie pas renoncer à l’exigence intellectuelle. Ce n’est pas le suivre aveuglément. Ce n’est pas s’interdire de penser autrement que lui.
Laurent Gbagbo est-il irréprochable ? Bien sûr que non. Est-il un gourou, dont la parole serait infaillible et définitive ? Non plus. Il n’a jamais revendiqué ce statut, et il serait profondément injuste de lui en prêter l’intention. Alors pourquoi certains de ses partisans veulent-ils lui construire ce piédestal de marbre, ce trône sacré où il ne serait plus qu’un chef vénéré, qu’on ne peut ni contredire ni corriger ?
Gbagbo n’a pas besoin de répondeurs automatiques
Je l’écris avec toute la clarté nécessaire: Laurent Gbagbo n’a pas besoin de militants qui parlent à sa place, qui étouffent le débat, qui agressent verbalement ceux qui osent poser des questions. Il n’a pas besoin de “soldats” de la parole, encore moins de censeurs en ligne. L’homme est historien, intellectuel, orateur. Il sait manier la plume, il connaît le poids des idées.
D’ailleurs, il l’a dit lui-même: lorsqu’il était président, face à la critique d’un journaliste, sa réponse ne fut pas la prison, mais le débat. Cette déclaration, au-delà de son élégance, révélait une posture politique. Il n’y a pas de démocratie sans critique. Il n’y a pas de République sans contradiction.
Aujourd’hui encore, je sais que mes textes peuvent arriver jusqu’à lui. Pascal Dago Kokora, cofondateur du FPI et ancien ambassadeur de Côte d’Ivoire à Washington, m’a récemment confié qu’il les lui faisait suivre. Si ce que j’écris lui déplaît, je suis convaincu qu’il saura me répondre avec ses mots, son style, son intelligence. Il n’a pas besoin qu’on se batte en son nom pour des désaccords d’idées.
L’oubli du projet intellectuel de Memel-Fotê
Dans le texte fondateur du Front Populaire Ivoirien, Harris Memel-Fotê, intellectuel rigoureux et humaniste, avait posé une exigence: le parti devait être ouvert à la critique et à l’autocritique. Cette ouverture n’était pas un luxe, mais une condition de survie politique. Memel-Fotê savait que les partis qui ne chantent que les louanges du chef deviennent des machines bureaucratiques, voire des sectes politiques.
Un parti sans critique devient sourd. Il se coupe du peuple, de la réalité, de la dynamique historique. Un parti sans autocritique finit par justifier toutes les fautes, toutes les incohérences, toutes les dérives. Or, chacun de nous a ses contradictions. Laurent Gbagbo aussi. Et c’est normal. C’est humain.
L’incohérence de l’âge: un exemple concret
Un exemple suffit à illustrer ce que certains refusent de voir. Gbagbo avait déclaré qu’à 75 ans, un homme ne devrait plus briguer la magistrature suprême. Cette phrase avait marqué les esprits, car elle témoignait d’un désir de renouvellement, d’un sens du devoir historique. Mais, aujourd’hui, à 80 ans passés, il veut redevenir président.
Peut-on faire comme si cette contradiction n’existait pas ? Peut-on ne pas la voir ? Peut-on, surtout, interdire à quiconque de la relever ?
Pourquoi les GOR refusent-ils ce débat ? Pourquoi cette crispation, cette agressivité envers quiconque ose dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas ? Cette incohérence n’efface en rien le parcours remarquable de Gbagbo. Mais elle mérite d’être discutée. Elle appelle des explications, des arguments, pas des insultes. La liberté d’expression, ce n’est pas que pour les autres. On ne peut pas réclamer la démocratie, la liberté de la presse, la liberté d’expression – comme l’a fait avec constance Laurent Gbagbo – et, en même temps, refuser ces mêmes libertés au sein de son propre camp. Cela s’appelle du deux poids deux mesures. Cela s’appelle du sectarisme. Or, à bien des égards, certains GOR se comportent aujourd’hui comme ce qu’ils critiquent chez les “Adomoutons” – ces militants inconditionnels du pouvoir en place. Même refus de la contradiction. Même défense aveugle du chef. Même volonté d’écraser la critique au nom de l’unité du camp.
Mais l’unité fondée sur le silence est une illusion. Elle cache les failles, mais ne les guérit pas. Elle enterre les débats, mais ne résout rien. La vraie unité politique se construit sur des discussions franches, sur des confrontations d’idées, sur une capacité collective à évoluer.
Quelle culture politique voulons-nous ?
Ce que nous devons reconstruire, c’est une culture politique. Une manière d’être citoyen, d’être militant, d’être acteur de la démocratie.
Cette culture-là ne peut pas être fondée sur la peur de critiquer, sur l’obligation de dire « amen » à tout, sur la paranoïa envers les voix dissidentes. Elle doit être fondée sur le respect de la pensée libre, sur l’ouverture d’esprit, sur la recherche de cohérence entre les principes qu’on défend et les comportements qu’on adopte.
Aimer Gbagbo, ce n’est pas l’adorer. Ce n’est pas le sanctifier. C’est lui faire confiance quand on n’est pas d’accord avec lui. C’est croire qu’il est assez grand pour entendre des critiques, pour y répondre, pour évoluer. C’est croire que son projet n’est pas de se faire applaudir, mais de construire un pays où chacun peut parler sans crainte.
Il est temps de faire honneur à la mémoire de Memel-Fotê. Il est temps de retrouver l’esprit critique qui animait les débuts du FPI. Il est temps de montrer que les partisans de Gbagbo ne sont pas des fanatiques, mais des citoyens responsables, capables de discernement.
Ce texte n’est pas un réquisitoire. Il est une alerte fraternelle, un appel à la maturité politique, un plaidoyer pour la cohérence. Il n’est dirigé contre personne, mais adressé à tous ceux qui croient encore que la démocratie est un bien commun, pas une guerre de tranchées.
Et si jamais Laurent Gbagbo me lit, grâce à Pascal Kokora ou autrement, qu’il sache ceci: ce n’est pas contre lui que j’écris, c’est pour lui. Pour qu’il sache que nous sommes nombreux à continuer de croire en sa parole, justement parce qu’elle acceptait la contradiction.
Alors, GOR, reprenez le flambeau du débat. Ne soyez pas les geôliers de la critique. Soyez, comme vos aînés, les bâtisseurs d’une pensée politique vivante.
Jean-Claude DJEREKE






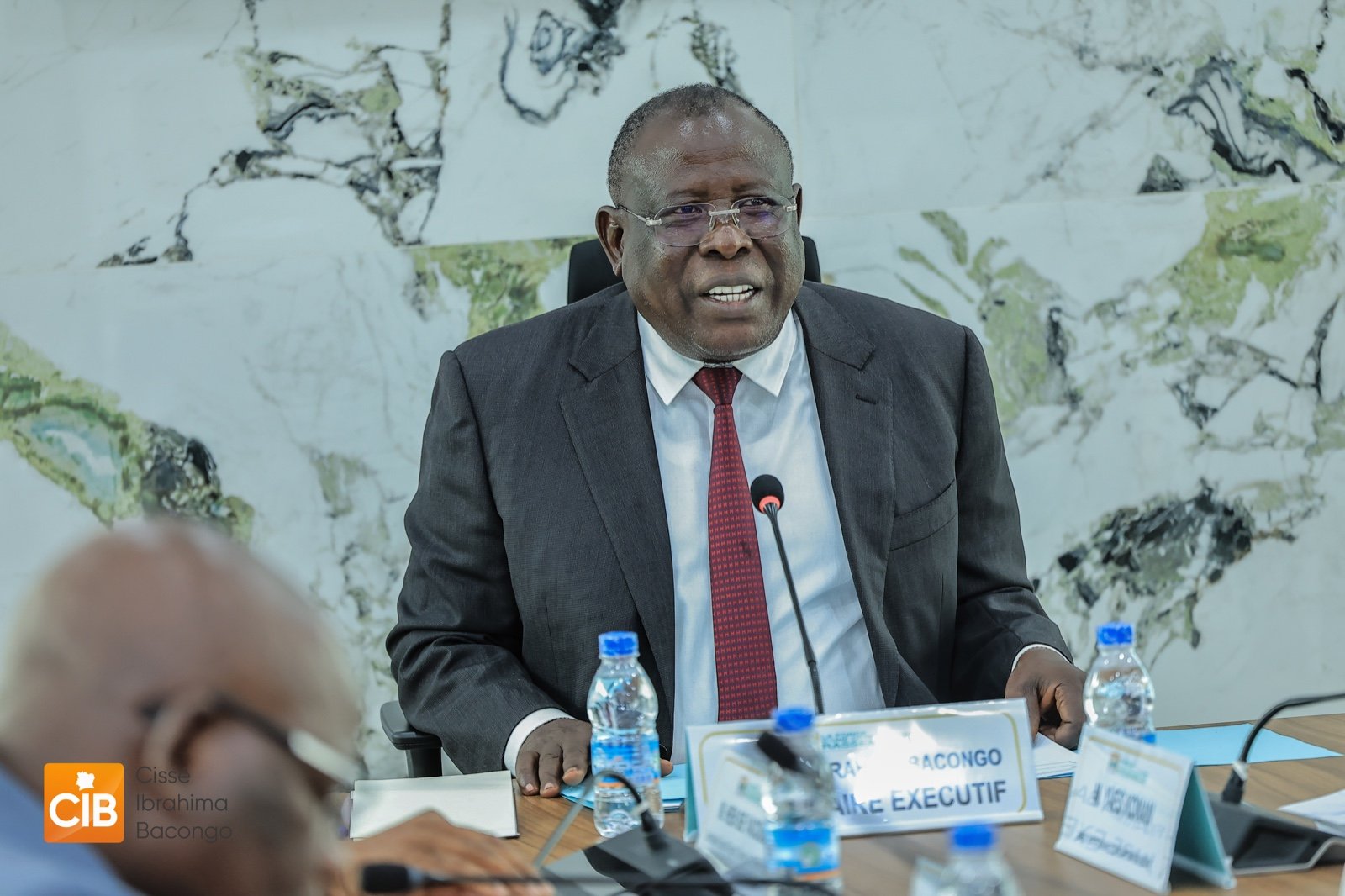
Commentaires Facebook