
Le 16 septembre 2023, Bamako, Ouagadougou et Niamey annonçaient la création de l’Alliance des États du Sahel (AES) à travers la Charte du Liptako-Gourma. Présentée comme un outil de rupture et de souveraineté, l’AES fête aujourd’hui son deuxième anniversaire. Mais deux ans après, que reste-t-il des promesses sécuritaires, économiques et diplomatiques qui avaient nourri cette initiative ?
Sécurité : l’ennemi toujours présent
La première mission de l’AES était claire : unir les forces des trois armées pour reprendre l’initiative face aux groupes djihadistes. En janvier 2025, Niamey a annoncé la création d’une force conjointe de 5 000 hommes, censée opérer au-delà des frontières nationales. Dans les discours, cette montée en puissance devait marquer un tournant.
Dans la réalité, la dynamique reste fragile. Depuis le départ définitif de la MINUSMA fin 2023, les armées malienne, burkinabè et nigérienne, épaulées par les combattants russes du groupe Africa Corps, ont multiplié les offensives. Mais les résultats sont loin de correspondre aux annonces officielles. Les attaques continuent de frapper Tillabéri au Niger, le Gourma au Burkina ou encore le centre du Mali. Les populations civiles restent prises en étau, avec plus de trois millions de déplacés internes recensés dans le Sahel central.
À deux ans, l’AES n’a pas encore démontré sa capacité à réduire significativement la menace djihadiste. Elle a certes renforcé la coordination militaire, mais les groupes liés à al-Qaïda et à l’État islamique maintiennent une forte capacité de nuisance.
Économie : souveraineté affirmée, risques accrus
Le deuxième pilier de l’alliance a été la souveraineté économique. Chacun des trois États a entrepris de reprendre le contrôle de ses ressources. Le Niger a frappé fort en juin 2025 en nationalisant la Somaïr, société d’uranium exploitée par le français Orano. Le Burkina Faso a adopté un nouveau code minier et multiplié les nationalisations dans l’or. Le Mali, en difficulté budgétaire, s’est rapproché du Fonds monétaire international pour stabiliser ses finances.
Certains succès sont indéniables. Le pipeline Niger-Bénin a permis au Niger de commencer à exporter son pétrole dès mai 2024, dopant ses recettes publiques. Mais ces avancées se heurtent à des fragilités : insécurité des corridors, tensions diplomatiques avec les pays voisins, retrait d’investisseurs internationaux inquiets des nationalisations et instabilité chronique dans certaines zones minières.
À cela s’ajoute une crise alimentaire persistante. Selon les agences humanitaires, plus de 50 millions de personnes sont en insécurité alimentaire aiguë en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, dont une large partie dans les pays de l’AES.
Diplomatie : rupture avec la CEDEAO, dépendance à Moscou
La rupture avec la CEDEAO constitue sans doute l’acte le plus fort de ces deux années. Le 29 janvier 2025, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont annoncé leur retrait définitif de l’organisation régionale. Ils avaient déjà suspendu leur participation, mais ce départ formel scelle une fracture profonde avec leurs voisins ouest-africains.
En parallèle, les trois États ont proclamé en juillet 2024 la naissance de la Confédération des États du Sahel, étape symbolique dans leur volonté d’intégration politique. Sur le terrain diplomatique, ils ont aussi multiplié les gestes en direction de la Russie, désormais partenaire militaire et politique privilégié. Moscou s’impose ainsi comme parrain majeur de l’AES, là où la France et l’Union européenne ont perdu du terrain.
Cette dépendance accrue pose toutefois question. En cherchant à s’émanciper des tutelles occidentales, les régimes militaires du Sahel n’ont-ils pas simplement remplacé une influence par une autre ? L’autonomie stratégique affichée semble, pour l’heure, relative.
Un pari encore incertain
Deux ans après sa naissance, l’AES a réussi son pari symbolique : exister comme front commun de souveraineté et affirmer une alternative à la CEDEAO. Mais son bilan concret reste mitigé. La sécurité ne s’est pas améliorée de manière notable, les économies restent fragiles malgré de nouvelles recettes pétrolières ou minières, et la diplomatie repose largement sur un seul partenaire extérieur.
Au fond, l’AES se trouve à la croisée des chemins. Soit elle parvient à transformer son discours en résultats tangibles sur la sécurité et le développement, soit elle restera une construction politique davantage portée par l’idéologie de rupture que par des résultats durables. L’avenir dira si ce pari sera payant pour les populations du Sahel, ou s’il ne fera qu’ajouter une couche d’incertitude dans une région déjà éprouvée.
F. Kouadio
Cap’Ivoire Info / @CapIvoire_Info



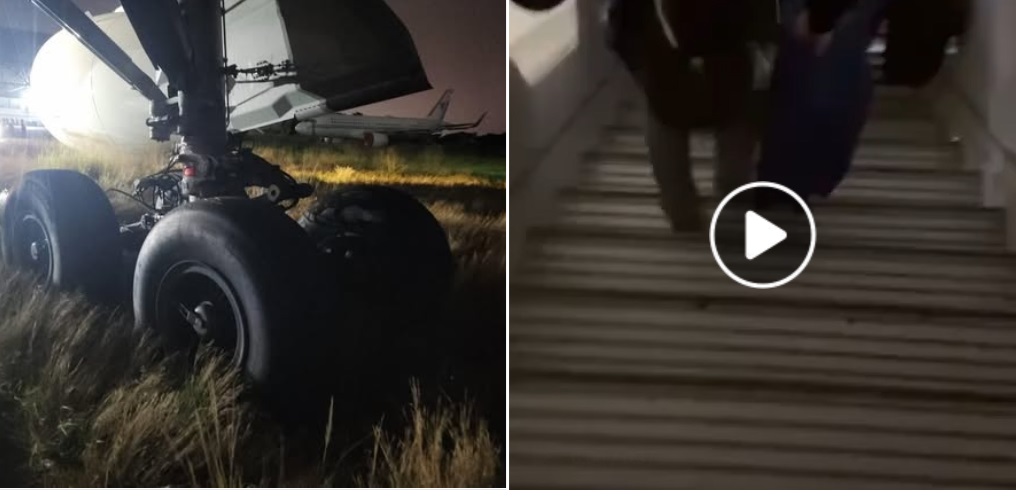
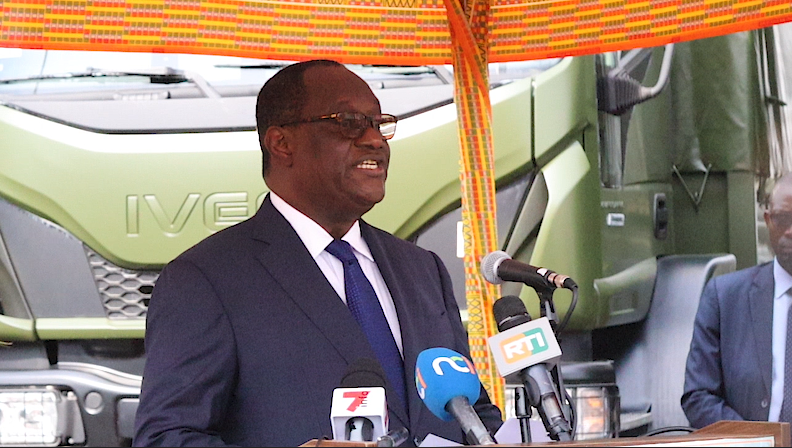
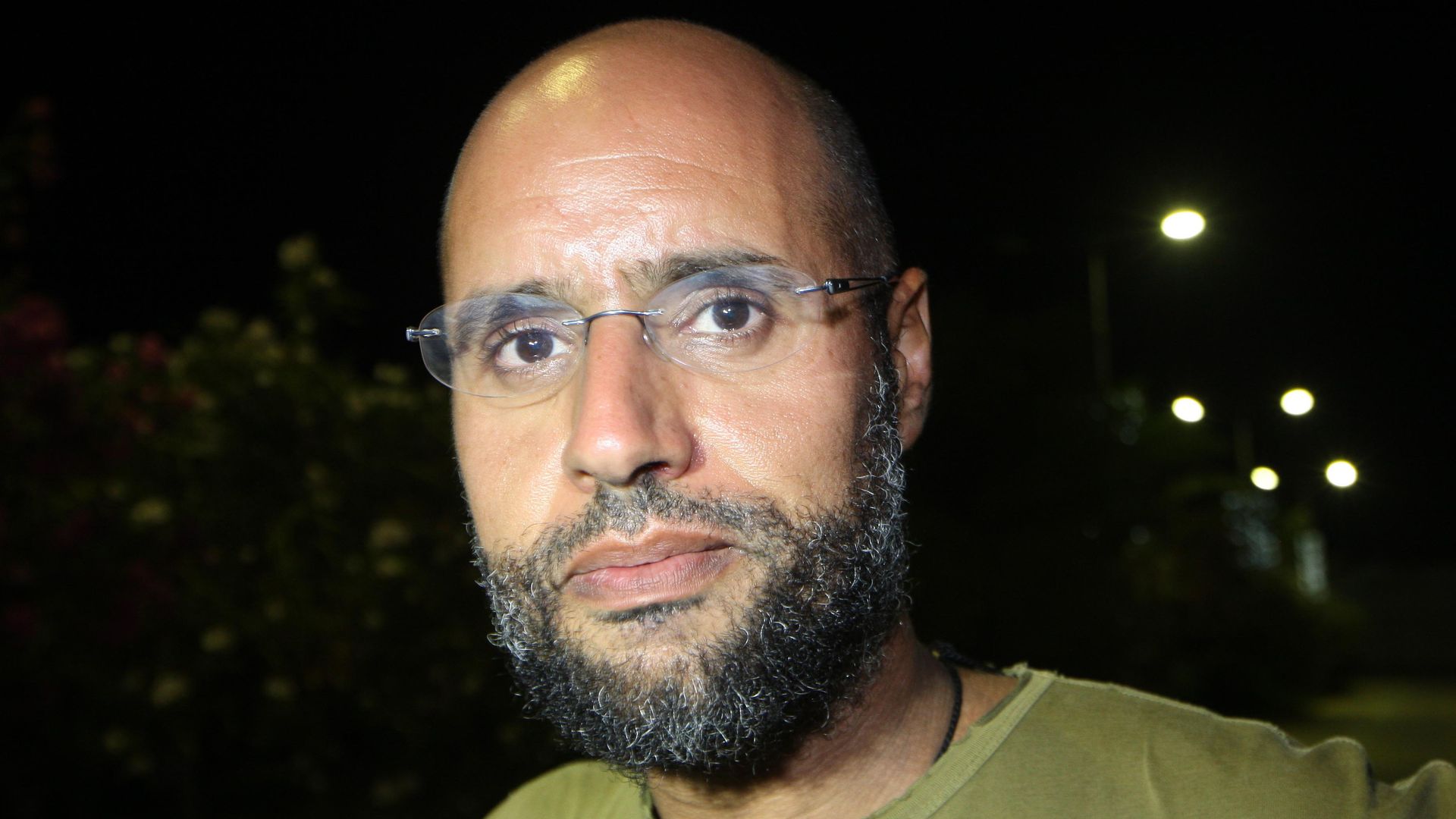

Commentaires Facebook