Par Fleur Kouadio

Le 15 avril 2023, le Soudan a basculé dans une nouvelle guerre civile, la quatrième de son histoire récente. Ce conflit oppose les Forces armées soudanaises (FAS), dirigées par le général Abdel Fattah al-Burhan, aux Forces de soutien rapide (FSR), menées par Mohamed Hamdan Dagalo, dit « Hemedti ». Derrière ce duel fratricide, une guerre plus large se joue : celle des influences étrangères, transformant le pays en champs de bataille géopolitique.
Selon l’ONU, la guerre a déjà provoqué plus de 150 000 morts, forcé 12 millions de civils à fuir et plongé plus de 25 millions de personnes dans la famine. Une tragédie humaine dont les grandes puissances, régionales comme internationales, semblent se soucier bien moins que de leurs propres intérêts stratégiques et économiques.
Les Émirats arabes unis : l’ombre des mercenaires
Les Émirats arabes unis sont considérés comme les parrains des FSR. Drones, armes légères, mercenaires colombiens et assistance médicale : la liste des soutiens est longue. En juin 2023, les autorités ougandaises interceptaient un avion-cargo en provenance des Émirats, officiellement rempli d’aide humanitaire mais en réalité chargé de fusils d’assaut.
De plus, des territoires frontaliers comme le Tchad et la Libye sont utilisés comme plateformes logistiques, où des centres humanitaires détournés servent d’hôpitaux militaires et de pistes d’atterrissage. Malgré les dénégations d’Abou Dhabi, des passeports émiratis ont été retrouvés sur des zones de combat à Khartoum.
Moscou : entre or et bases stratégiques
Présent depuis 2018 via Wagner et la société Meroe Gold, le Kremlin a exploité les mines d’or du Darfour selon une logique désormais bien rodée : sécurité contre ressources. Depuis la transformation de Wagner en Africa Corps, la Russie a réajusté sa position, se rapprochant des FAS pour sécuriser un accès à Port-Soudan, sur la mer Rouge.
Ce repositionnement s’explique par un double objectif : garantir ses intérêts aurifères et empêcher un rapprochement trop visible entre les FAS et l’Ukraine, qui fournit discrètement drones et soutien militaire. Dans cette logique opportuniste, Moscou illustre une fois encore sa capacité à changer d’alliances en fonction de ses besoins stratégiques.
L’Arabie saoudite : de la médiation à la prise de parti
Initialement médiateur, Riyad s’est progressivement aligné sur les FAS. Les raisons tiennent à la sécurité de la mer Rouge et à ses ambitions économiques, notamment autour du gigantesque projet NEOM. Craignant une vague migratoire incontrôlée ou un regain de piraterie, le Royaume voit dans le soutien aux forces régulières soudanaises un moyen de stabiliser la région et de contrer à la fois l’influence iranienne et les ambitions de son rival émirati.
Le paradoxe est frappant : les deux alliés traditionnels du Golfe, Arabie saoudite et Émirats arabes unis, se retrouvent engagés dans des camps opposés, révélant des fractures croissantes au sein de la péninsule arabique.
L’Iran : un pied en mer Rouge
Depuis octobre 2023, Téhéran a resserré ses liens avec Khartoum, misant sur un partenariat militaire avec les FAS. L’Iran fournit des armes en échange d’un point d’ancrage stratégique à Port-Soudan, d’où il peut surveiller Israël et le canal de Suez. Ce rapprochement s’inscrit dans une logique d’affrontement indirect avec Riyad et Washington, tout en renforçant sa présence dans la Corne de l’Afrique.
La Turquie : une diplomatie pragmatique
Ankara, qui avait d’abord tenté un rôle de médiateur, s’est finalement rapprochée des FAS. Des armes et des drones turcs, souvent acheminés via l’Égypte, leur sont désormais livrés. La Turquie cherche à consolider son implantation économique au Soudan et à renforcer son influence en Afrique de l’Est et dans la mer Rouge. Ce choix illustre une stratégie d’expansion mesurée, où la diplomatie s’accompagne toujours d’un volet militaire.
Un conflit régionalisé
Si les grandes puissances se livrent à une guerre par procuration au Soudan, elles ne sont pas seules en cause. Les voisins immédiats – Tchad, Libye, Égypte, Éthiopie, Érythrée – jouent aussi un rôle central. Entre logistique, trafic d’armes, appuis politiques ou calculs frontaliers, chacun contribue à prolonger un conflit où la population civile est la première victime.
Le prix du sang soudanais
Au-delà des ambitions géopolitiques, une évidence demeure : ce sont les Soudanais qui paient le prix de cette guerre. Les deux généraux se battent pour le pouvoir, tandis que les puissances étrangères défendent leurs intérêts économiques et stratégiques. Dans ce jeu macabre, la famine, les massacres et l’exode des civils deviennent presque invisibles.
La guerre au Soudan n’est donc pas seulement une confrontation entre Burhan et Hemedti. Elle est devenue le miroir des rivalités régionales et internationales. Une tragédie où les alliances se font et se défont, mais où la souffrance du peuple, elle, reste constante.
F. Kouadio
Cap’Ivoire Info / @CapIvoire_Info


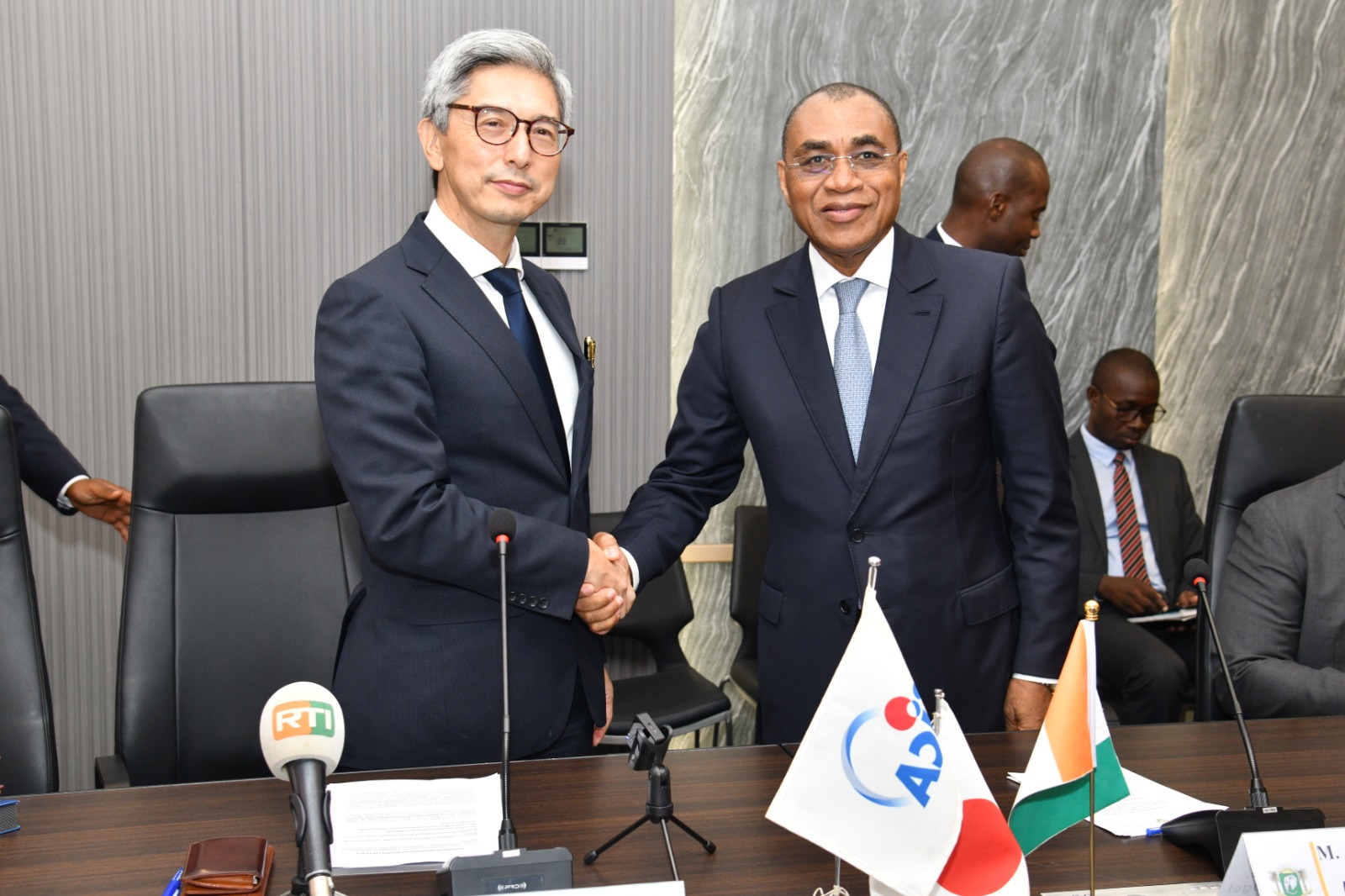

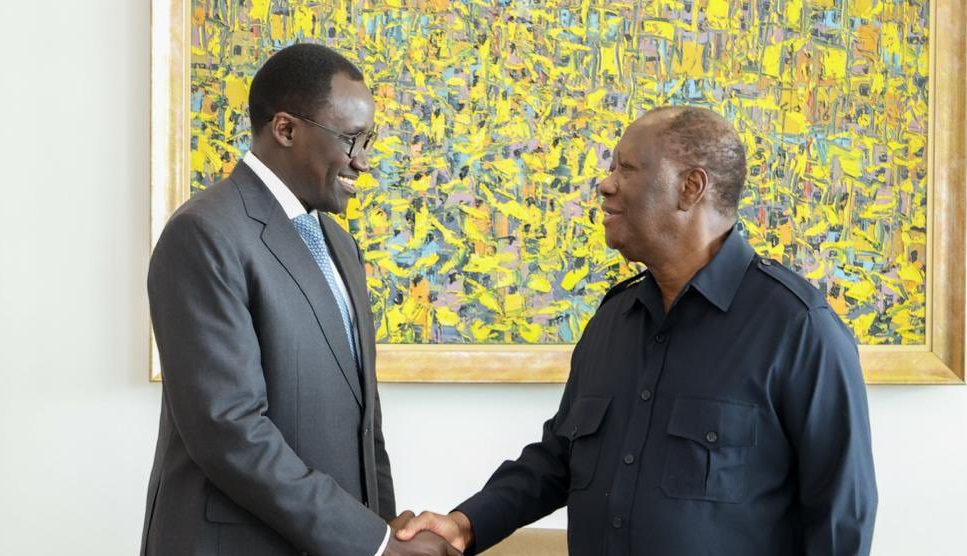


Commentaires Facebook