Par Fleur Kouadio
Aujourd’hui, face aux problématiques sécuritaires dans la région sahélienne, nous ne pouvons pas nous empêcher de poser une question simple : que deviendra la Côte d’Ivoire et les pays frontaliers, si les juntes de l’Alliance des États du Sahel (AES) échouent à contenir la menace djihadiste ?
La junte malienne détourne-t-elle le regard ?
Le 14 août dernier, la junte malienne a annoncé l’arrestation de plusieurs militaires et d’un citoyen français présenté comme un agent de la DGSE. Mais s’agissait-il réellement d’une “tentative de coup d’État” déjouée, ou bien d’une nouvelle purge interne visant à faire taire des officiers critiques ? Et si ce coup de filet n’était qu’un moyen de détourner l’attention après les récentes défaites militaires ?
Faut-il voir une stratégie de survie politique plutôt qu’une véritable défense de la nation ? Au lieu de concentrer ses efforts sur la lutte contre les djihadistes, Bamako préfère-t-il inventer des ennemis extérieurs pour rallier ses partisans ? Et à quel prix ? Cette situation, ne fait-elle pas au contraire accroître la vulnérabilité du Mali… et par ricochet celle de la Côte d’Ivoire ? Pourquoi la junte ne demande-t-elle pas l’aide des pays voisins dans cette affaire, pour une cause commune qui est la lutte contre les djihadistes.
L’hypocrisie des alliances à géométrie variable
Il faut ajouter à cette mise en scène, l’hypocrisie des régimes de l’AES. Hier, c’était la France l’ennemi désigné, aujourd’hui ce sont les États-Unis qui frappent à la porte avec des promesses de coopération sécuritaire et économique. En juillet, Bamako accueillait des délégations américaines, alors même que Washington avait été accusé en 2023 de vouloir déstabiliser la junte.
Cette diplomatie opportuniste, qui change de partenaire au gré des intérêts de court terme, ne règle en rien le problème de fond : les populations continuent de mourir sous les balles des terroristes, et les pays voisins comme la Côte d’Ivoire voient s’accumuler les risques.
La faillite sécuritaire du Sahel : une menace directe pour Abidjan
Depuis plusieurs années, les groupes armés djihadistes grignotent du terrain au Mali, au Burkina Faso et au Niger, malgré les promesses des régimes militaires arrivés au pouvoir. Ces derniers ont multiplié les opérations et les slogans, souvent en se réclamant du soutien russe, mais sans résultats significatifs. Les récentes attaques, notamment dans le centre et le nord du Mali, ont fait des dizaines de victimes parmi les civils et les militaires, démontrant une incapacité persistante à sécuriser les territoires.
Pour les Ivoiriens, l’enjeu est vital. La frontière nord, longue et poreuse, est directement exposée. Déjà, des infiltrations ont eu lieu dans le Bounkani et le Tchologo, rappelant que le terrorisme n’a pas de frontières. L’échec de l’AES face aux groupes armés ne se limiterait pas à un problème malien, burkinabè ou nigérien : il signifierait une extension quasi automatique de l’instabilité sur notre sol et au-delà en Afrique de l’Ouest.
Flux migratoires et tensions sociales
La guerre du Sahel a déjà poussé des centaines de milliers de personnes à fuir. La Côte d’Ivoire accueille aujourd’hui environ 70 000 demandeurs d’asile maliens et burkinabè, un chiffre qui ne cesse de croître. Si l’AES s’enlise dans ses défaites, ce chiffre explosera, mettant une pression considérable sur nos infrastructures sociales : écoles, centres de santé, marchés du travail locaux.
À cela s’ajoute un risque latent : celui des tensions entre populations ivoiriennes et réfugiés. Lorsque les ressources se raréfient et que la concurrence pour l’emploi ou l’accès aux terres s’intensifie, les frustrations peuvent dégénérer. L’histoire récente du continent nous enseigne que ces tensions, si elles ne sont pas encadrées, peuvent devenir des foyers de violences communautaires.
Des répercussions économiques en chaîne
Au-delà du facteur sécuritaire et social, l’échec des juntes sahéliennes aurait un coût économique énorme pour la Côte d’Ivoire. Nos corridors commerciaux, qui relient Abidjan au Sahel, seraient fragilisés. Le port d’Abidjan, plaque tournante de la sous-région, dépend en partie du transit vers Bamako, Ouagadougou et Niamey. Si les routes sont coupées ou menacées, ce sont nos recettes douanières, nos transporteurs et nos commerçants qui paieront le prix fort.
L’agriculture ivoirienne, déjà confrontée aux aléas climatiques, verrait ses zones frontalières affaiblies par l’insécurité. Les exportations, vitales pour notre économie, seraient ralenties. En somme, la faillite sécuritaire de l’AES risquerait d’entraîner une contraction de nos échanges, une inflation accrue et une insécurité économique pour des milliers de familles ivoiriennes.
Quelle voie pour la Côte d’Ivoire ?
Abidjan sait que la solution durable ne peut être qu’une coopération régionale renforcée. Les pays de l’AES, malgré leurs postures politiques, doivent comprendre que leur survie dépendra aussi de la collaboration avec leurs voisins. Pour vaincre les groupes armés, il ne suffit pas de brandir un drapeau ou de désigner un bouc-émissaire. Il faut partager les renseignements, coordonner les patrouilles, et bâtir une stratégie commune avec la CEDEAO et l’ensemble des pays frontaliers.
Si l’AES échoue dans sa lutte contre les djihadistes, la Côte d’Ivoire sera en première ligne des répercussions : sécurité menacée, économie fragilisée, flux migratoires accrus, tensions sociales exacerbées. Mais nous ne sommes pas condamnés à subir.
Il faut convaincre nos voisins du Sahel que seule une solidarité régionale sincère peut sauver nos peuples. Car face au terrorisme, ni la propagande, ni les purges internes, ni les alliances de circonstance ne feront le poids.
F. Kouadio
Cap’Ivoire Info / @CapIvoire_Info

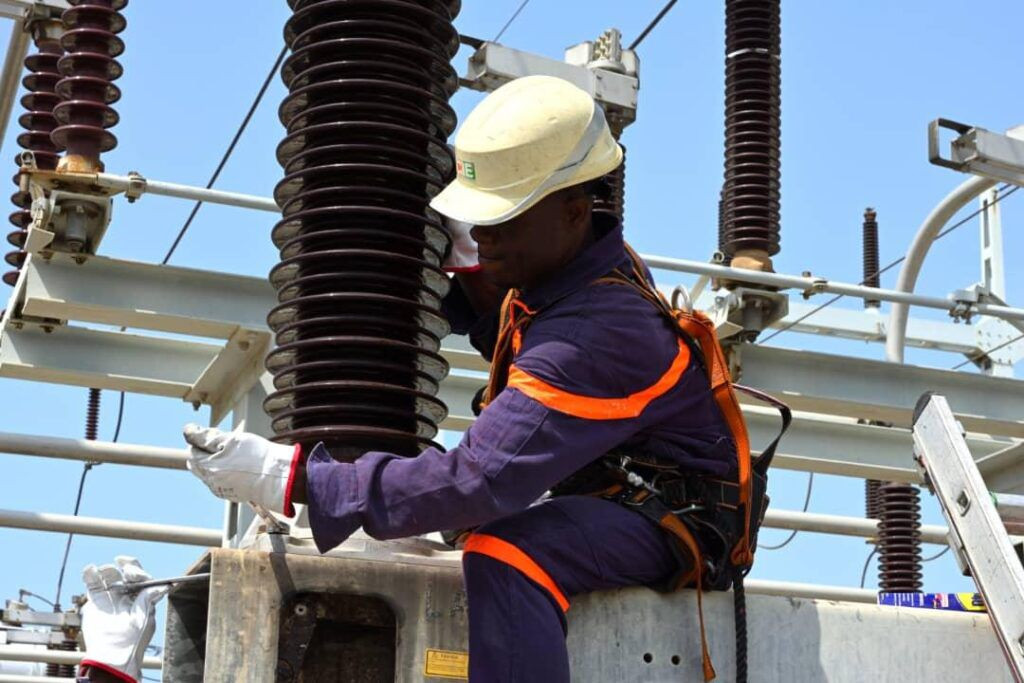



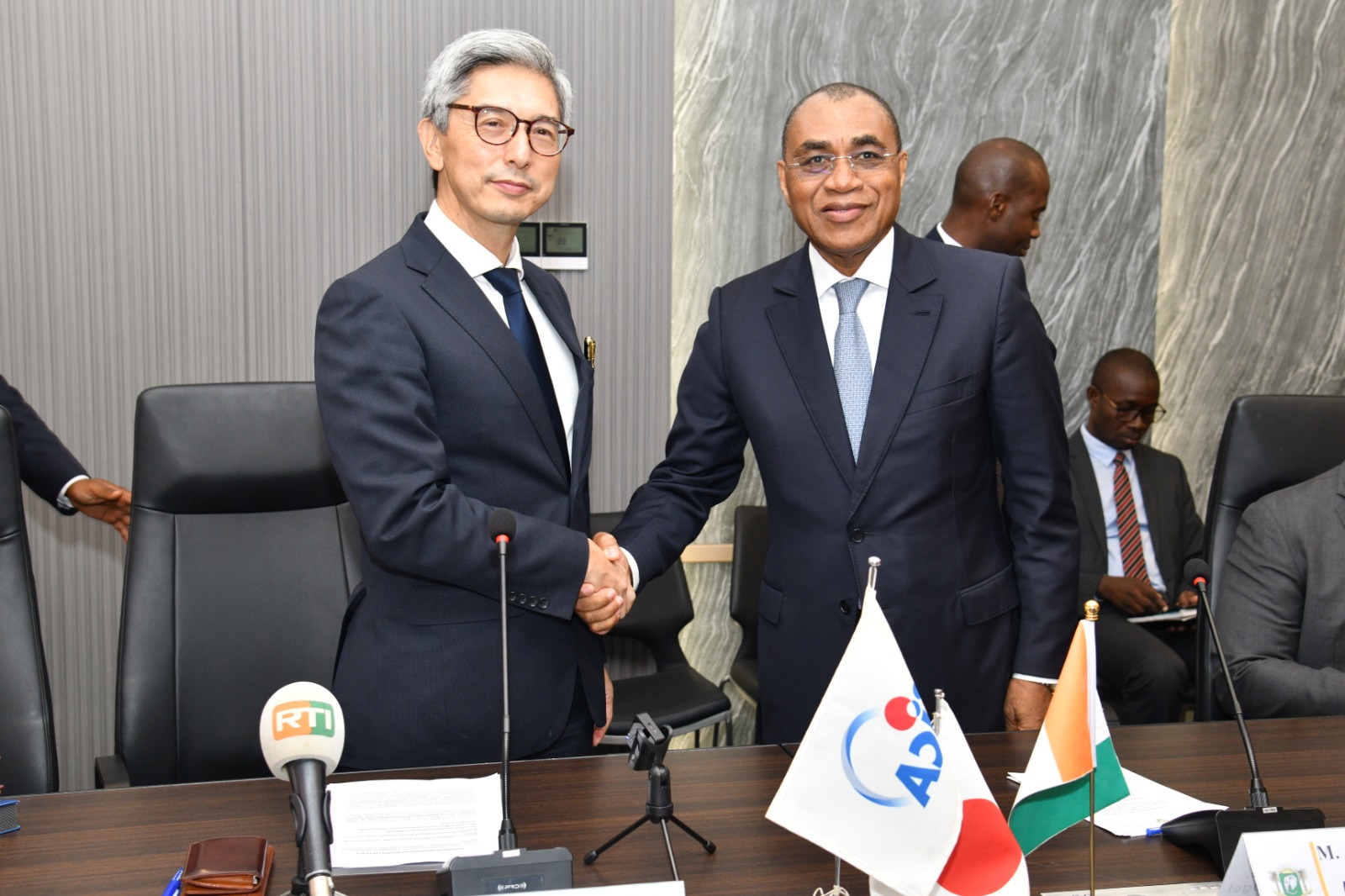

Commentaires Facebook