Promiscuité, vol de couette, coups de coude, ronflements… Partager son lit n’est pas toujours synonyme de repos. Pourtant, dans l’imaginaire collectif, faire chambre à part reste un tabou, souvent interprété comme un signe de mésentente conjugale.
Balzac, déjà en 1829, s’étonnait de cette habitude. Dans La Physiologie du mariage, il décrivait avec ironie les travers des dormeurs : « Il y a ceux qui laissent pendre leur bouche ouverte d’un air niais, d’autres qui ronflent à faire trembler les planchers. Beaucoup ressemblent à ces jeunes diables de Michel-Ange, tirant la langue pour se moquer des passants. » Et l’écrivain de s’interroger : par quel mystère avons-nous donc mis à la mode le lit conjugal, pratique « si fatale à l’amour-propre » ?
Un sport de combat nocturne
Au-delà du trait d’humour, les désavantages sont bien réels. Le sommeil partagé est souvent moins réparateur, et les tensions nocturnes s’invitent rapidement sous la couette. Qui n’a jamais subi ce partenaire qui roule vers soi, occupant la moitié du lit, recouvrant son voisin d’un bras ou d’une jambe jusqu’à le reléguer au bord du matelas ? Qui n’a pas pesté contre un pied glacé, une jambe qui gigote ou l’éclat bleuté d’un écran de téléphone inhibant la mélatonine ?
Des disputes fréquentes
Selon une étude IFOP publiée en 2021 pour le site Tousaulit.com, 68 % des couples cohabitants se sont déjà disputés à propos du « savoir-vivre au lit ». Près de la moitié de ces querelles éclatent après une salve de ronflements.
« Ma copine ronfle fort et beaucoup, témoigne Jules, libraire de 50 ans. Elle s’étouffe, elle a des râles, c’est crispant. C’est comme un robinet qui goutte : tu attends toujours la prochaine. Tu lui dis, elle se vexe. C’est d’autant plus énervant que, toi, tu n’arrives pas à fermer l’œil. »
Avec Lemonde.fr




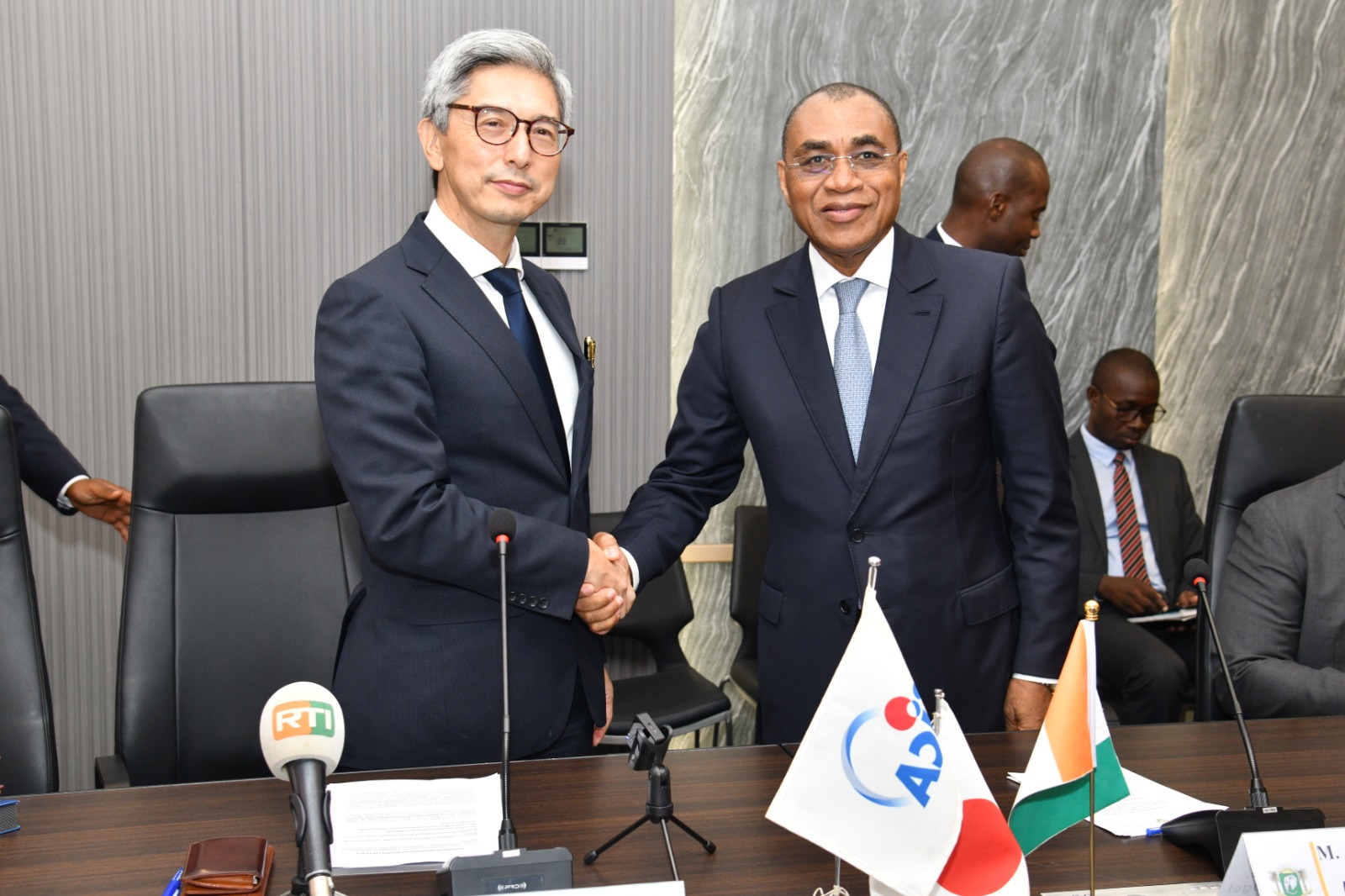

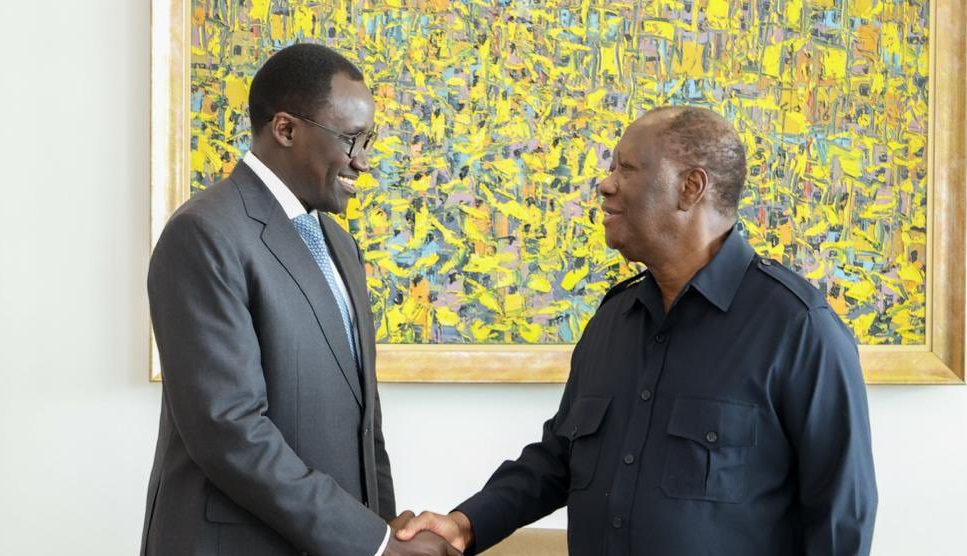
Commentaires Facebook