La climatisation s’impose peu à peu dans les foyers africains, notamment en Côte-d’Ivoire, portée par des chaleurs toujours plus accablantes. À Abidjan, Dakar, Lagos ou Accra, où le béton et la pollution exacerbent la sensation de fournaise, les journées deviennent étouffantes, les nuits suffocantes. Dans ce contexte, la climatisation apparaît comme un soulagement immédiat, presque vital pour nombre d’habitants. Elle devient synonyme de confort, parfois même de survie. Mais ce soulagement apparent dissimule une série de questions rarement posées de manière frontale.
Même alimentée à l’énergie solaire, la climatisation reste, dans sa conception actuelle, un risque écologique majeur. Les climatiseurs utilisent des gaz réfrigérants puissants, les HFC (hydrofluorocarbures), dont le pouvoir de réchauffement dépasse de centaines, voire de milliers de fois celui du CO₂. Une seule fuite ou une mauvaise gestion de ces équipements suffit à provoquer un impact disproportionné sur l’environnement. Et à mesure que les climatiseurs se multiplient, ces risques se banalisent.

En ville, un quart des ménages serait déjà équipé, et la dynamique s’accélère, portée par une classe moyenne avide de modernité et de confort thermique. Mais cette expansion pose la question de la soutenabilité. Davantage de climatiseurs, cela veut dire une pression accrue sur des réseaux électriques souvent fragiles, surtout aux heures de forte chaleur, là où la consommation atteint ses pics. Résultat : pannes, surcharges, incidents.
Le recours à l’énergie solaire est souvent présenté comme une panacée. Prometteuse, cette alternative reste toutefois insuffisante si elle s’inscrit dans le même modèle de consommation intensive et individualisée. Une maison, un climatiseur, une batterie solaire… mais à l’échelle d’une ville ? D’un pays ? Sans politique publique cohérente, le modèle s’essouffle rapidement.
En Europe, certains experts — bien loin des réalités équatoriales — préconisent des solutions plus sobres : volets, brasseurs d’air, isolation, végétalisation. Ces approches existent aussi en Afrique, mais elles peinent à se frayer un chemin. Les politiques urbaines restent floues, les architectes souvent mal formés aux enjeux climatiques, et la volonté politique demeure timide. Pourtant, les solutions existent, parfois dans nos traditions : murs épais en terre, orientation réfléchie des bâtiments, arbres judicieusement plantés. Revenir à des savoirs anciens adaptés au climat local pourrait être bien plus pertinent qu’un mimétisme technologique mal maîtrisé.
Alors, faut-il climatiser l’Afrique à tout prix ? La question n’est pas uniquement technique. Elle est politique, culturelle, sociale. La climatisation révèle nos rapports au confort, à la ville, à la nature. Elle pose la question du développement : veut-on répondre au dérèglement climatique par des outils qui l’aggravent ? Ou choisira-t-on de transformer plus profondément nos modes de vie et d’aménagement ?
L’Afrique peut-elle vivre sous clim ? Peut-être. Mais à quel prix, et pour qui ? Si la climatisation soulage, elle ne doit pas devenir une fuite en avant, ni un piège collectif. C’est tout l’avenir thermique de nos sociétés qui se joue dans ce choix.

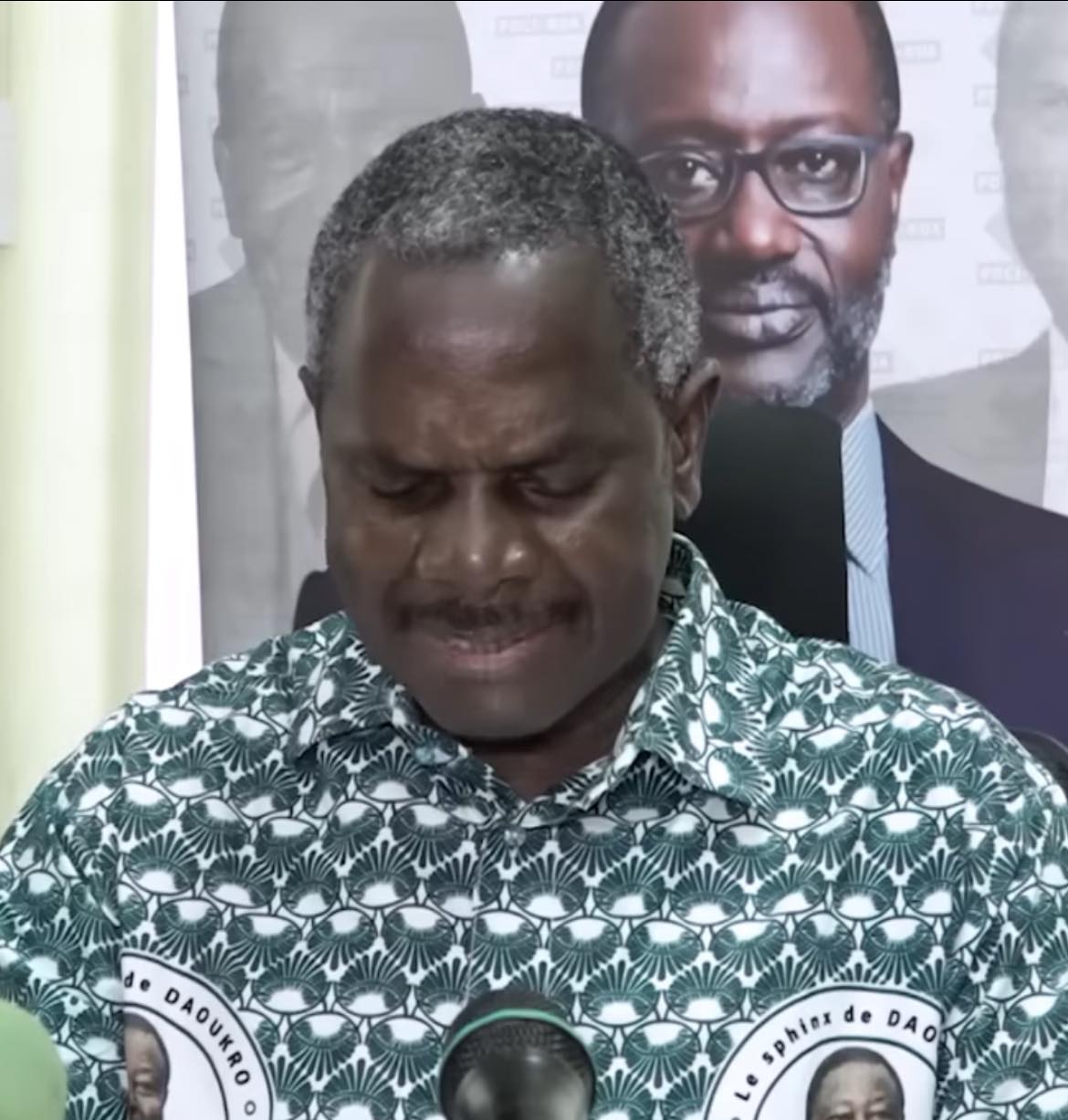



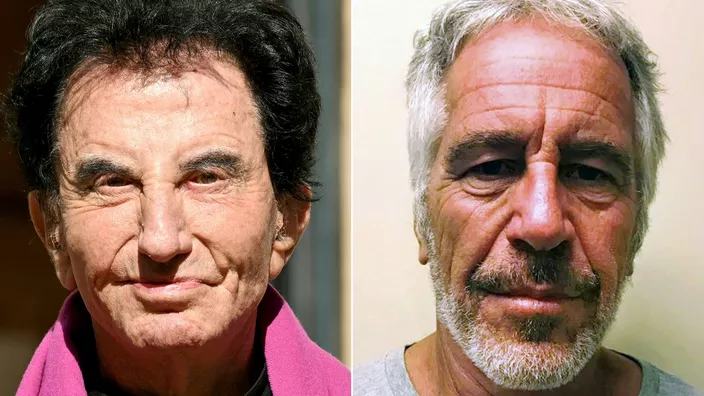

Commentaires Facebook