Par Fleur Kouadio
Ils creusent, nous payons. À chaque nouveau puits d’orpaillage illégal, c’est un peu plus de notre sol qui disparaît, un peu plus de nos villages qui s’enfoncent dans la précarité, un peu plus de notre jeunesse qui s’égare. Depuis plusieurs années, l’orpaillage clandestin s’étend comme une gangrène sur le territoire ivoirien, du nord au centre, de l’ouest à l’est. Et ce fléau n’a rien de folklorique : il coûte à la Côte d’Ivoire une partie de son environnement, de sa sécurité et de sa cohésion sociale.
Un phénomène tentaculaire
Selon les données du ministère des Mines, la Côte d’Ivoire compterait aujourd’hui plus de 1 200 sites d’orpaillage illégal, répartis principalement dans les régions de Séguéla, Dabakala, Mankono, Bonon, Yakassé-Attobrou ou encore dans les forêts classées de l’est. Des zones parfois plus connues pour leur café ou leur cacao que pour leurs ressources minières.
Attirés par l’appât du gain rapide, des milliers d’hommes, Ivoiriens, mais aussi Burkinabè, Guinéens, Maliens ou Ghanéens s’y installent. Ils creusent à la pelle, sans casque, sans normes de sécurité, parfois avec l’aide de mercure, une substance hautement toxique. Ils installent leurs campements à proximité des rivières, emportant avec eux insécurité, maladies, prostitution, trafics en tout genre. Et la promesse illusoire d’un avenir doré.
Quand l’or détruit la terre
Les dégâts sont visibles à l’œil nu. Là où hier encore s’élevaient des forêts denses ou des plantations de cacao, s’étalent aujourd’hui des paysages lunaires : trous béants, bassins de décantation pollués, végétation calcinée. L’utilisation massive du mercure, souvent déversé dans les cours d’eau, contamine les nappes phréatiques et met en danger les écosystèmes et les communautés riveraines. Dans le département de Kaniasso, les poissons meurent, les enfants tombent malades, et les femmes marchent des kilomètres pour trouver une eau potable.
L’impact est aussi économique : les terres agricoles sont abandonnées ou rendues impropres à la culture, les producteurs perdent leur revenu, et les recettes fiscales échappent à l’État. En 2023, selon un rapport de la Chambre des mines, l’orpaillage illégal aurait fait perdre plus de 50 milliards de francs CFA aux finances publiques.
Un terreau pour l’insécurité
Au-delà de l’environnement, c’est la stabilité des régions concernées qui vacille. Les affrontements entre orpailleurs et populations locales se multiplient. En juin 2024, à Bonon, une bagarre sanglante a opposé des jeunes du village à des orpailleurs armés, provoquant plusieurs blessés. Les autorités locales sont souvent débordées, et certaines complicités au sein même des forces de sécurité n’arrangent rien.
Des réseaux criminels transfrontaliers s’emparent progressivement de cette manne illégale. Dans certaines zones, des trafiquants de drogue ou d’armes côtoient les orpailleurs, dans un climat de non-droit qui menace à la fois la paix sociale et la souveraineté nationale.
Une réponse encore incomplète
Face à cette menace, l’État ivoirien a tenté de réagir. Des opérations de déguerpissement ont été menées régulièrement depuis 2018, avec la saisie de matériels et l’arrestation de centaines d’orpailleurs clandestins. En 2023, le gouvernement a mis en place une Brigade spéciale de répression de l’orpaillage illégal, placée sous la tutelle du ministère de l’Intérieur. Plus récemment, des efforts ont été faits pour légaliser certaines coopératives, avec la création de périmètres d’orpaillage artisanal encadré.
Mais la tâche reste immense. Tant que l’alternative économique fera défaut, tant que les jeunes des campagnes n’auront que la débrouille ou l’exil comme horizon, l’orpaillage clandestin continuera de prospérer. Il ne suffira pas de réprimer, il faudra former, insérer, encadrer. Redonner une valeur au travail de la terre. Faire de l’or un bien commun, et non une malédiction.
L’orpaillage illégal doit être normalisé en Côte d’ivoire. Ce n’est pas une fatalité, c’est un choix politique, économique et moral. Le pays mérite mieux que des trous béants et des promesses vides. Il mérite un développement durable, respectueux de sa terre, de ses enfants et de son avenir.
F. Kouadio
Cap’Ivoire Info / @CapIvoire_Info


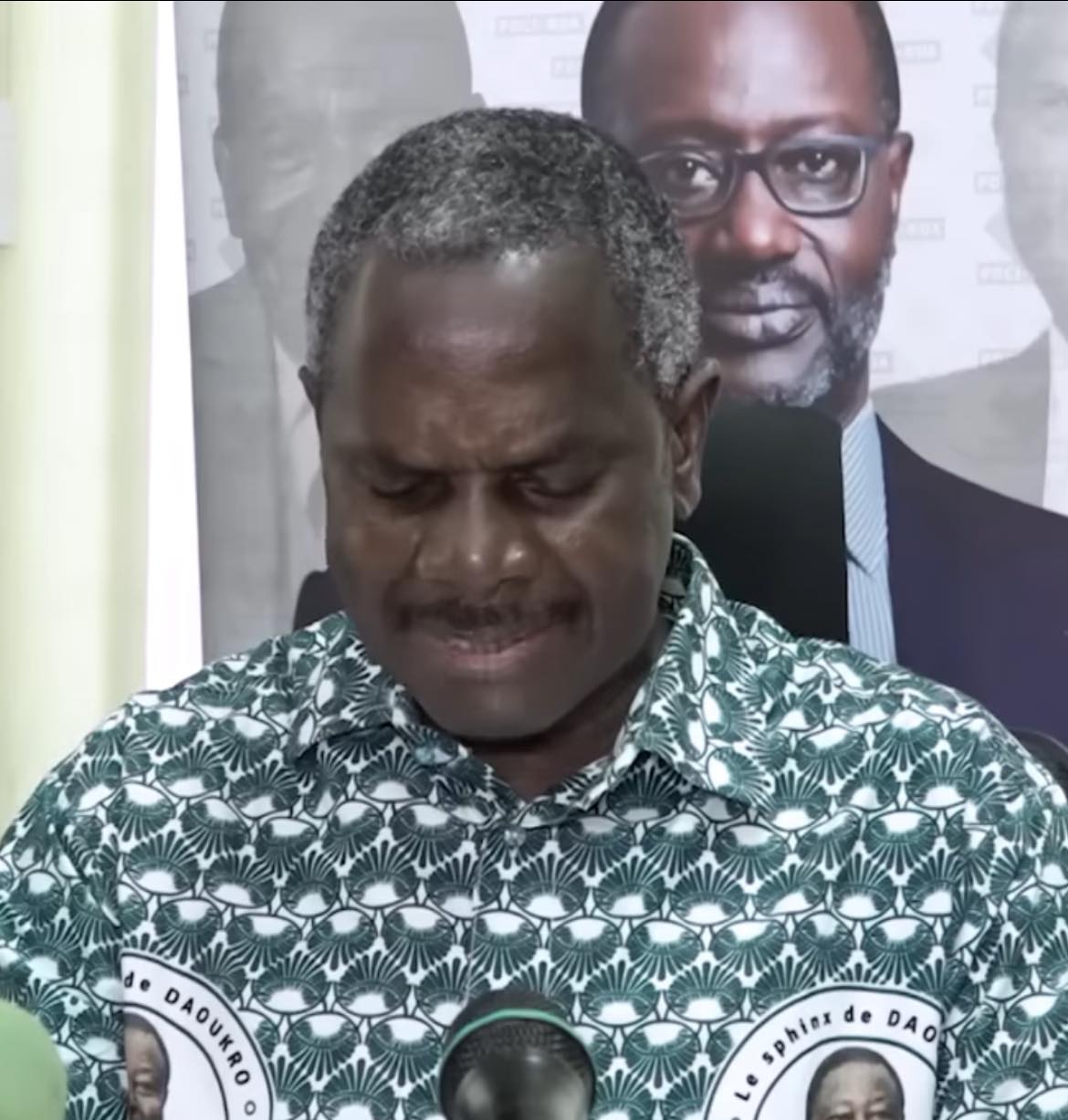



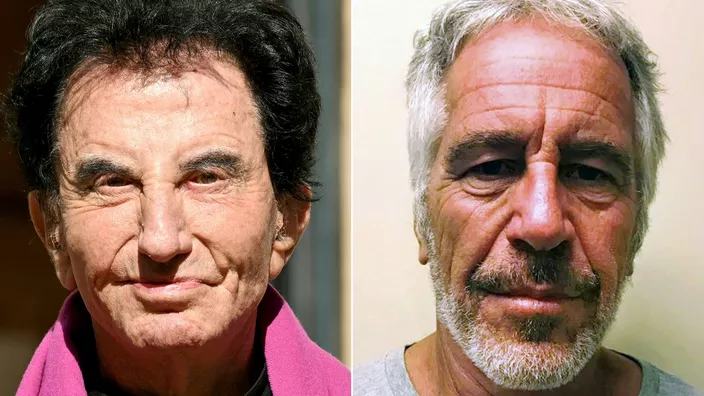
Commentaires Facebook