Washington – Bruxelles. Dans un nouvel épisode des relations commerciales transatlantiques, les États-Unis ont annoncé l’imposition de droits de douane de 15 % sur les importations en provenance de l’Union européenne, à l’exception de l’acier et de l’aluminium, qui resteront taxés à 50 %.
Cette décision fait suite à l’accord scellé entre Donald Trump, président américain, et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Ce texte est présenté par les deux parties comme une tentative de normalisation des relations commerciales, mais il suscite des réactions contrastées au sein de l’Union, notamment en France.
Des droits abaissés sur certains produits, durcis sur d’autres
Concrètement, la majorité des marchandises européennes — notamment des biens de consommation, des pièces industrielles ou certains équipements — seront désormais soumises à un droit d’entrée de 15 % sur le marché américain. En revanche, l’acier et l’aluminium, sujets de tensions récurrentes depuis 2018, resteront taxés à 50 %, selon les propos tenus par Trump lui-même.
« Ces droits sont là pour rester. Nous devons protéger notre industrie », a-t-il martelé lors d’un point presse à la Maison-Blanche, estimant que l’Europe « bénéficie depuis trop longtemps d’un accès préférentiel injustifié » au marché américain.
Une UE divisée et fragilisée
Cette annonce a provoqué un véritable tollé politique, en particulier à Paris. Le Premier ministre français François Bayrou a dénoncé ce lundi un « jour sombre » pour l’Europe. Dans un message publié sur le réseau social X, il a fustigé « une soumission à peine déguisée » à la stratégie commerciale américaine.
Pour lui, cet accord « déséquilibré » met en péril la souveraineté économique européenne et sape les efforts de construction d’une Europe puissance. « L’Union a été prise au piège de la promesse d’un compromis, pour se retrouver en position d’infériorité structurelle », confie une source à Matignon.
Un pacte au goût amer pour certains secteurs européens
Dans les milieux industriels et agricoles européens, l’accord est accueilli avec méfiance. Si certaines grandes entreprises se félicitent d’une prévisibilité retrouvée, d’autres dénoncent des conditions défavorables, notamment dans les domaines de l’agroalimentaire, de la chimie ou des biens d’équipement, désormais soumis à une taxe accrue pour entrer sur le marché américain.
En Allemagne, en revanche, le ton est plus conciliant. De nombreux acteurs de l’industrie automobile voient dans cet accord une manière d’éviter de nouvelles sanctions massives, en échange de concessions limitées.
Une guerre commerciale déguisée ?
En filigrane, cet accord semble consacrer le retour d’une relation asymétrique entre les deux rives de l’Atlantique, où Washington impose ses conditions et Bruxelles limite la casse. À trois mois de l’élection présidentielle américaine, Donald Trump multiplie les coups de force économiques, cherchant à séduire son électorat industriel.
Mais ce nouvel épisode ravive surtout la question de la capacité de l’Union européenne à parler d’une seule voix sur la scène économique mondiale. Pour François Bayrou, l’enjeu dépasse le simple commerce : « C’est l’idée même d’une Europe souveraine qui vacille. »


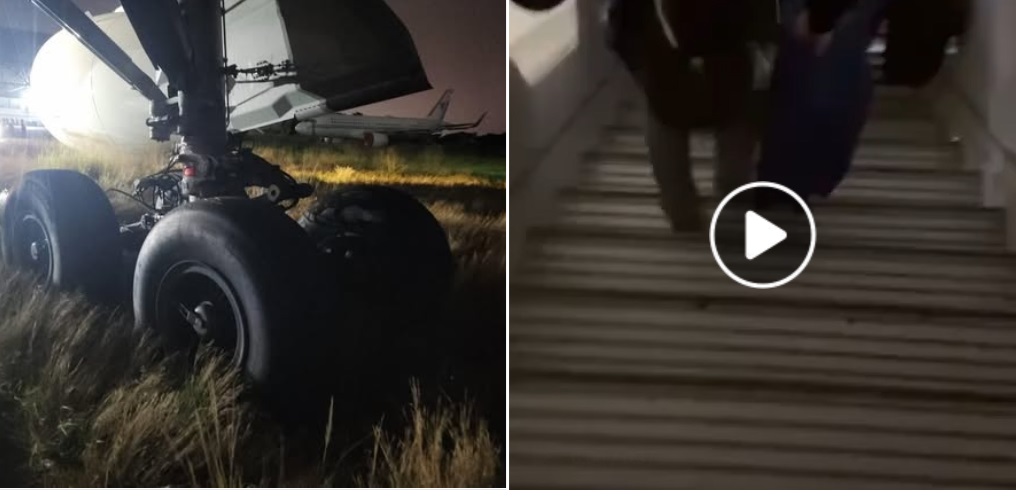
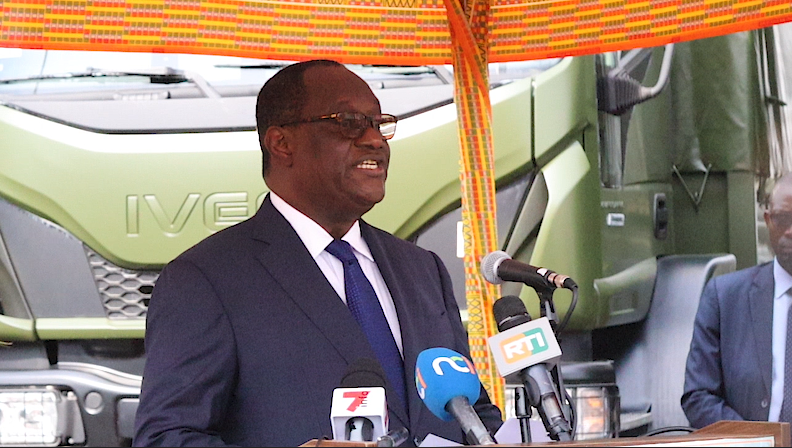
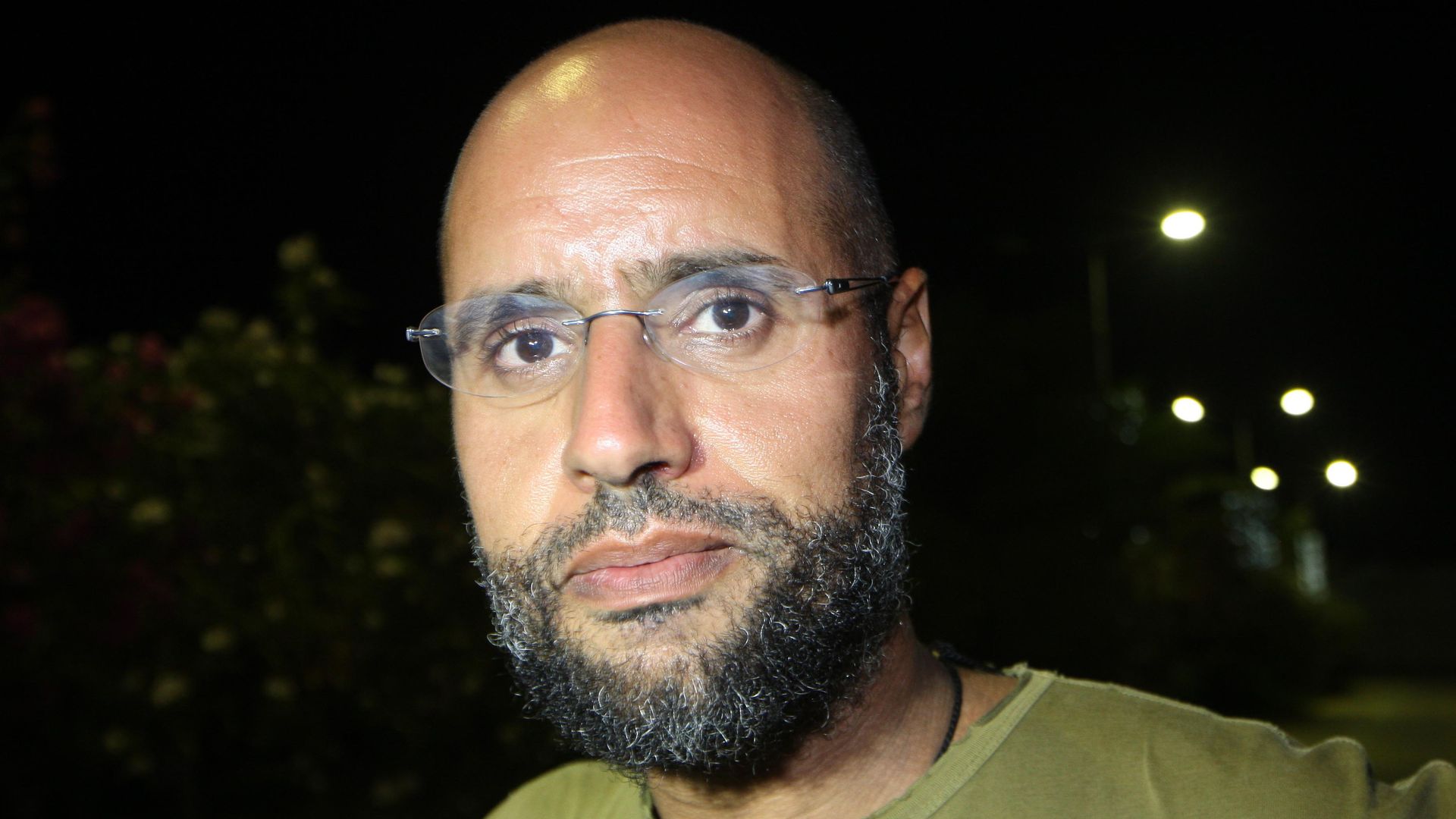


Commentaires Facebook