Le 4 juillet 2025, date hautement symbolique de l’indépendance américaine, le président Donald Trump a promulgué une loi instaurant une taxe sur les transferts d’argent vers l’étranger. Derrière cette mesure présentée comme une nouvelle arme contre « l’immigration illégale », se cache une attaque frontale contre les communautés migrantes et notamment contre les diasporas africaines, déjà fragilisées par le contexte politique et économique.
Votée de justesse à la Chambre des représentants (218 voix pour, 214 contre), la loi entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Son taux initialement proposé à 3,5 % a été réduit à 1 % par le Sénat, mais la logique punitive demeure. Portée par Kevin Hern, figure républicaine, et J.D. Vance, aujourd’hui vice-président, la taxe pourrait générer près de 10 milliards de dollars par an pour les caisses fédérales, selon Politico. Un jackpot pour Washington, un désastre pour les familles africaines.
Une taxe ciblant les plus vulnérables
Les transferts d’argent des diasporas vers le continent africain sont l’un des principaux piliers économiques de nombreux pays. Selon la Banque mondiale, les envois de fonds représentaient en 2023 plus de 100 milliards de dollars pour l’Afrique subsaharienne, soit parfois jusqu’à 10 % du PIB dans des pays comme le Sénégal, le Togo, le Lesotho ou encore les Comores.
Or, cette taxe ne fera pas de distinction : qu’il s’agisse d’un soutien financier envoyé à une mère âgée au Bénin, d’un paiement des frais de scolarité d’un enfant au Cameroun ou d’un appui à un projet agricole familial en Côte d’Ivoire, chaque transfert sera amputé d’un pourcentage désormais prélevé par l’État américain.
Un instrument politique masqué derrière une logique fiscale
Le discours officiel masque mal la volonté de restreindre les flux économiques des sans-papiers tout en profitant de ceux qui n’ont d’autre choix que d’aider leurs proches restés au pays. Car cette taxe, bien que faible en apparence, introduit une logique de suspicion généralisée : elle assimile de fait tout expéditeur d’argent à un migrant illégal, tout transfert à un acte suspect.
En restreignant l’accès aux circuits formels, cette taxe pourrait aussi favoriser l’émergence de réseaux informels de transferts, non régulés, risqués, et souvent plus coûteux à long terme pour les usagers.
Une diaspora africaine entre précarisation et marginalisation
Pour les Africains vivant aux États-Unis – souvent engagés dans des emplois peu rémunérés, précaires, et parfois sans couverture sociale – cette mesure s’ajoute à une série d’attaques systémiques : réduction des aides sociales, démantèlement de programmes de régularisation, durcissement de l’accès à la santé, à l’éducation, et à la citoyenneté.
La diaspora africaine n’est pas un groupe homogène, mais elle est profondément solidaire. En la ciblant ainsi, le gouvernement américain fragilise des millions de foyers de part et d’autre de l’Atlantique. Cette taxe n’est pas qu’un enjeu fiscal, c’est une attaque contre un lien social, contre une forme de solidarité transnationale, contre un tissu économique de survie.
Et l’Afrique dans tout cela ?
Face à cette mesure, les réactions des gouvernements africains restent étonnamment timides. Pourtant, les transferts d’argent de la diaspora dépassent souvent l’aide publique au développement. Ce sont eux qui financent les hôpitaux, les écoles, les petites entreprises dans les zones rurales ou urbaines défavorisées.
Il est temps que l’Union africaine, les institutions régionales comme la CEDEAO ou la SADC, s’emparent de cette question comme d’un enjeu de souveraineté économique. Pourquoi ne pas proposer des mécanismes africains de transferts à faible coût, adossés à des banques panafricaines ou à la monnaie numérique continentale en cours de réflexion au sein de la ZLECAf ?
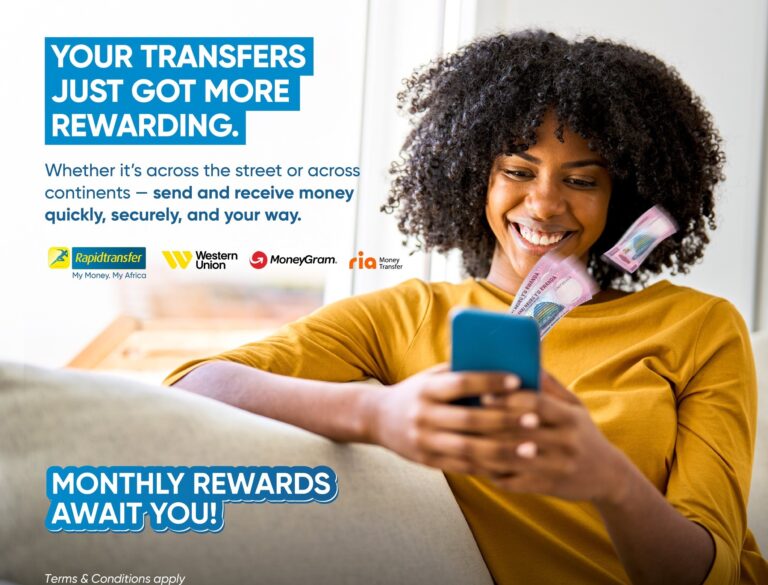






Commentaires Facebook