Les djihadistes, plus forts que jamais
Au lieu de reculer face au renforcement des forces prorusses, les groupes djihadistes dans le Sahel poursuivent leurs offensives à un rythme soutenu.
Dans le nord du Mali, les attaques se sont multipliées ces derniers mois. À Tessit, en avril dernier, plus de 40 soldats ont été tués dans une embuscade particulièrement meurtrière. Le groupe JNIM, lié à Al-Qaïda, revendique des attaques presque hebdomadaires contre les positions de l’armée malienne, malgré l’appui militaire russe. En juin 2025, plusieurs dizaines de militaires sont tombés à Boulikessi et dans la région de Tombouctou, pourtant considérées comme sécurisées par les autorités maliennes. Pire encore, à la frontière sénégalaise, un poste militaire a été attaqué par des éléments djihadistes, signe que la menace s’étend malgré les efforts de coordination avec les Russes.
Ce constat est accablant : les groupes armés islamistes n’ont pas été affaiblis par la présence russe. Au contraire, ils s’adaptent, frappent plus loin et s’enracinent dans les zones rurales. Leurs modes opératoires évoluent, et les forces prorusses, souvent mal intégrées aux armées locales, peinent à anticiper ou contenir les nouvelles vagues d’assauts.
Mali : une démonstration militaire qui tourne au fiasco
Le Mali est l’exemple le plus visible de l’échec relatif de l’assistance militaire russe. Les autorités de transition, qui ont tourné le dos à la France en 2022, comptaient sur l’arrivée de plusieurs centaines de militaires russes pour inverser la tendance sécuritaire. Depuis, du matériel lourd a été déployé : chars T-72, véhicules blindés, batteries d’artillerie, radars…
Mais malgré cette débauche d’équipements, la situation sécuritaire s’est encore détériorée. En février 2025, un convoi militaire escortant des civils a été la cible d’une embuscade dans la région de Gao. Au moins 56 personnes, dont des soldats et des civils, ont péri. Le convoi était pourtant accompagné par des instructeurs russes. Cela souligne l’incapacité de cette alliance militaire à empêcher les grandes pertes humaines.
Les grandes villes ne sont plus à l’abri : Bamako vit désormais dans une crainte latente, et les axes routiers majeurs sont devenus des corridors de la peur. Les soldats maliens, bien que soutenus par les Russes, sont à bout de souffle. Et la population, initialement favorable à la coopération russo-malienne, commence à douter.
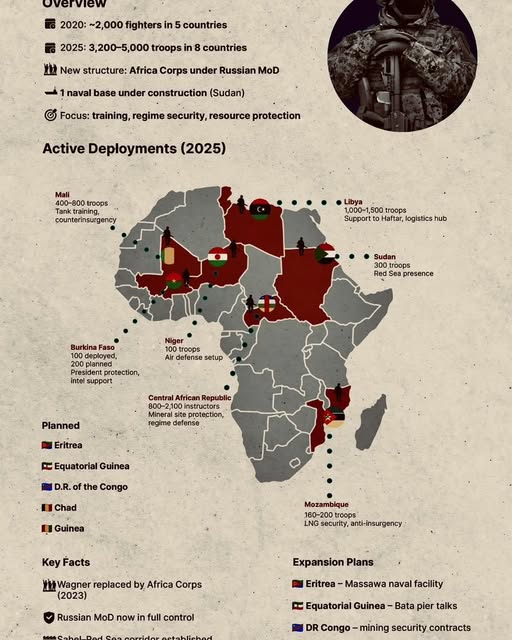
Quand la terreur remplace la stratégie
L’un des volets les plus controversés de la présence russe reste sa méthode brutale et opaque. Dans plusieurs pays, des ONG et des journalistes locaux rapportent des actes de torture, des exécutions extrajudiciaires et des représailles contre des civils soupçonnés de sympathie avec les groupes rebelles. Ces abus ont souvent été attribués à des combattants russes ou à des miliciens formés par eux. Ce climat de terreur génère un effet boomerang : au lieu de pacifier les régions, la violence alimente le ressentiment, pousse certaines communautés à s’allier aux djihadistes et nourrit une radicalisation rampante. Loin de gagner les cœurs et les esprits, la stratégie reproduit les mêmes erreurs qui ont fragilisé d’anciennes puissances coloniales. La peur est devenue une arme, mais elle reste inefficace pour imposer la paix.
Expansion annoncée, mais puissance fantôme
Moscou a annoncé son intention de s’implanter durablement en Guinée équatoriale et en République démocratique du Congo. En Guinée équatoriale, une poignée d’instructeurs russes auraient été envoyés pour conseiller la garde présidentielle. Mais aucun renfort majeur ni base militaire solide n’a été observé à ce jour. L’effet d’annonce dépasse de loin l’effet réel.
En RDC, pays riche en ressources minières et en tensions internes, les signaux sont encore plus faibles. Aucun déploiement militaire significatif n’a été détecté. Ce qui devait être une expansion stratégique ressemble davantage à un bluff diplomatique ou à un levier de pression sur l’Occident. Cette stratégie de présence virtuelle alimente un storytelling militaire qui masque difficilement une réalité crue : la Russie tente d’exister partout, mais peine à peser vraiment là où les enjeux sont brûlants.
Des blindés dans la poussière
Le matériel militaire russe, chars, blindés, artillerie, déployé dans plusieurs capitales africaines impressionne lors des parades et des démonstrations. Mais dans les zones de combat réel, ce matériel s’use rapidement, manque de pièces de rechange, et est souvent inadapté au relief ou à la tactique asymétrique des ennemis. Des blindés sont parfois abandonnés après des embuscades, et certaines unités locales peinent à utiliser les systèmes sophistiqués faute de formation suffisante. L’impact technologique attendu de la Russie se dilue dans des réalités logistiques chaotiques.
Le coût humain d’une stratégie inefficace
Depuis le début de l’année 2025, les pertes militaires cumulées dans les zones d’influence russe en Afrique dépassent les 300 soldats tués, toutes nationalités confondues. Les civils, eux, paient un tribut bien plus lourd : plus de 700 morts enregistrés dans des attaques ou représailles, rien qu’au Sahel. Ce bilan humain, déjà dramatique, s’accompagne d’un climat de méfiance et de tension permanente. Dans plusieurs localités, la présence russe est perçue non pas comme un soutien, mais comme un facteur de militarisation croissante du conflit, voire comme un danger pour les populations.
Un masque de puissance pour un vide stratégique
Le paradoxe est cruel. Jamais la Russie n’avait autant investi sur le continent africain depuis la guerre froide. Pourtant, ses résultats militaires sont faméliques, sa légitimité contestée, et sa capacité d’influence limitée à quelques régimes sous pression. La Russie semble avoir gagné du terrain médiatique et diplomatique, mais pas sur le champ de bataille. Ses soldats tiennent des bases, protègent des palais, sécurisent des mines… mais n’apportent ni paix, ni progrès durable. Derrière la façade, l’impuissance stratégique est flagrante. Si Moscou parvient à corriger ses excès, à mieux intégrer ses forces aux réalités locales et à développer une approche plus politique et moins punitive, elle pourrait encore transformer sa présence militaire en véritable levier d’influence durable.
Le défi est immense, mais la partie n’est pas totalement perdue.
Source : www.actualitesexpress.info







Commentaires Facebook