Rediffusion
Selon Petit Larousse (2003), la souveraineté est le pouvoir suprême reconnu à l’État, qui implique l’exclusivité de sa compétence sur le territoire national et son indépendance dans l’ordre international, où il n’est limité que par ses propres engagements. La souveraineté c’est également le caractère d’un État ou d’un organe qui n’est soumis à aucun autre État ou organe. La notion de souveraineté va de pair avec celle de pouvoir, qui lui, n’existe qu’avec une allocation des ressources et une capacité stratégique. Pour ce qui est du souverain monétaire, il est l’organe qui décide de l’émission et de la politique monétaire effectivement mises en œuvre dans un pays. Il en découle que la souveraineté monétaire suppose le pouvoir autonome dans l’allocation des crédits et dans la gestion de la valeur de la monnaie. Dans les lignes qui suivent, nous donnons les raisons pour lesquelles, les Pays Africains de la Zone Franc (PAZF) n’ont pas encore leur souveraineté monétaire et qu’il convient de la conquérir.
Le pouvoir de battre monnaie revient au peuple souverain
Si de nos jours la monnaie est le symbole même du pouvoir économique et matériel, de nombreuses traditions sont encore là pour nous rappeler qu’elle fut aussi, jusqu’à un temps encore proche de nous, le reflet d’un pouvoir spirituel et le prolongement du pouvoir sacré de la puissance émettrice. Il est remarquable de noter que battre monnaie a été pendant des siècles un acte qui consacrait non seulement le pouvoir temporel mais aussi le pouvoir spirituel du souverain : les types symboliques ou les légendes qui ornent les pièces ont longtemps reflété l’influence religieuse du chef de l’État sur son peuple. Au Moyen Âge, battre monnaie est un droit régalien et sacré : seul le roi dispose de ce monopole monétaire dans le royaume. Cette prérogative est légitimée par les Évangiles : ” Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ” (Marc, XII, 13-17 ; Matthieu, XXII, 15-22 ; Luc, XX, 20-26). Le fait qu’un duc ou un comte frappe des monnaies d’or dans le royaume signifie alors que celui-ci rentre dans un procédé plus ou moins ouvert de contestation. Il rejette l’autorité du roi, et entre, de ce fait, économiquement et politiquement, en concurrence contre lui. Dès lors, battre monnaie est donc placé au même niveau que la loi du souverain. Aussi, la frappe illicite de monnaies est une usurpation de cette loi et un crime de lèse-majesté, que le contenu métallique de ces monnaies soit bon ou mauvais.
De nos jours, les républiques et les démocraties sont le contraire des royaumes. Afin de bien apprécier le rôle du peuple dans la décision de battre monnaie, il convient de faire un détour utile pour définir la notion de république et de démocratie. Le mot « république » vient en effet du latin « res publica », ce qui signifie « le bien public » ou « la chose publique ». Ainsi une république est-elle un système politique dans lequel le pouvoir n’est pas exercé par un chef d’Etat de manière héréditaire mais par des représentants du peuple, que ce dernier élit. Quant à la démocratie, le terme « démocratie » vient quant à lui des mots grecs « demos » – le peuple – et « kratia » – gouverner. Il désigne un régime politique dans lequel le peuple est souverain. En définitive, la République est un régime fondé sur la représentation et donc sur l’élection, alors que la démocratie donne directement le pouvoir de faire les lois au peuple.
Finalement, dans les économies modernes, le pouvoir de battre monnaie relève purement de la volonté du peuple ou bien de ses représentants. Selon l’article 3 de la constitution française, « la Souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». En France, jusqu’à la révision de la constitution le 23 Juin 1992, suite à la signature du traité de Maastricht, c’est l’État français qui décidait de l’émission de la monnaie et de la politique monétaire.
De même, certaines constitutions des pays de la Zone Franc proclament elles aussi cette souveraineté monétaire même si comme on le verra dans la suite du texte, elle n’est pas réelle. On peut citer le cas du Niger où sa constitution énonce dans son article 6 que la souveraineté appartient au peuple et à son article 99, que c’est le parlement du pays qui fixe, par la loi, les règles concernant le régime d’émission de la monnaie (Constitution de la VIIème République, Niger). Au Sénégal, les articles 3 et 67 disent la même chose. Les mêmes dispositions se retrouvent dans la constitution d’autres pays : Burkina Faso (articles 32 et 101), Mali (articles 37 et 115), Côte d’Ivoire (articles 31 et 71).
Dans la Constitution des États-Unis d’Amérique, Section 8 de l’article1 : « Le Congrès aura le pouvoir de battre monnaie, d’en déterminer la valeur. ».
Les Pays Africains de la Zone Franc n’ont jamais décidé pour le FCFA
La France a toujours décidé à la place des pays africains sur les questions liées au Franc CFA. La dévaluation du Franc CFA de 1994 est là pour éclairer les lanternes. Tout commence au début des années 80 avec la hausse des taux d’intérêt au niveau mondial, la chute des cours des matières premières et la crise internationale de la dette qui s’ensuit. Très vite, on assiste à une descente aux enfers des poids lourds comme le Cameroun et la Côte d’Ivoire. Le FMI proposa un « ajustement monétaire » pour accompagner « l’ajustement réel », c’est-à-dire une compression de la demande intérieure via une baisse des dépenses publiques et des importations afin de ramener à l’équilibre les comptes publics et le solde extérieur. Pour le FMI, il s’agissait d’installer les conditions nécessaires à l’imposition de son dogme néolibéral en plein triomphe depuis la chute du bloc soviétique en 1991. La France refuse dans un premier temps car une telle décision risquait de saper ce symbole important de la « Françafrique ». Le FMI, avec, à sa tête le français Michel CAMDESSUS, pratique un chantage honteux : l’institution refuse de prêter à la Côte d’Ivoire à la fin de 1991. Deux options s’offrent au pays : accepter la dévaluation ou rembourser les dettes contractées auprès du FMI. Avec l’aide de Paris, la Côte d’Ivoire arrive à rembourser ses dettes auprès du FMI. Tout se complique pour les pays africains avec le changement de majorité politique en France. En effet, en mars 1993, Edouard BALLADUR, partisan de la politique néolibérale, est nommé Premier Ministre. Le 2 août 1993, les autorités monétaires de la Zone Franc suspendent les rachats des billets CFA en dehors de la Zone Franc. Peu après, la BEAC décide de ne plus assurer la convertibilité de ses billets de Franc CFA détenus dans l’UMOA. La BCEAO fait de même concernant ses billets se trouvant au sein de la CEMAC. Dès lors, les Francs CFA des deux zones ne peuvent plus s’échanger directement entre eux. Il faut désormais passer par la monnaie d’ancrage. Le 16 septembre 1993, Edouard BALLADUR annonce par écrit aux chefs d’Etats africains que la France ne consentira plus d’avances aux pays qui n’auront pas conclu un accord avec le FMI et la Banque Mondiale. Cette nouvelle politique appelée « doctrine d’Abidjan » ou « doctrine BALLADUR » fait de la dévaluation un passage obligé, vu que le FMI ne veut traiter qu’avec les États ayant accepté le principe d’une dévaluation. En janvier 1994 à Dakar, officiellement, les représentants des pays de la Zone Franc dont dix chefs d’Etats, y sont réunis pour décider du sort de la compagnie aérienne panafricaine Air Afrique qui traverse une grave crise. En réalité, cette réunion est consacrée à la dévaluation que les pays africains tentent d’éviter en présence du Directeur du Trésor français, Christian NOYER, du Ministre français de la Coopération Michel ROUSSIN, du Directeur Général du FMI, Michel CAMDESSUS et d’une responsable de la Banque Mondiale, Katherine MARSHALL. Après dix-sept heures d’un huit clos très houleux, les dirigeants africains capitulent. Le soir du 11 janvier à 20 heures 50 minutes, le Ministre camerounais des Finances, Antoine NTSIMI, encadré par Michel CAMDESSUS et Michel ROUSSIN, annonce aux médias qu’à partir du 12 janvier à 0 heure, 1 Franc CFA vaudra 0,01 Franc français, contre 0,02 auparavant. Le Franc comorien a, quant à lui, été dévalué de 33 % car 1 Franc comorien vaut désormais 0,0133 Franc français contre 0,02 Franc Français auparavant.
Les inconvénients qui découlent de ce transfert de souveraineté monétaire
L’accord de coopération monétaire entre les PAZF et la France présente des inconvénients dont on peut citer le surcoût des importations, un poids excessif donné à la réduction de l’inflation et un frein à l’essor du secteur privé.
Concernant le surcoût des importations, notons que les pays africains membres de la Zone Franc surpayent leurs importations quand ils commercent avec la France dans le cadre d’accords spécifiques qui, à première vue, ont pour but d’assurer des garanties de change, la stabilité monétaire et la solidarité entre les nations. Les surcoûts supportés par les importateurs africains augmentent les coûts des facteurs de production dans la zone et réduisent la compétitivité des entreprises même si, dans ces économies, l’inflation est faible et la main d’œuvre abondante. Ainsi, les pays de la Zone Franc, comparés aux autres, doivent payer plus cher leurs importations. Ces surcoûts permettent au Trésor français de prélever des seigneuriages incalculables et de les recycler dans l’économie française. Les économistes expliquent ces surcoûts par l’existence, pour les importateurs des pays africains de la Zone Franc, d’un nombre limité de partenaires à l’échelle internationale. En effet, les échanges se feront dans un cadre institutionnel formaté et protégé de la concurrence mondiale. Les arrangements politiques prennent alors le pas sur les affaires avec pour résultats la corruption, les intimidations, les réseaux d’affairismes. Or toutes ces activités coûtent et quelqu’un doit bien en faire les frais. Les économies africaines hors Zone Franc, plus ouvertes, ayant diversifié leurs échanges commerciaux avec d’autres pays, tireront de meilleurs avantages de la mondialisation, payeront moins chers leurs importations et vendront mieux leurs exportations.
Quant à la recherche effrénée d’une inflation faible, selon le discours officiel tenu par les autorités françaises depuis les années 60, le Franc CFA sert avant tout à procurer une « stabilité » aux économies qui l’utilisent. Cette stabilité serait assurée, de leur point de vue, par la fixité du taux de change entre le Franc CFA et la monnaie française et par la faible inflation, faible augmentation des prix d’une année à l’autre observée dans la Zone Franc.
Dans les faits, cette stabilité est le résultat de la politique monétaire menée par les banques centrales. Ces dernières sont soumises à la nécessité de défendre la parité fixe dans un environnement de libre transfert, tout en étant obligées de veiller à ce que les Comptes d’Opérations soient le moins souvent possible débiteurs. Afin d’y parvenir, elles partent du fait qu’une grande partie des crédits bancaires est en général utilisée à payer des importations dans les pays de la Zone Franc, ces derniers ne disposant que de structures de production peu diversifiées. En raison donc de la parité fixe avec l’Euro, les Banques Centrales des Pays Africains de la Zone Franc sont obligées de calquer leur politique monétaire sur celle de la Banque Centrale Européenne (BCE) qui a pour mandat de veiller uniquement à la stabilité des prix. C’est ce qui explique que les taux d’inflation en Zone UEMOA et CEMAC se situent généralement dans les limites tolérées en Zone Euro, c’est-à-dire autour de 2 % (soit entre 1 % et 3 %).
Or si l’inflation s’anime un peu, après tout, c’est bon signe : cela signifie que la demande est vigoureuse et, par ailleurs, cela rend les finances publiques plus facilement soutenables car les recettes fiscales sont alors plus dynamiques et la valeur réelle des dettes s’allège un peu. En effet, dans le système CFA actuel, la stabilité monétaire se paie par une forte instabilité réelle sur le marché des biens et services et sur le front de l’emploi. Il serait préférable de faire en sorte que le système des prix soit en mesure de jouer un rôle dans les ajustements, ce qui ne contraindrait pas à sacrifier régulièrement l’économie réelle sur l’autel de la stabilité monétaire.
Les pays de la Zone Franc CFA exhibent une aversion révélée à l’inflation « anormalement » très élevée comparativement aux autres pays africains non-membres de la zone aux caractéristiques structurelles similaires. Etant donné ces préférences, les pays de la Zone Franc CFA ont un taux de croissance du PIB qui est relativement plus volatile que les autres pays africains à taux de change plus flexible.
Un frein à l’essor du secteur privé dû à une politique monétaire inféodée à celle de la BCE. La politique monétaire administrée par les interventions directes des Etats déforme l’information sur la liquidité bancaire que le marché libre de la monnaie et de la banque aurait fait émerger. Les banques centrales, prêteuses en dernier ressort aux Etats et à l’économie, orientent l’activité de telle sorte que, dans les pays de la zone, coexistent des agents à besoin de financements qui se heurtent à des banques surliquides mais incapables de financer les projets de production présentés par leurs clients. Les Pme, les Pmi, les micro-entreprises et les particuliers du secteur privé manquent de financement alors que les banques sont surliquides et que les économies sont sous bancarisées. En effet, les économies des Pays Africains de la Zone Franc se caractérisent par un rationnement du crédit, dont les causes renvoient autant aux objectifs des deux principales Banques Centrales de la Zone Franc (la BCEAO pour l’UEMOA et la BEAC pour la CEMAC) qu’à l’extrême frilosité du système bancaire de la zone. Il est aujourd’hui évident que le principal objectif de la BCEAO et de sa consœur, la BEAC, est la défense du taux de change entre le Franc CFA et l’Euro, bien plus que d’autres considérations (stabilité des prix ou croissance économique), comme en témoigne la persistance du « programme monétaire ». En effet, l’encadrement du crédit bancaire dans l’UEMOA qui exigeait que la BCEAO attribue à chaque pays un volume prévisionnel de crédits à octroyer par son système bancaire au cours d’une année donnée, perdure autrement, même après la libéralisation du système financier de 1989.
Dans le cadre actuel, les autorités monétaires des PAZF doivent nécessairement mener une politique de restriction du crédit, sinon l’abondance de liquidités dans une économie peu productive et peu diversifiée conduit à accroître les importations. Or, cette augmentation érode les réserves de change. Le phénomène devient grave lorsque les prix des produits primaires baissent sur les marchés mondiaux, faisant courir un risque de dévaluation forcée comme ce fut le cas en janvier 1994 suite à la baisse des réserves de change en dessous du seuil de 20 %. Et pourtant, les économies des PAZF ont un besoin fort pressant de crédit suffisamment abondant pour financer l’investissement nécessaire au développement.
La renonciation à la souveraineté monétaire ne facilite pas le financement du secteur privé des pays africains membres de la Zone Franc. Pourtant, les quelques banques existantes restent surliquides ce qui signifie que les prêts bancaires restent inférieurs aux dépôts. Les bilans des banques laissent apparaître alors des excès de fonds prêtables oisifs et stériles.
Dans les pays africains de la Zone Franc, les banques surliquides préfèrent constituer des encaisses oisives plutôt que de prendre des risques. Cette rente de situation profite aux Etats qui peuvent y accéder par le biais des emprunts publics avec pour conséquences les déficits budgétaires, l’endettement et la pression fiscale qui va avec.
Dans le contexte actuel, le Franc CFA reste confiné dans une fonction de stabilisation et ne joue aucun rôle actif dans l’économie. L’une des conséquences, c’est que les pays africains doivent se tourner vers l’étranger pour financer leur développement.
La souveraineté monétaire, un attribut de la souveraineté
Loin de nier sa dimension marchande, il faut placer la monnaie au cœur de l’organisation sociale (Simmel, 1987 ; Daniel de Coppet, 1998). Ainsi, pour Simmel : « Plus il y a d’humains en interrelations, plus leur moyen d’échange doit être abstrait et universellement valable ; et inversement, un tel moyen, une fois créé, permet la compréhension à des distances jusqu’alors inaccessibles, l’intégration des personnalités les plus diverses dans la même action, l’interaction et par là l’unification d’individus à qui l’éloignement spatial, social, personnel, etc. , de leurs intérêts respectifs n’aurait jamais permis d’entrer dans aucun type de groupement » (Simmel, 1987) . La monnaie se présente à cet égard comme un lien institutionnel primordial qui met en relation les individus les uns avec les autres en donnant une valeur aux marchandises et en autorisant l’échange. Ainsi, au-delà de sa fonction d’intermédiaire des échanges, la monnaie est éminemment une institution génératrice de sociabilité. Dans cette perspective, Aglietta et Cartelier stipulent que : « Les agents entretiennent avec la monnaie un rapport qui n’est pas de l’ordre du contrat, qui ne fait pas l’objet d’un calcul, qui n’est pas transparent à chacun en ce sens que personne ne peut s’affirmer être l’auteur de cette norme fondamentale » (Aglietta et Cartelier, 1998).
Cette assertion évoque l’idée selon laquelle le fait monétaire ne peut pleinement s’appréhender sans la notion de confiance. En effet, ce lien social que recouvre l’institution monétaire est créé à partir de la confiance qui structure et relie les membres de la communauté. C’est en cela qu’Aglietta et Orléan (2002) affirment que «la monnaie est confiance », car elle existe du fait de son acceptation par l’ensemble du groupe social, en dépit de son caractère purement conventionnel, voire arbitraire. De ce qui précède, la monnaie est un instrument d’unification des communautés, un attribut permettant la reconnaissance des membres d’une même société. Elle participe donc du processus de construction de la nation. C’est, en effet, de la nation que découle l’adhésion à des symboles, normes et valeurs communes qui impliquent par la suite la confiance dans l’ordre politique et social dont l’ordre monétaire n’est qu’une émanation. A cet égard, à l’instar de la loi, la monnaie participe de la souveraineté en tant qu’institution fondamentale de la société. Ce qu’affirmait déjà Bodin en ces termes : « La monnaie est l’un des droits de la souveraineté » (Bodin, 1583). En tant qu’attribut de la souveraineté, la monnaie est donc éminemment politique qu’économique. Il en découle que l’Etat ne peut abandonner complètement la gestion de sa monnaie sans renoncer, du même coup, à une part substantielle de ce pouvoir originel qu’il tient de son statut d’Etat souverain. Il y a pour ainsi dire, indissociabilité entre souveraineté monétaire et Etat : « Quant au droit de monnayage, ajoutait Bodin, il est de la même nature que la loi, et il n’y a que celui qui a puissance de faire la loi, qui puisse donner loi aux monnaies. Or il n’y a rien de plus grande conséquence après la loi, que le titre, valeur et pied des monnaies […] et en toute république bien ordonnée, il n’y a que le prince souverain qui est cette puissance. » (Bodin, 1583). Cette doctrine est d’ailleurs partagée par de nombreux auteurs contemporains à l’instar de Carreau pour qui : « La souveraineté monétaire de l’Etat constitue l’un des principes les mieux assis dans le droit international coutumier » (Carreau, 1998). Le corolaire de cette doctrine établit de ce fait un lien très étroit, entre souveraineté monétaire et autonomie : « L’Etat territorial détient le pouvoir exclusif de réglementer la circulation monétaire, de modifier la valeur de la monnaie et d’en prescrire ou proscrire l’usage. Aucune personne ou autorité interne ne peut concurrencer, paralyser ce pouvoir de réglementation monétaire ou lui échapper, par exemple, par la conclusion de conventions privées contenant des clauses de garantie monétaire ou d’indexation. Ces clauses peuvent être interdites ou annulées par le souverain territorial ; elles ne sauraient, en tout cas, prévaloir sur les lois monétaires qui sont d’ordre public » (Carreau, 1988).
Il nous faut redevenir des peuples souverains
Les Etats africains peuvent de droit reprendre leur souveraineté mise sous tutelle depuis trop longtemps. Après avoir proclamé des indépendances sans souveraineté, promulgué des souverainetés sans compétences et accepté des compétences sans indépendance, les pays de la Zone Franc peuvent, sur la base du droit, recouvrer leur liberté.
La souveraineté monétaire n’est certes pas la seule en cause dans une analyse plus globale de la souveraineté, mais, si elle nourrit avec vigueur notre débat, c’est qu’elle en est la clé de voûte. Comme le disait Jacques Rueff en 1950, le « destin de l’homme se joue sur la monnaie ». Pour sortir de cette soumission monétaire vis-à-vis de la France, il est possible de suivre les trois étapes suivantes.
La première consiste à réunir des experts des questions monétaires. Ces derniers mettent leur expertise au service du politique pour l’intérêt du peuple, pour démontrer les avantages et les inconvénients d’avoir une monnaie propre au peuple.
La seconde étape consiste, pour le politique, à étudier le contexte géopolitique nationale et internationale, les capacités du peuple à assurer la survie d’une monnaie souveraine, l’observation de critères de convergence quand il s’agit d’une Union Monétaire.
La troisième étape consiste à faire appel à l’unique souverain : Le Peuple. En effet, le peuple en dernier ressort, par référendum ou par ses représentants, décide si oui ou non il veut sa monnaie. A titre d’exemple, nous pouvons citer le cas de la France qui, le 20 septembre 1992, avant que le pays ne rejette le franc français pour l’Euro, le peuple français a été appelé par référendum et à 51%, le peuple français a rejeté le Franc français pour l’Euro.



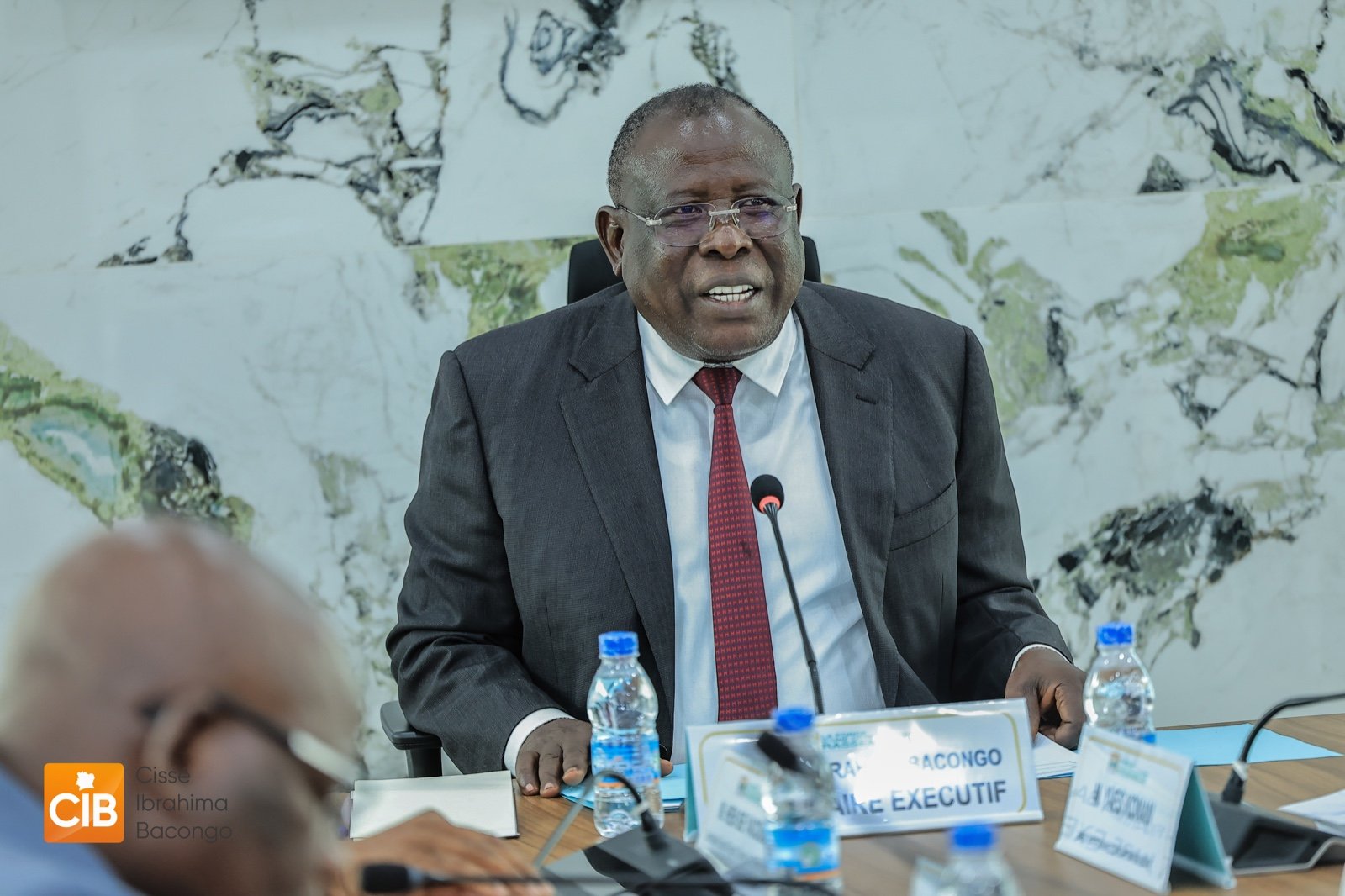

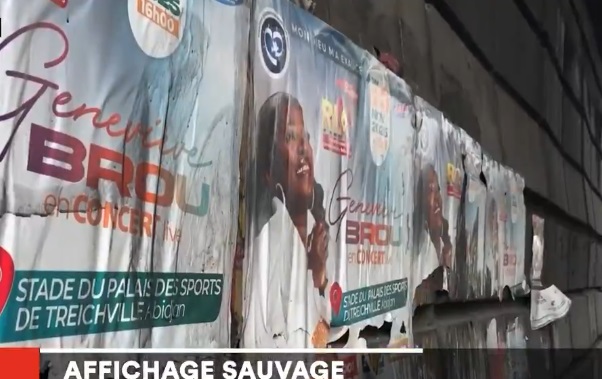

Commentaires Facebook