La RD-Congo n’a pas toujours porté ce nom. Congo-belge du temps de la colonisation pour le distinguer du Congo-français, le pays prit le nom officiel de « République Démocratique du Congo » à son indépendance le 30 Juin 1960. L’adjectif « Démocratique » permettait de le distinguer de la République du Congo voisine. La nation prit ensuite le nom de Zaïre en 1971, lorsque tous les noms ont été africanisés, sa capitale avait pris le nom de Kinshasa en 1965. Le pays retrouve finalement son nom original de République Démocrtique du Congo en 1997.
La Belgique a colonisé le territoire avec une différence d’approche fondamentale. Alors que les autres puissances européennes voyaient les colonies comme des territoires à exploiter, le Congo était vu comme une extension de la Belgique, un territoire à exploiter, mais aussi à mettre à niveau. Ainsi la Belgique fit de gros investissements dans le territoire et encourageait l’immigration de ses citoyens. C’est en 1959 que la Belgique comprit que l’indépendance était inévitable. Elle fut octroyée le 30 Juin 1960, relativement dans la précipitation et donc dans l’impréparation.
Léopoldville ( actuelle Kinshasa ) était dans les années 50, la seule ville en Afrique qui avait des bâtiments de 10 étages avec des ascenseurs. C’était inédit pour l’époque. Il y avait des supermarchés, des pharmacies, des banques, des parcs un peu partout dans la ville, des voitures américaines étaient en circulation. Le pays était le plus avancé en Afrique noire. De partout en Afrique, on migrait vers le Congo. Inévitablement se développait chez les congolais, un certain orgueil. Outre les infrastructures, le sous-sol regorgeait de minerais et de pierres précieuses, le territoire était vaste, propice à l’agriculture avec une population nombreuse. Le pays avait tout pour devenir une puissance économique majeure en Afrique. Mais cela ne s’est pas produit. Pourquoi ?
Des troubles se sont produits immédiatement après l’indépendance et ont duré cinq ans environ, des troubles dûs à l’impréparation dans laquelle l’indépendance fut octroyée. A partir de 1965, la situation s’est toutefois stabilisée. Les causes de la débâcle économique sont ailleurs. Vaste, fertile, arrosé de nombreux cours d’eau, le pays était prédisposé à devenir rapidement une puissance agricole. Mais la présence de minerais et de pierres précieuses dans le sous-sol, va amener le pays à négliger son agriculture. Or les minerais génèrent toujours de la contrebande, cette contrebande sera d’autant plus présente au Congo que le territoire est vaste, et donc difficile à contrôler depuis Kinshasa. Le pays va ainsi devenir l’un des plus corrompus d’Afrique.
Mais ce qui fut fatal à l’économie, c’est la « zaïrianisation » décidée en 1973 par le général Mobutu, qui a dirigé le pays de 1965 à 1997. Selon cette doctrine, tout devait être aux mains des Zaïrois. Les entreprises, les exploitations agricoles, les commerces etc……ont été brutalement retirés aux occidentaux et aux asiatiques, pour être remis aux zaïrois. Ceux-ci ne seront pas de bons gestionnaires, se contentant de vider les caisses des entreprises reçues. Le secteur privé et l’agriculture vont s’effondrer et le pays ne va plus attirer d’investissements, parce qu’on craignait une nouvelle « zaïrianisation ».
En 1980, l’économie était à terre. Le délabrement se poursuivit tout au long des années 80. Certes les autres pays africains avaient aussi des difficultés durant la période. Mais le Congo est ce qu’on appelle un « pays continent » du fait de sa superficie et sa population. Aussi les problèmes ne sont pas à la même échelle que chez ses voisins. A partir de 1990 le Zaïre de Mobutu était un pays en faillite avec une inflation qui atteignait les 100 000%, tandis que les autres pays amorçaient leur redressement. Les problèmes de dettes du pays ont commencé dans les années 70, alors que chez les autres c’est dans les années 80. Le pays importait des denrées alimentaires de base, bien qu’ayant la plus vaste superficie arable du continent. Ce paradoxe montrait indiscutablement que quelque chose avait été faussé dès le départ.
Aujourd’hui les difficultés persistent. Depuis pratiquement 30 ans, le pays ne parvient pas à stabiliser les régions de l’Est. La richesse de son sous-sol attise toujours les convoitises de ses voisins, et alimente une contrebande que le pouvoir ne peut réprimer. L’est du pays a toujours abrité des maquis et des mouvements plus ou moins armés qui se financent sur le trafic des pierres précieuses, ce qui se poursuit de nos jours. Une chose est certaine cependant, le pays doit miser sur son agriculture, il doit retourner aux « fondamentaux agricoles », passage obligé pour lui. La RDC doit se concentrer sur son agriculture. Avant l’indépendance, le pays était le second producteur mondial de palmier à huile, et une producteur de premier plan de café et d’hévéa.
Il faut créer une seconde capitale un peu plus à l’Est ou au centre du pays afin d’avoir le contrôle des provinces qui s’y trouvent. Vu la taille du pays et vu la faiblesse des moyens de l’Etat, les régions de l’Est ne peuvent pas être contrôlées depuis Kinshasa. Celle-ci peut demeurer la capitale économique, mais il faut déplacer la capitale politique vers l’Est, par exemple choisir la ville de Kisangani, qui se trouve être la troisième ville du pays et située idéalement. Il faut suivre l’exemple du Nigéria avec sa capitale politique Abuja, exactement au centre du pays.
Dans le court terme, c’est surtout la corruption qu’il faut combattre. Bien sûr, il n’y a pas de pays où le mal ne sévit pas, surtout en Afrique. Mais il y a ce qu’on peut appeler les seuils de tolérance. En RDC la corruption est endémique, elle sape les fondements de l’Etat. Alors que le pays est en guerre, l’argent alloué à l’achat des équipements est détourné, les soldes n’arrivent pas aux troupes, et même des équipements commandés par l’armée nationale se retrouvent souvent aux mains des groupes armées. La contrebande dans les mines est aussi un fléau à combattre. La RDC doit comprendre que les mines ne lui ont pas apporté le développement, les mines ont « tué » son agriculture.
Douglas Mountain
oceanpremier4@gmail.com
Le Cercle des Réflexions Libérales


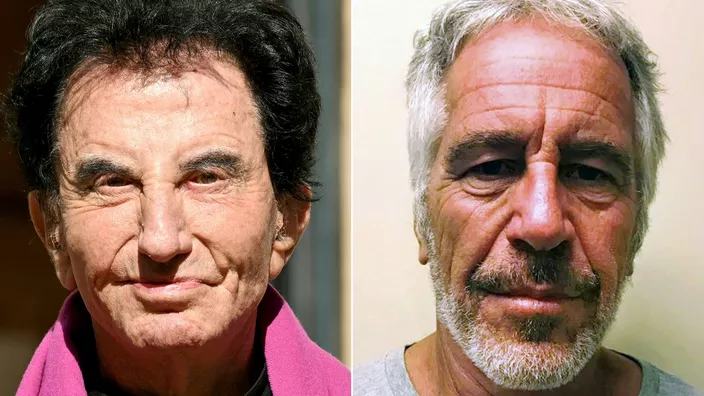




Commentaires Facebook