L’essor incontrôlé de l’orpaillage illégal et de l’exploitation minière sauvage en Côte d’Ivoire est un symptôme alarmant d’un État en perte de contrôle face aux intérêts économiques occultes. Ce phénomène, qui s’est aggravé avec les années, n’est pas seulement une question environnementale : il touche à la souveraineté nationale, à la sécurité des populations et à l’intégrité de l’État.
1. Une catastrophe écologique en marche
L’exploitation aurifère illégale et certaines pratiques des sociétés minières autorisées ont des effets dévastateurs sur l’environnement. L’utilisation massive de produits chimiques toxiques, comme le mercure et le cyanure, contamine les rivières et les nappes phréatiques. Cette pollution entraîne :
• L’empoisonnement des écosystèmes aquatiques : Chaque semaine, des poissons meurent en masse dans plusieurs cours d’eau du pays, privant des milliers de personnes d’une source de nourriture et de revenus.
• Des sols dévastés : Les forêts ivoiriennes sont grignotées par des exploitants qui, sans reboisement ni précautions, transforment des terres fertiles en paysages lunaires.
• Une contamination de la chaîne alimentaire : L’eau polluée utilisée pour l’agriculture finit dans les assiettes des populations, exposant les Ivoiriens à des maladies graves (intoxications, cancers, malformations congénitales).
Le plus dramatique est que cette situation est connue des autorités, mais ces dernières restent passives, se contentant d’annonces creuses.
2. Orpaillage illégal : Une industrie parallèle incontrôlée
L’orpaillage clandestin est principalement dominé par des réseaux venus du Mali et du Burkina Faso, souvent composés d’orpailleurs traditionnels, mais aussi de groupes organisés bénéficiant de complicités locales. Ces réseaux ont prospéré grâce à plusieurs facteurs :
• L’absence de contrôle des frontières : Les orpailleurs et trafiquants passent librement entre les pays du Sahel et la Côte d’Ivoire.
• Des complicités internes : Certains acteurs locaux et figures influentes ferment les yeux ou facilitent l’implantation de ces exploitants en échange de pots-de-vin.
• Le rôle des acheteurs clandestins : Une grande partie de l’or extrait illégalement échappe au circuit officiel et est revendue sur des marchés parallèles, souvent hors du pays.
Cette industrie parallèle représente des milliards de francs CFA qui échappent à l’État ivoirien, affaiblissant encore plus ses capacités d’intervention.
3. Une reproduction des réseaux de contrebande de la rébellion
Cette situation n’est pas nouvelle. Elle trouve ses racines dans la période de la rébellion armée des années 2000, durant laquelle des circuits de contrebande ont été mis en place pour exploiter les richesses ivoiriennes au profit de certains groupes politico-militaires.
À l’époque, les rebelles avaient pris le contrôle des zones agricoles et minières, imposant des taxes illégales sur le cacao, le café, le diamant et même l’or. Aujourd’hui, bien que la guerre soit officiellement terminée, ces circuits n’ont jamais disparu. Ils ont simplement évolué, changeant de mains et de méthodes, mais continuant d’enrichir des réseaux mafieux au détriment du pays.
La Côte d’Ivoire assiste donc à une répétition de l’histoire, où des groupes privés pillent les ressources du pays sous l’œil complice d’une élite qui préfère détourner le regard.
4. Un contraste flagrant avec les pays voisins
Pendant que la Côte d’Ivoire sombre dans un laisser-faire inquiétant, certains pays de la région prennent des mesures strictes pour protéger leurs ressources et leur population.
• Au Ghana, le gouvernement a déclaré la guerre aux orpailleurs illégaux, envoyant l’armée pour démanteler les sites clandestins et arrêter les contrevenants.
• Au Sénégal, des lois ont été mises en place pour encadrer strictement l’exploitation minière, avec des contrôles rigoureux sur les produits chimiques utilisés.
• Au Burkina Faso, bien que confronté à l’insécurité, le gouvernement a mis en place des mesures pour sécuriser les zones minières et interdire l’accès aux groupes criminels.
En comparaison, la Côte d’Ivoire semble abandonnée à elle-même, sans vision ni volonté politique réelle pour stopper ce fléau.
5. Pourquoi l’État ivoirien reste-t-il inactif ?
Face à cette catastrophe, la question se pose : Pourquoi les autorités ne réagissent-elles pas de façon sérieuse ?
Des intérêts économiques puissants en jeu
Les grandes sociétés minières, locales et étrangères, exercent certainement une pression énorme sur le gouvernement pour maintenir un cadre laxiste, leur permettant d’exploiter les ressources sans contraintes. Ces entreprises ont souvent des liens étroits avec des figures politiques influentes.
Une corruption systémique
Le secteur extractif est l’un des plus corrompus du pays. Des permis sont attribués sans transparence, des pots-de-vin circulent à tous les niveaux, et les rares opérations de contrôle servent davantage à neutraliser des concurrents qu’à réellement appliquer la loi.
Une absence de volonté politique
L’État ivoirien se contente de discours et d’effets d’annonce sans jamais prendre de mesures concrètes. Les autorités préfèrent gérer les crises au coup par coup, sans stratégie à long terme pour sauvegarder les ressources du pays.
6. Les conséquences pour la population : un pays sacrifié
Le peuple ivoirien est le grand perdant de cette situation :
• Santé publique en danger : L’eau et les sols contaminés augmentent le nombre de maladies chroniques et de malformations.
• Appauvrissement des populations rurales : Les paysans voient leurs terres détruites par l’exploitation minière, rendant impossible toute activité agricole durable.
• Insécurité croissante : La présence de groupes armés et de trafiquants dans certaines zones minières alimente l’insécurité et le banditisme.
Un avenir inquiétant si rien n’est fait
Si cette situation continue, la Côte d’Ivoire risque de :
1. Perdre définitivement ses ressources naturelles, avec un territoire mutilé et pollué pour des générations.
2. Voir naître de nouveaux conflits, car la gestion anarchique des mines attise déjà des tensions entre communautés et exploitants.
3. S’appauvrir encore plus, car l’or qui pourrait financer le développement national profite surtout à des intérêts privés et étrangers.
Conclusion : Quelle solution ?
Face à cette catastrophe, le peuple ivoirien ne peut plus se contenter d’attendre. Il est essentiel d’exiger :
• Un encadrement strict du secteur minier, avec des contrôles réels et des sanctions lourdes contre les contrevenants.
• Une interdiction des produits chimiques toxiques, pour limiter l’impact environnemental.
• Une lutte efficace contre la corruption, avec des enquêtes transparentes sur l’attribution des contrats miniers.
• Une implication de la société civile, pour surveiller et dénoncer les abus.
L’avenir du pays en dépend. Le silence et l’inaction ne sont plus des options.
© DR KOCK OBHUSU, ÉCONOMISTE, INGÉNIEUR
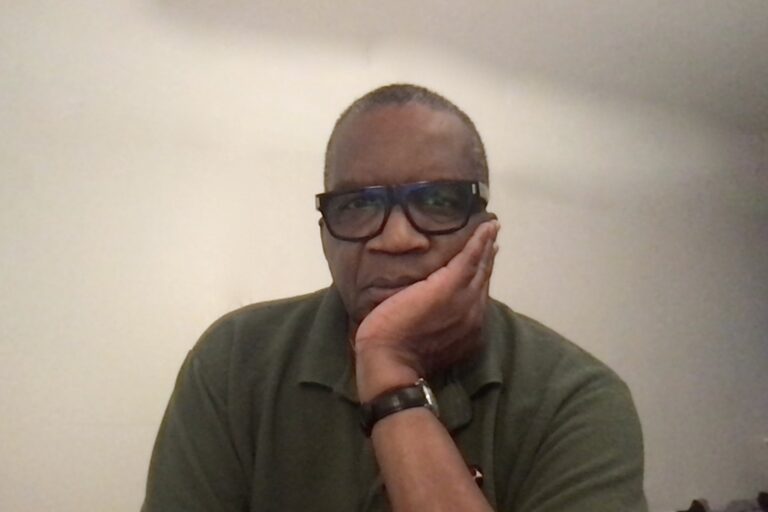
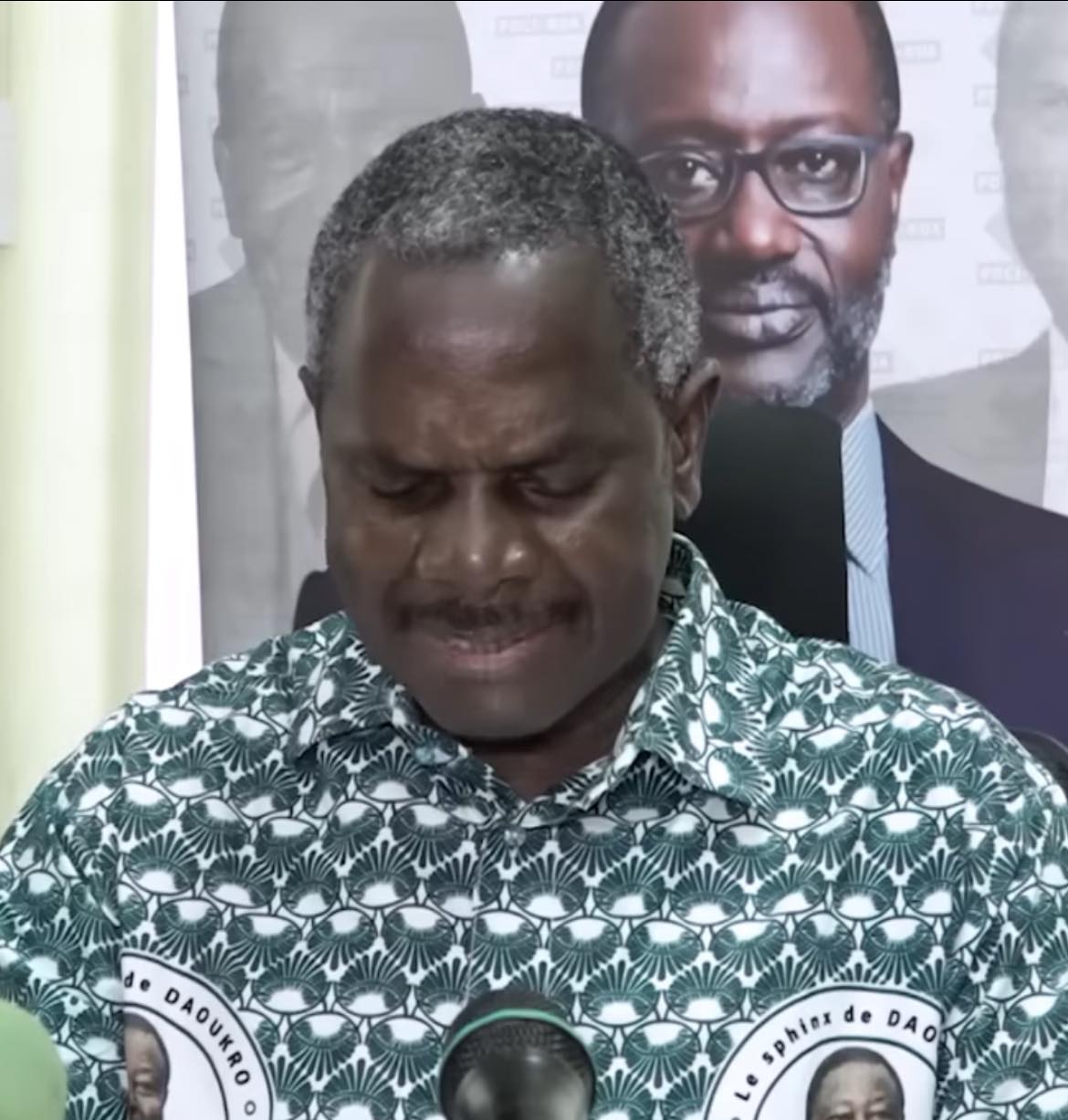



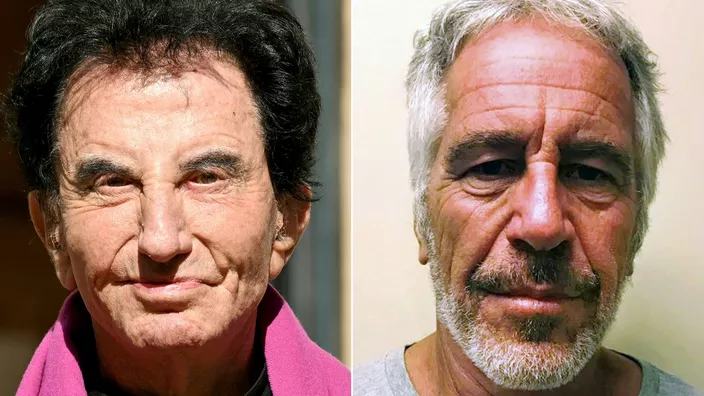

Commentaires Facebook