Reportage – Dans le centre du Mali, Djenné est l’une des rares localités dans lesquelles les symboles de l’État sont encore visibles. Mais si la célèbre cité, dont la ville ancienne est inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco, vit dans une relative stabilité, la guerre est dans tous les esprits. Tout près, les groupes djihadistes et les dozos font régner la terreur.
Djenné, fin avril 2024. C’est un lundi, jour de la foire hebdomadaire de cette ville malienne à l’histoire millénaire, située à 130 km au sud-ouest de la capitale régionale, Mopti, dans le centre du pays, et à environ 570 km au nord-est de Bamako. À première vue, le marché local semble bondé, aux alentours de la prestigieuse mosquée. Mais pour les forains, ce n’est plus comme avant. Ils pointent du doigt la situation sécuritaire dans certaines localités environnantes.
« Dans certains endroits du cercle de Djenné, ça ne va pas. Et cela nous impacte inéluctablement. Avant, notre foire, qui est un héritage, était très convoitée. Elle était souvent fréquentée jusqu’au crépuscule. Maintenant, ce n’est plus le cas. Dès 14 heures, après la prière, le marché se désemplit. Ça en dit long sur la situation », témoigne Djénéba Cissé, présidente de l’association Djikké, qui œuvre dans le domaine de l’assainissement, de la transformation agroalimentaire et de l’amélioration des conditions des femmes. « Il faut reconnaître que depuis neuf ans, voire plus, Djenné a senti les impacts de la crise sécuritaire dans le pays », ajoute Mohamed (prénom modifié), leader d’une organisation locale des jeunes qui préfère ne pas révéler son identité pour des raisons de sécurité.
Kalilou Djeïte est un commerçant détaillant, propriétaire d’une grosse boutique dans cette ville considérée comme l’une des plus anciennes d’Afrique subsaharienne. Voilà plus de vingt ans qu’il évolue dans cette activité. D’après lui, les impacts de la crise sécuritaire se font de plus en plus ressentir. Et cela, à cause notamment des difficultés que lui et ses concurrents rencontrent dans leur approvisionnement, mais aussi à cause de la hausse des coûts des produits et de l’évolution du marché : désormais, il y a plus de commerçants que de clients. « Même les commerçants de Sofara viennent vendre ici de nos jours. On ne sait pas comment ils trouvent leurs marchandises, mais le marché n’est plus fructueux », explique-il, assis devant sa boutique, non loin d’un bâtiment qui abritait autrefois l’agence d’une grande banque qui a quitté la ville. « Nous manquons d’argent, et le prix des produits a augmenté. Tous ceux qui achetaient deux sacs de riz [50 kg chacun, NDLA] sont obligés d’en acheter un seul aujourd’hui, voire un demi-sac, ajoute-t-il. Nous ne connaissons que le commerce et, en tant que commerçants, nous n’avons jamais bénéficié d’aucune aide de la part des ONG ou encore de l’État. »
Des échanges « au péril de ta vie »
À Djenné, l’économie locale est basée sur l’agriculture, l’élevage et la pêche, le commerce, l’artisanat et le tourisme. « Toutes ces activités ne se déroulent plus comme autrefois en raison de l’insécurité. Les gens partaient dans les villages pour y faire des échanges, vendre ou acquérir des marchandises. Mais maintenant, c’est compliqué. Si tu le fais, c’est aux dépens de ta vie, avec tous les risques qu’on connaît », indique Ousmane Yattara, un notable et un enseignant à la retraite. Mais, pour Ibrahima (prénom modifié), un autre dignitaire de la ville, et lui aussi un ancien fonctionnaire de l’État à la retraite, tout n’est pas à jeter dans la commune : « On peut dire que tout va bien à Djenné ville, puisque nous mangeons tranquillement et nous dormons vraiment sans problème. Et nous vaquons à nos activités. Les fonctionnaires également, chacun va au service à l’heure et retourne à la maison sans souci. Donc nous ne sommes pas aujourd’hui inquiétés par rapport à tout ce que nous entendons. »
Ibrahima soutient qu’« il n’y a pas de problème au niveau de l’accès à Djenné » – même s’il y a parfois des attaques de groupes armés – quand on vient de l’axe Sevaré-San-Ségou et de la capitale, Bamako. Cela s’explique notamment par la présence des Forces armées maliennes (FAMa) au niveau de l’intersection menant à la ville, connue sous le nom de « Djenné carrefour ». À l’entrée aussi, aux alentours du barrage de Djenné, en cours de finalisation, dont le site de construction a été incendié le 8 mars 2018 par une trentaine de présumés djihadistes, le dispositif sécuritaire mis en place est « impressionnant et dissuasif ». Dans cette ville réputée notamment pour son architecture soudanaise remarquable et sa trame urbaine, les FAMa sont aux aguets.
« Mais il y a des endroits aux alentours de Djenné où réellement il y a des problèmes. Ces problèmes sont dus en partie à la collaboration de ces communautés avec les groupes djihadistes qui les ont forcées à signer des pactes avec eux. Quand tu acceptes de les signer, tu es obligé de travailler avec ces gens-là. Si tu ne le fais pas, ils te rendent la vie dure », relève Ibrahima. Or, ajoute-t-il, « quand il y a des problèmes au niveau des villages environnants, obligatoirement, il y a des impacts sur la ville. Les prix notamment, augmentent quasi automatiquement. »
Le cercle de Djenné comprend douze communes, pour une population totale estimée en octobre 2022, selon les données internes de la Direction nationale de la population, à 319 798 personnes. Celle de la seule commune du chef-lieu du cercle, d’après la même source, s’élève à 40 305 individus.
Dans la commune rurale
de cette ville cosmopolite, on parle beaucoup d’un marabout de la région de Ségou, dénommé Komani Tanapo, supposé être mort en prison en mars 2024. Avant d’être arrêté par les FAMa, il jouait un grand rôle pour faciliter la cohabitation entre les populations de certains villages et les groupes djihadistes, à travers notamment les missions de bons offices. « Komani Tanapo avait compris qu’il fallait collaborer avec les djihadistes pour avoir moins de problèmes avec eux. Des pactes de non-agression ont pu être signés entre des villages et les djihadistes, et chaque année, après la récolte, la zakat [une taxe, NDLR] imposée par les djihadistes est payée en espèces, en bétail ou en céréales par les villageois. C’est lui qui s’était porté garant de ces accords », confie une source locale. Mais cela a fait des envieux.
« À un moment donné, les dozos [des groupes armés dits d’autodéfense en partie constitués de chasseurs traditionnels, NDLR] se sont divisés en plusieurs groupes pour cause de conflit d’intérêts. Certains d’entre eux ont commencé à s’offrir des voitures, d’autres ont construit des maisons. Ceux qui n’arrivaient pas à avoir de l’argent se sont mis à former d’autres clans. Pour pouvoir extorquer de l’argent auprès de la population, aller agresser certains villages pour obtenir des butins de guerre, ils ont estimé qu’il fallait annuler certains accords passés avec les djihadistes. C’est à ce moment que des messages vocaux ont fait croire que le marabout était un complice des djihadistes. Du coup, il est devenu un problème pour les autorités. »
Depuis son arrestation et son enterrement le 19 mars dans son village natal, « il n’y a plus de stabilité dans la zone, poursuit notre source. Ceux qui ont signé les accords se sont vu automatiquement menacés. Ils ont commencé à plier bagage, surtout la communauté peule. Quelques villages bambaras ont également fait l’objet d’attaques et de blocus. Du coup, ces villages ont aussi été désertés. Après des affrontements entre combattants djihadistes et groupes dozos, les chefs-lieux des communes ont tous signé des accords renégociés ». Dans un rapport publié le 8 mai 2024, l’organisation internationale de défense des droits humains Human Rights Watch a indiqué qu’« un groupe armé islamiste lié à Al-Qaïda [avait] tué au moins 32 civils, dont 3 enfants, et incendié plus de 350 maisons dans le centre du Mali en janvier 2024, forçant environ 2 000 villageois à fuir. Début janvier, une milice ethnique a tué au moins 13 civils, dont 2 enfants, enlevé 24 autres civils et pillé des biens et du bétail dans le centre du Mali ».
À Djenné, les groupes djihadistes et les dozos sont mal perçus par certains. « Au début, on pensait que les dozos étaient l’émanation de la population puisqu’on connaissait leur rôle de protection de génération en génération. Avec l’avènement de cette crise, ils se sont organisés dans chaque village pour protéger la population, explique Ibrahima. Mais brusquement, on a vu un changement vers 2015. Ils ont commencé à tuer les civils. »
Ressouder le tissu social
Boubacar (prénom modifié) est un agent humanitaire établi dans la ville de Djenné. Il continue à se rendre dans certaines localités environnantes malgré le danger. « Pour accéder à certains villages, c’est très risqué. Car il y a souvent des mouvements d’hommes armés non identifiés. Cette insécurité joue beaucoup sur nos activités », raconte-t-il. En 2021, un mémorandum lu lors d’une marche de protestation organisée dans la ville indiquait, selon l’hebdomadaire malien Le Républicain*, que depuis le 4 avril de cette année-là, « le cercle de Djenné [avait] enregistré plus d’une vingtaine d’attaques avec 51 morts, 53 blessés, 260 ménages déplacés, des écoles fermées, plus de 10 000 bétails emportés et beaucoup de dégâts matériels ».
*Aguibou Sogodogo, « Grande marche de la population de Djenné contre l’insécurité : “Depuis le 4 avril 2021, le cercle de Djenné a enregistré plus d’une vingtaine d’attaques avec 51 morts, 53 blessés, 260 ménages déplacés…” », relayé en ligne par Maliweb le 24 août 2021.
Ismaël (prénom modifié) est un déplacé interne à Djenné depuis six ans. Il affirme avoir perdu tout son bétail dans son village. Mais par qui a-t-il été volé ? Le vieil homme pointe d’un doigt accusateur les djihadistes. « Mon enfant était parti pour faire pâturer les animaux. Pendant le pâturage, il est tombé sur des djihadistes. Ces derniers l’ont pris puis attaché quelque part pendant vingt-six jours. Après ils l’ont libéré, il est revenu, mais sans le troupeau. Les bovins sont restés avec eux », relate-t-il. Cette histoire est loin d’être un cas isolé. Aïssatou (prénom modifié), une jeune dame mariée et mère de deux enfants, a elle aussi trouvé refuge à Djenné après l’irruption des combattants djihadistes dans son village, Saré-Haïré. « C’était un mardi matin, vers 5 heures, il y a quatre ans de cela. Pendant trois jours, le sang a coulé et les gens se sont cherchés. C’est comme ça que nous sommes partis du village, sans rien à emporter avec nous », se remémore-t-elle. Aujourd’hui, Aïssatou coiffe des dames et fait la lessive pour gagner un peu d’argent.
Les survivants des attaques armées reconnaissent avoir été bien accueillis par la population de Djenné. « Certains déplacés ont été formés dans la couture, les tresses, la savonnerie. Les déplacés sont impliqués dans tout ce qui concerne notre ville. À chaque fois qu’il y a une activité, on leur donne un quota pour qu’ils puissent en bénéficier. Donc, ils sont considérés ici. Ce qui leur est arrivé peut nous arriver aussi », témoigne Djénéba Cissé, de l’association Djikké. « Certains sont venus de Saré-Haïré. À leur arrivée, un Djenneké a mis son terrain à leur disposition parce qu’on ne pouvait pas avoir de maisons pour les héberger tous. Le gouvernement a envoyé la protection civile pour implanter des tentes. Donc, eux, ils ont leur site. La deuxième couche est venue du cercle de Djenné. Eux aussi ont quelques tentes. Mais ils sont pour la plupart logés dans les maisons de Djenné », explique le notable Ibrahima.
Sa première rencontre avec les déplacés internes, narre-t-il, était avec une dame ne sachant où se mettre après avoir quitté son village. « Quand je l’ai vue errer dans la ville, je l’ai appelée. Elle a eu tellement peur qu’elle s’est cachée sous la charrette. Je l’ai ensuite approchée. Je lui ai dit : “Non, il ne faut pas avoir peur. Je viens pour vous aider.” J’ai commencé à jouer avec l’enfant pour la rassurer. C’est comme ça qu’elle s’est levée », raconte Ibrahima.
Selon les estimations de l’ONU, le nombre de personnes déplacées internes au Mali s’élevait à 354 000 en avril 2024
Au niveau de la commune, plusieurs initiatives locales ont été entreprises pour davantage favoriser la cohésion sociale et le vivre-ensemble. C’est dans cette perspective que la ville compte aujourd’hui une centaine d’associations œuvrant dans différents domaines. « Quand le problème a commencé, on n’avait plus confiance aux uns et aux autres. Chacun avait peur de l’autre, parce qu’on ne savait pas qui était qui. Ce qui a amené à instaurer une méfiance entre nous. Maintenant, il y a beaucoup d’associations qui se sont créées à Djenné pour qu’on puisse ressouder le tissu social », précise Ibrahima.
Photo archive: Devant la Grande Mosquée de Djenné, en mars 2015. © UN Photo/Marco Dormino


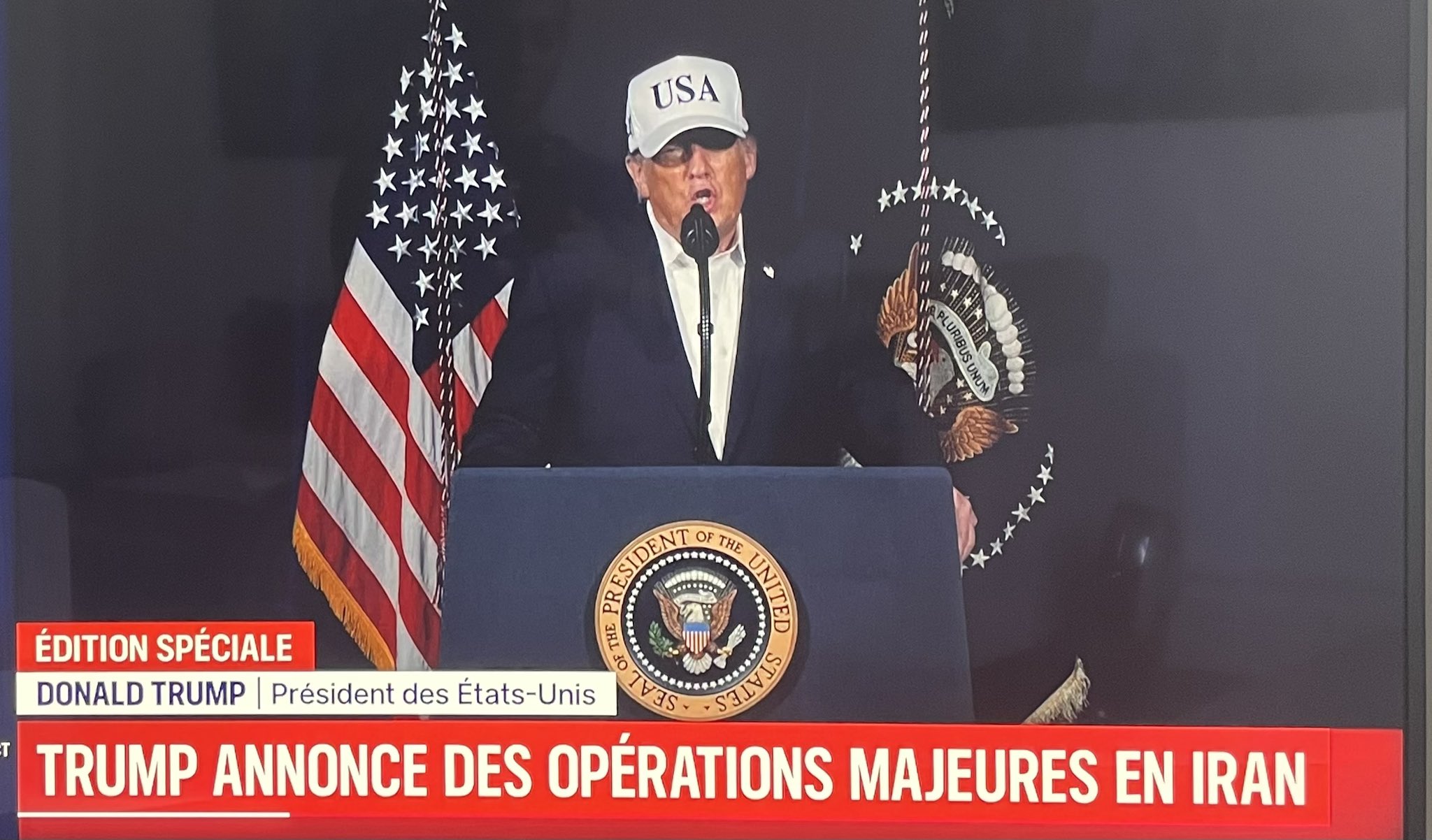
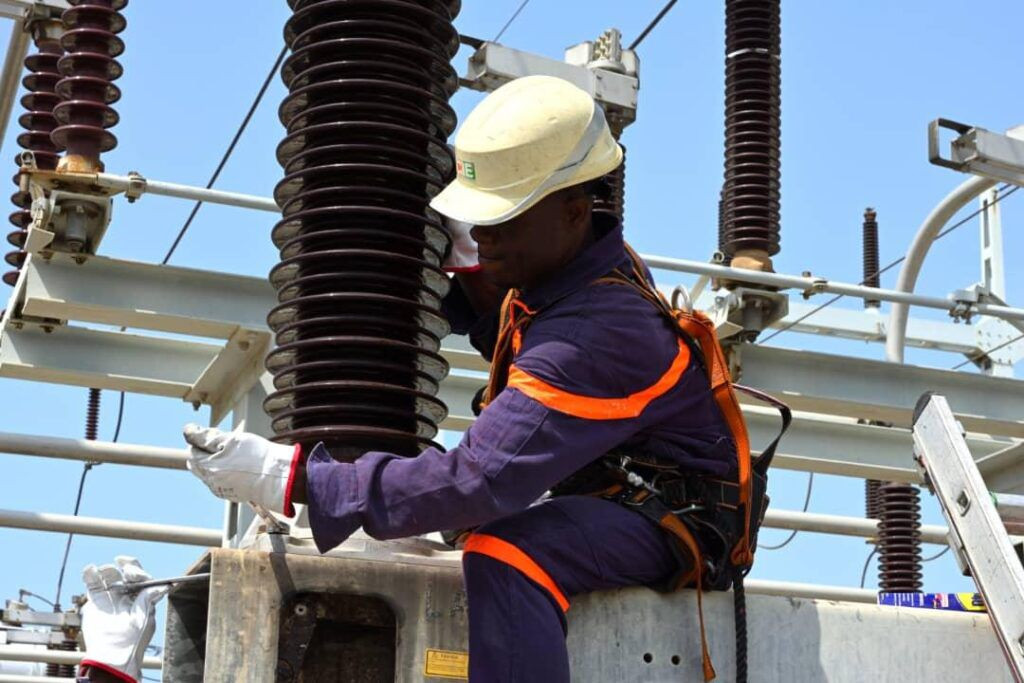



Commentaires Facebook