Trente-cinq ans après sa mort, Thomas Sankara continue d’être adulé et cité alors qu’il n’a gouverné que pendant quatre ans (1983-1987). Pourquoi est-il resté dans le cœur des Africains ? À quoi tient sa popularité ? Y a-t-il des domaines où il se distingua des autres chefs d’État africains ? Pourquoi la jeunesse africaine lui voue-t-elle la même admiration qu’à Patrice Lumumba ?
Thomas Sankara naît le 21 décembre 1949 à Yako dans un pays qui s’appelle encore la Haute-Volta. Son père est un peul et sa mère une moaga (singulier des “mossi”). Il fréquente tour à tour le lycée Ouezzin Coulibaly de Bobo-Dioulasso et le Prytanée militaire de Ouagadougou. Plus tard, il bénéficie, en même temps que Blaise Compaoré, d’une formation d’officier à l’École militaire inter-armes (EMIA) de Yaoundé (Cameroun), puis à l’Académie militaire d’Antsirabe (Madagascar). La révolution malgache de 1972, qui balaie le régime de Philibert Tsiranana, a lieu devant lui. L’année suivante, il rentre en Haute-Volta avec le grade de sous-lieutenant. Affecté à la formation des jeunes recrues, il se fait remarquer en introduisant dans la formation militaire un enseignement sur les droits et les devoirs du citoyen car, pour lui, “sans formation politique patriotique, un militaire n’est qu’un criminel en puissance”. En 1974, un conflit éclate entre le Mali et la Haute-Volta. Sankara s’illustre positivement au cours de ce conflit. Après la “guerre des pauvres”, il noue des contacts avec des militants d’extrême gauche en même temps qu’il lit beaucoup. En 1976, il devient commandant du Centre national d’entraînement commando de Pô. La même année, lui et Compaoré font un stage d’aguerrissement au Maroc. Les deux hommes créent le Regroupement des officiers communistes (ROC). Henri Zongo, Boukary Kaboré et Jean-Baptiste Boukary Lingani feront partie du ROC.
En novembre 1980, l’armée prend le pouvoir mais, très vite, le nouveau régime tombe dans les travers de celui qu’il a renversé (répression des syndicats et scandales financiers). En septembre 1981, Sankara, qui jouit d’une grande popularité, est nommé secrétaire d’État à l’Information dans le gouvernement du colonel Saye Zerbo. Il en démissionne quelques mois plus tard pour condamner la suppression du droit de grève. Le 21 avril 1982, en effet, il met en garde ceux qui bâillonnent le peuple. Il est immédiatement dégradé et éloigné de la capitale.
Le 7 novembre 1982, Saye Zerbo est renversé. Le médecin militaire Jean-Baptiste Ouédraogo est porté au pouvoir, pas parce que le coup d’État avait été fait pour lui, mais parce que Sankara s’était désisté au dernier moment. En janvier 1983, Sankara est nommé Premier ministre du Conseil de salut du peuple (CSP). Sans tarder, il souhaite la rupture du rapport néocolonial qui lie la Haute-Volta à la France et promet d’enterrer l’impérialisme. En avril 1983, il invite le Libyen Mouammar Kadhafi à Ougadougou. Le 17 mai, il est démis de ses fonctions et mis en résidence surveillée. Mais, devant les manifestations populaires soutenues par les partis de gauche et les syndicats, le pouvoir est obligé de le libérer. Le 4 août 1983, la garnison de Pô débarque à Ouagadougou. Elle est ovationnée par une foule en liesse. Placé à la tête du Conseil national révolutionnaire, Thomas Sankara forme un gouvernement avec le Parti africain de l’indépendance (PAI) et l’Union des luttes communistes – reconstruite (ULC-R). Mais que compte-t-il faire avec le pouvoir ? “Refuser l’état de survie, desserrer les pressions, libérer nos campagnes d’un immobilisme moyenâgeux ou d’une régression, démocratiser notre société, ouvrir les esprits sur un univers de responsabilité collective pour oser inventer l’avenir. Briser et reconstruire l’administration à travers une autre image du fonctionnaire, plonger notre armée dans le peuple par le travail productif”. Le 4 août 1984, il change le nom du pays : la Haute-Volta est rebaptisée Burkina Faso (deux mots moré et dioula qui signifient “la patrie des hommes intègres”). Il donne les pouvoirs des chefs traditionnels aux Comités de défense de la révolution (CDR), inspirés de l’expérience cubaine et chargés d’exercer localement le pouvoir au nom du peuple. Les CDR commettront malheureusement des excès qui seront condamnés par Sankara. Le régime lui-même viole les droits de l’homme en exécutant 7 personnes impliquées dans le putsch manqué du 28 mai. À l’actif du bilan du gouvernement, on peut citer la construction de retenues d’eau par les paysans, le port de l’habit traditionnel (faso dan fani) par les fonctionnaires, l’interdiction de la dot, des mariages forcés et de l’excision, la fin des coupes de bois abusives, la diminution des dépenses de fonctionnement, la gratuité des loyers pendant un an, le refus des aides alimentaires “qui installent dans nos esprits des réflexes de mendiant, d’assisté” et la fin des importations de fruits et légumes. L’aide économique française est réduite de 80 % entre 1983 et 1985. En 1986, le pays est capable d’offrir deux repas et dix litres d’eau par jour à chaque citoyen, ce qui vaut à Sankara d’être félicité par le Rapporteur spécial pour le droit à l’alimentation pour les Nations unies en ces termes : “Il a vaincu la faim, il a fait que le Burkina, en quatre ans, est devenu alimentairement autosuffisant.” Pour donner l’exemple, Thomas Sankara vit modestement en se déplaçant dans une Renault 5, en voyageant peu et en percevant un petit salaire.
Au niveau international, il dénonce les injustices de la mondialisation, le système financier qui enrichit une minorité et le poids de la dette des pays du Sud, une dette dont il conteste la légitimité à Addis-Abeba en 1987 et qu’il appelle les pays africains à ne pas rembourser. Sankara se définissait comme un anti-impérialiste. Lorsque François Mitterrand arrive au Burkina Faso en novembre 1986, il lui reproche publiquement d’avoir reçu Pieter Botha, le Premier ministre sud-africain, et Jonas Savimbi, chef de l’UNITA, l’un et l’autre couverts de sang, des pieds jusqu’à la tête”. Il coopère étroitement avec Cuba où il envoie, en septembre 1986, 600 jeunes qui, après une formation professionnelle, devraient participer au développement du Burkina. Il dénonce le soutien des États-Unis à Israël et à l’Afrique du Sud, l’invasion de la Grenade par les États-Unis, demande la fin du droit de veto accordé aux grandes puissances, se prononce en faveur du Sahara occidental, de la Palestine, des sandinistes nicaraguayens et de l’ANC.
Dès lors, la France, à travers le socialiste Guy Penne, et plusieurs régimes africains proches de Paris vont s’employer à le renverser. Compaoré et Sankara se parlent de moins en moins. La méfiance commence à s’installer entre les deux frères et amis. Le 15 octobre 1987, Sankara est assassiné. D’après le témoignage d’Alouna Traoré, le seul survivant, Thomas Sankara sortit de la salle où il était en réunion avec 12 autres personnes, les mains en l’air, en disant aux membres de son cabinet : “Ne bougez pas, c’est de moi qu’ils ont besoin.” Treize jours avant le drame, il déclarait : “Notre révolution n’aura de valeur que si, en regardant derrière nous, en regardant à nos côtés et en regardant devant nous, nous pouvons dire que les Burkinabè sont, grâce à elle, un peu plus heureux. Parce qu’ils ont de l’eau saine à boire, parce qu’ils ont une alimentation abondante, suffisante, parce qu’ils ont une santé resplendissante, parce qu’ils ont l’éducation, parce qu’ils ont des logements décents, parce qu’ils sont mieux vêtus, parce qu’ils ont droit aux loisirs, parce qu’ils ont l’occasion de jouir de plus de liberté, de plus de démocratie, de plus de dignité. La révolution, c’est le bonheur. Sans le bonheur, nous ne pouvons pas parler de succès.”
Est-ce pour apporter ce bonheur que Compaoré le fit passer de vie à trépas ? Pendant les 27 ans de son règne sans partage, l’ancien dictateur fit-il de ses compatriotes des gens heureux ? On ne peut qu’en douter quand on sait que les mêmes compatriotes le chassèrent du pouvoir en octobre 2014. Compaoré, qui estimait, dans ‘Jeune Afrique’ du 30 mai 1989, que Thomas Sankara avait trahi la révolution d’août 1983 et qu’il n’avait pas à avoir pitié des traîtres, a récemment demandé pardon à la famille de Sankara et au peuple burkinabè. L’ancien homme fort de Ouaga éprouve-t-il un sincère remords ou bien s’agit-il d’une ruse de sa part pour échapper à la prison à perpétuité et revenir au pouvoir ? Une chose est certaine : L’Afrique a perdu, le 15 octobre 1987, un héros, un leader qui savait allier le verbe et l’action (cf. Bruno Jaffré, ‘Thomas Sankara, la liberté contre le destin’, Paris, Syllepse, 2017), un homme qui a durablement marqué l’histoire de son pays et de son continent, un vrai révolutionnaire, un panafricaniste convaincu et convaincant. Sankara était tout cela mais il était, d’abord et avant tout, le frère, le compagnon et le paraclet (l’avocat) des humiliés et des défavorisés.
Jean-Claude DJEREKE



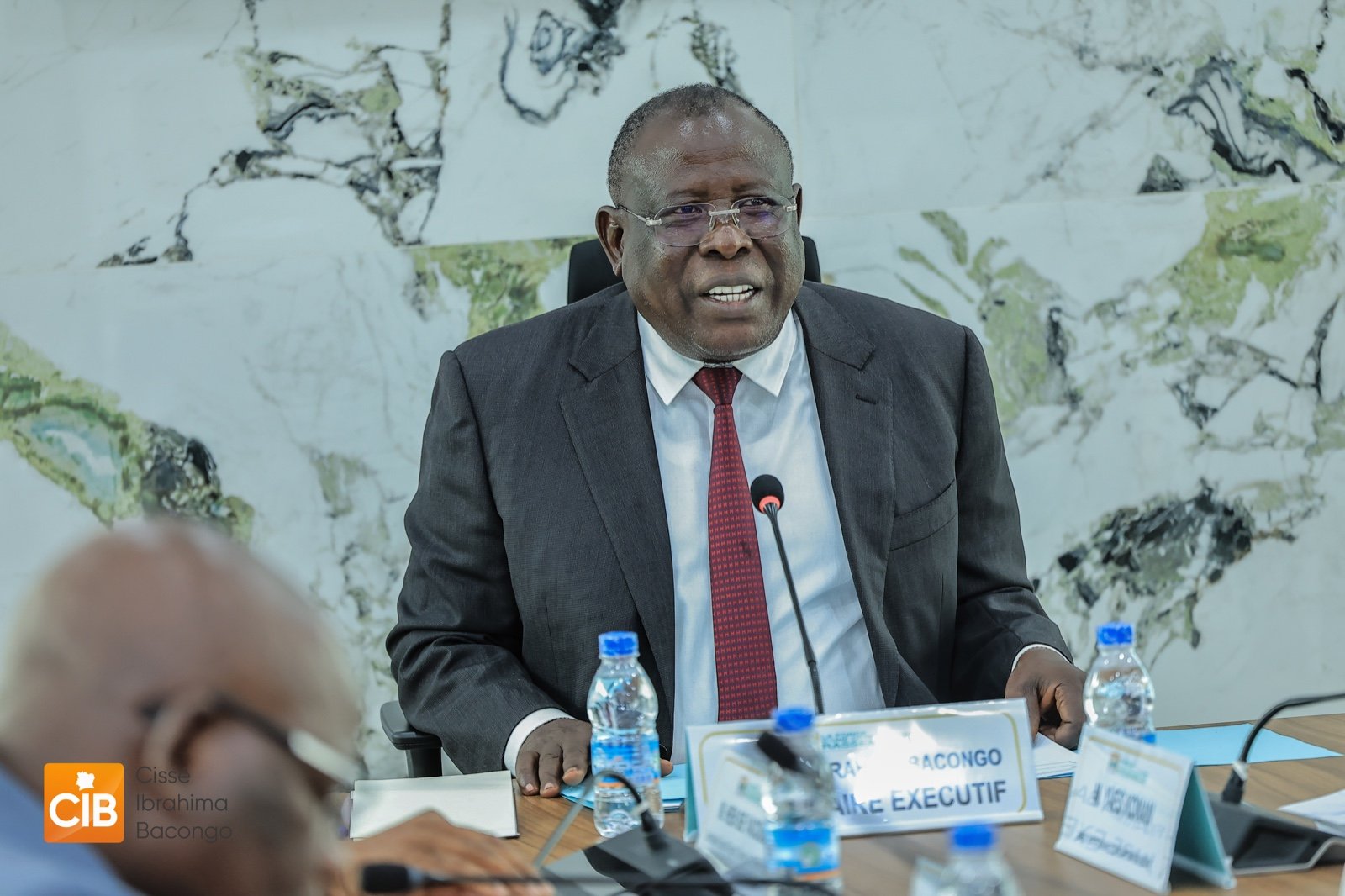



Commentaires Facebook