Sans cesse agité pour louer les performances prometteuses de nombreuses économies africaines, le concept d’« émergence » offre un label aux pays qui se plient aux dogmes néolibéraux, ainsi qu’aux injonctions du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale. Surtout, il cache mal des croissances en trompe-l’œil, qui ne profitent qu’à une minorité.
Par N’Dongo Samba Sylla
Il était une fois l’idée d’émergence du continent africain. Elle apparut sans doute en 1957 dans un rapport de Richard Nixon intitulé « The emergence of Africa » (1). Le vice-président des États-Unis venait alors de terminer une tournée africaine au cours de laquelle il rencontra une douzaine de dirigeants, dont les présidents Kwame Nkrumah (Ghana) et Gamal Abdel Nasser (Égypte). Où cheminerait l’Afrique au soleil des indépendances qui s’annonçaient ? Telle était la question principale d’un document qui trahissait la crainte que la « propagande » soviétique et la situation préoccupante des Noirs aux États-Unis fassent basculer l’Afrique postcoloniale vers le communisme. Il eût été irrespectueux de rappeler alors qu’on « émerge » de quelque chose, pas du vide. Deux décennies plus tard, quand les milieux financiers s’emparèrent de ce mot, les précautions langagières s’estompèrent.
L’expression « tiers-monde (2) » n’étant pas vraiment attrayante pour de potentiels investisseurs, en raison de l’image de pauvreté à laquelle elle était associée, le concept nouveau, et apparemment plus dynamique, de « marchés émergents » lui fut préféré au début des années 1980. Au temps de la Révolution française, la bourgeoisie montante créait des mots dans le but de tuer des choses, selon le journaliste socialiste Paul Lafargue (3). À l’ère néolibérale, nul besoin d’inventer des mots pour transformer la réalité, une activité qui demande du travail et de l’imagination. Il est plus rentable d’investir dans la polysémie : risque minimum et rendement maximum ! L’« émergence » devint une destination finale pour des pays dont l’historicité se résumerait désormais aux anticipations de croissance et de profitabilité de la finance globale.
Prise entre 1980 et 2000 dans l’étau de l’ajustement structurel décrété par le Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, l’Afrique était jusqu’alors exclue de la catégorie des « marchés émergents ». Le récit dominant brodait autour du mythe selon lequel, exception faite de l’Afrique du Sud, incluse dans l’acronyme des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), et, à un degré moindre, du Maghreb et de l’Égypte, elle était « marginalisée » par le train à grande vitesse de la mondialisation. Les causes de cette « marginalisation » dans le commerce mondial occupaient travaux universitaires et presse dominante (4). Ironie de l’histoire, les mêmes qui colportaient ce discours, destiné à justifier une plus grande libéralisation économique, commerciale et financière, se mirent à faire les louanges de l’Afrique émergente (« Africa rising ») du jour au lendemain, alors que la spécialisation économique du continent était restée la même. Après avoir qualifié l’Afrique de « continent sans espoir » en 2000 (5), The Economist fit amende honorable onze ans plus tard avec un titre qui reflétait l’air du temps : « The hopeful continent : Africa rising » (« Un continent d’espoir : l’Afrique émergente ») (6). Les cabinets de consultance embouchèrent la même trompette : « Lions on the move » (« Les lions se mettent en mouvement »), prédisait McKinsey Global Institute (7). Qu’est-ce qui avait donc changé ?
Un vivier de ressources inexploitées
Au sortir de deux décennies d’austérité imposée, à la fin des années 2000, la croissance économique était de nouveau au rendez-vous dans le contexte d’une plus grande stabilité politique et d’une hausse importante des cours des produits d’exportation du continent, essentiellement des matières premières. La rapide expansion des relations commerciales et financières entre les pays africains et la Chine avait également contribué à remodeler l’image du continent. Celui-ci apparaissait subitement comme un vivier de ressources inexploitées et comme un marché vaste et prometteur pour les entreprises étrangères rêvant de fournir biens, services et infrastructures à une population jeune appelée à doubler tous les vingt-cinq ou trente ans. La perception d’une « Afrique émergente » était alimentée par la hausse des fortunes locales : entre 2008 et 2012, le nombre d’Africains pouvant investir au moins 1 million de dollars est passé de 95 000 à 140 000 (8). Au niveau mondial, après la crise financière de 2007-2008, la mise en œuvre par les banques centrales des pays du Nord de politiques de taux d’intérêt nuls et d’assouplissement quantitatif créait une abondance de capitaux à destination des « marchés émergents », devenus attractifs en raison des rendements élevés qu’ils offraient. Beaucoup de pays africains auront mordu à l’hameçon à travers l’émission d’eurobonds — des obligations libellées en monnaie étrangère.
Ainsi, dans un rapport du Sénat français intitulé « L’Afrique est notre avenir » (9), on pouvait lire : « C’est aujourd’hui à une Afrique pleinement intégrée à la mondialisation que nous devons nous adresser. » Les pays francophones entendirent ce message flatteur et essayèrent de se montrer attractifs. Sur les quatorze États utilisant le franc CFA, seule la République centrafricaine, en proie à une instabilité politique chronique, manqua l’occasion d’adopter un programme économique dédié. Cas emblématique, le Sénégal nous instruit à propos des impasses de l’« émergence ».
En 2014, le plan Sénégal émergent (PSE) fixe l’horizon de celle-ci à 2035. Son orientation néolibérale est révélée, entre autres, par l’objectif de voir le pays figurer dès 2020 dans le Top 50 du classement « Doing Business » de la Banque mondiale (10), un indicateur dont la pertinence économique est douteuse (11). L’indicateur phare de l’« émergence », au Sénégal comme ailleurs sur le continent, est sans surprise la croissance annuelle du produit intérieur brut (PIB) réel (production mesurée en termes constants).
Bien que la phase 1 du PSE (2014-2018) ait accusé du retard, la bonne conjoncture économique — baisse des cours du pétrole, taux d’intérêt « abordables » comparés à la moyenne africaine, pluviométrie favorable — a permis un taux de croissance économique de l’ordre de 6 % par an depuis 2012. Ce chiffre, qui ferait pâlir d’envie les pays développés, doit cependant être interprété avec précaution. En 2015, le PIB par habitant du Sénégal en termes réels était du même ordre de grandeur que son niveau de 1960 — sa population étant entre-temps passée de 3,2 millions à 14,5 millions (12). Autrement dit, la croissance économique s’est inscrite pour l’essentiel dans une dynamique de rattrapage des « décennies perdues ». Elle a aussi été accompagnée d’une diminution des emplois salariés dans le secteur formel, dont le nombre est passé de 390 420 en 2012 à 300 284 en 2018 (13). Il s’agit donc d’une croissance sans emploi. En raison du rôle important joué par le capital étranger, le poids des paiements de revenus primaires (intérêts sur la dette extérieure, transferts de profits et de dividendes, rémunérations des experts étrangers) a augmenté, passant de 2,2 % à 4,4 % du PIB entre 2010 et 2017, selon la Banque mondiale. Autant de ressources en devises ôtées au financement du développement du pays.
Symbole d’une accumulation débridée, la dette publique extérieure qui avait été partiellement effacée au début des années 2000 dans le cadre de l’initiative pays pauvres très endettés (PPTE) et de l’initiative d’annulation de la dette multilatérale (IADM) s’est rapidement reconstituée, passant de 2,8 milliards de dollars à 12,5 milliards de dollars entre 2008 et 2018, dont une augmentation de près de 7 milliards de dollars pour la période 2014-2018, celle couvrant la phase 1 du PSE (14).
Le mythe d’une croissance « inclusive »
Si les ménages pauvres et les personnes handicapées ont pu bénéficier de bourses, la couverture maladie universelle demeure encore une promesse non tenue pour la majorité des Sénégalais, malgré son adoption officielle en 2013 (15). Le Sénégal n’est toujours pas sorti de la catégorie des « pays les moins avancés ». Au classement de l’indice de développement humain (IDH) du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), il est situé au 166e rang sur un total de 189 en 2019. Ce qui le place parmi les « pays à développement humain faible ».
À l’instar de la plupart des pays africains, le Sénégal a été, pour l’instant, relativement épargné sur le plan sanitaire par le coronavirus. En revanche, sur le plan économique, la pandémie a mis à nu les limites du projet d’« émergence ».
Un mythe à balayer est celui d’une croissance « inclusive ». Quelle peut être la signification de taux de croissance élevés pendant une décennie quand 52 % des ménages ruraux n’ont accès ni à l’eau ni au savon (16) et quand les coupures d’eau sont récurrentes dans beaucoup de quartiers de la capitale, Dakar ? En vertu de l’« urgence sanitaire », les autorités ont fermé les frontières et les écoles, interdit les rassemblements et les prières collectives, ainsi que la circulation entre les villes. Elles ont imposé le port obligatoire du masque dans les services publics, les commerces et les transports, et ordonné la fermeture des marchés à Dakar les samedis et dimanches. Le confinement total s’est révélé cependant impossible et financièrement hors de portée d’un gouvernement qui compte sur les solidarités sociales pour compenser ses mesures de soutien timides aux plus nécessiteux (aide alimentaire, subvention au paiement des factures d’électricité, etc.).
La pandémie a eu la vertu de mettre en évidence que le Sénégal était dominé au plan financier. N’ayant pas la possibilité de financer son déficit en monnaie nationale, le pays est plus que jamais dépendant de la sollicitude de l’extérieur sous forme de moratoires sur sa dette et d’octroi de nouvelles créances. Les récents prêts obtenus auprès du FMI ont pour contrepartie un « retour » à l’orthodoxie budgétaire dès l’année prochaine (17), lequel pourrait handicaper la reprise économique.
Ce dernier constat peut être généralisé à beaucoup de pays africains, comme le Ghana, le Kenya, la Zambie, l’Éthiopie, l’Angola, etc., qui ont vu leur stock de dette publique extérieure multiplié par quatre entre 2008 et 2018 (18). L’euphorie de l’« émergence », peut-on observer rétrospectivement, pouvait durer tant que les pays africains obtenaient de bons prix pour leurs produits d’exportation ou avaient la « confiance » de leurs créanciers.
La pandémie de Covid-19 ferme à grand fracas la page de l’« émergence ». Aujourd’hui, les populations africaines voient plus clairement les conséquences de l’absence de souveraineté monétaire, le danger de l’endettement extérieur, le piège du prétendu libre-échange, la nécessité de l’autosuffisance alimentaire, etc. Et elles se rendent compte de l’importance qu’il y a, pour l’Afrique, d’être unie face à un système multilatéral qui se fissure.
N’Dongo Samba Sylla





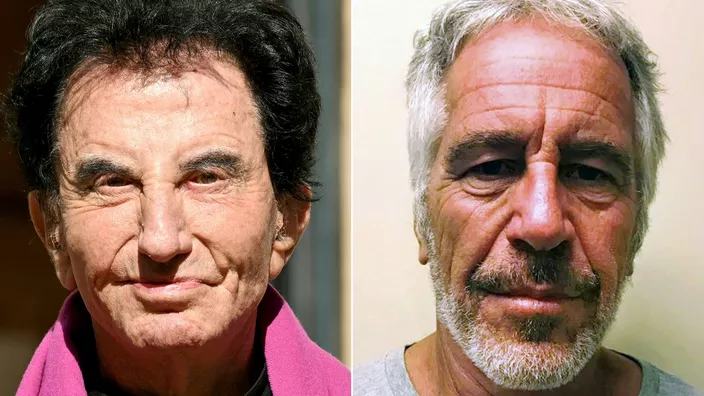

Commentaires Facebook