
Tandis qu’en Espagne l’exaspération née des choix économiques imposés par l’Union européenne vient de propulser plusieurs nouvelles formations politiques sur le devant de la scène, en France, c’est le Front national qui tire parti du mécontentement populaire. Désormais, ses idées inspirent presque tous ses adversaires. Et, paradoxalement, sa puissance les sert…
Par Serge Halimi in Le Monde diplomatiqueLe
Tout profite à l’extrême droite française : une économie en panne, un chômage dont la courbe s’envole au lieu de s’inverser, la hantise du déclassement et de la précarité, une protection sociale et des services publics menacés, un « projet européen » aussi savoureux qu’une gorgée d’huile de ricin, une vague migratoire que gonfle le chaos de plusieurs Etats arabes, des attentats de masse dont les auteurs se réclament de l’islam… Sans oublier, depuis près de trente ans, un Parti socialiste qui partage avec la droite à la fois la responsabilité de politiques néolibérales désormais cadenassées par les traités européens et le projet de se maintenir indéfiniment au pouvoir (ou, pour la droite, d’y revenir) en se présentant, élection après élection, comme le barrage ultime contre le Front national (FN).
Bilan : aucune force politique n’affiche autant d’entrain et de cohésion que l’extrême droite, aucune ne communique aussi efficacement le sentiment qu’elle connaît le chemin et que l’avenir lui appartient. Aucune n’ébauche non plus contre elle la moindre stratégie de reconquête (1).
Evincé du second tour de l’élection présidentielle par M. Jean-Marie Le Pen le 21 avril 2002, le premier ministre Lionel Jospin parlait déjà ce soir-là d’un « coup de tonnerre ». Et, tout en se retirant de la vie publique, il invitait alors ses camarades socialistes à se mobiliser « afin de préparer la reconstruction de l’avenir ». La tâche fut confiée à M. François Hollande…
Mais quand un phénomène politique comme celui-ci se développe depuis des décennies, il est vain de lui opposer une explication unique.
Ailleurs en Europe, des mouvements xénophobes ont prospéré sans qu’un parti socialiste au pouvoir ne le favorise (c’est le cas au Royaume-Uni, au Danemark), et dans des situations économiques moins dégradées qu’en France (en Pologne et en Suisse). Inversement, les taux de chômage de l’Espagne (21,6 % en septembre 2015), de la Grèce (24,6 %) ou de Chypre (15 %), tous supérieurs à ceux de la France (10,8 %), ne s’accompagnent pas d’une performance comparable de l’extrême droite. Enfin, le FN se portait déjà très bien avant les attentats meurtriers de janvier et de novembre 2015 à Paris, et avant l’afflux de migrants des derniers mois, même si, à l’évidence, ces événements l’ont servi. Comme, à vrai dire, à peu près tout.
Vieilles ficelles de la droite américaine
L’important n’est pas seulement que les candidats d’extrême droite sont arrivés en tête dans 6 régions sur 13 et dans 46 des 96 départements métropolitains à l’issue du premier tour des élections régionales, le 6 décembre 2015. C’est aussi qu’ils ont amélioré presque partout leurs scores une semaine plus tard, y compris quand ils n’avaient aucune chance de remporter la présidence d’une région. Autant dire que, désormais, pour un électeur frontiste, le vote utile, c’est le vote FN, et que ce parti, loin d’être une force supplétive absorbable par la droite, commence à braconner avec succès sur ses terres : de 18 % à 20 % des électeurs de M. Nicolas Sarkozy en 2012 auraient voté pour la formation de Mme Marine Le Pen en décembre dernier (2).
La détermination des électeurs d’extrême droite est d’autant plus significative que le mode de scrutin et le système d’alliances pénalisent lourdement leur parti. Premier en termes de suffrages à l’issue de ces régionales (c’était déjà le cas lors des scrutins européen de mai 2014 et départemental de mars 2015), celui-ci ne préside pas un seul conseil régional, pas un seul conseil général. Et il n’est représenté que par 2 députés sur 577, 2 sénateurs sur 348. Cette anomalie démocratique lui permet de continuer à se poser en victime d’une « classe politique » largement détestée, qu’il vitupère avec la sincérité de ceux qui en sont écartés (3).
Sur le terrain des idées, en revanche, il domine la scène. La chose lui est d’autant plus facile que ses adversaires intellectuels, encombrés de tristesse, de défaites, de scissions et de divisions, trouvent trop souvent confort et réconfort dans le radicalisme de papier des enclos universitaires (4). Les grands médias ne lui compliquent pas non plus la tâche quand ils alternent un dossier sur « l’islam sans gêne » et un autre sur les penseurs réactionnaires.
Traditionnellement, la victoire d’une majorité de gauche coïncidait avec une radicalisation de la droite, laquelle se sentait dépossédée d’un bien — le pouvoir — qu’elle estimait lui appartenir. Dans le cas de M. Hollande, l’hostilité qu’il suscite dans les cercles conservateurs est plus déconcertante, car on voit mal en quoi ses politiques se distinguent des leurs, exception faite du « mariage pour tous », contre lequel ils se sont en effet mobilisés il y a trois ans, mais sur lequel chacun sait qu’ils ne reviendront pas (5).
Comme l’extrême droite, la « droite décomplexée » adore fustiger le « politiquement correct ». Le phénomène n’est pas exclusivement français (6). Aux Etats-Unis, chacune des saillies actuelles du candidat républicain Donald Trump contre les Mexicains « violeurs » ou les musulmans « terroristes » permet au milliardaire new-yorkais de souligner le courage qu’il aurait à rompre ainsi avec le consensus mou de la gauche, des intellectuels, des bourgeois, des snobs. Effet garanti : les médias feignent de s’indigner, puis lui donnent aussitôt la parole pour qu’il s’explique. Au point qu’on n’entend plus que lui. Faut-il expulser d’un coup onze millions d’immigrés clandestins ? Bâtir un mur tout le long de la frontière avec le Mexique ? Ficher les musulmans citoyens des Etats-Unis et interdire aux autres l’accès du territoire ? Chaque semaine ou presque surgit un « débat » de ce genre. S’opposer à de telles idées revient à démontrer sa couardise, son laxisme, son mépris des aspirations de la « majorité silencieuse », voire à exposer son pays à de nouveaux assauts subversifs.
M. Sarkozy est familier de ces vieilles ficelles de la droite américaine (7). Le 9 décembre dernier sur France Inter, il a donc pourfendu une nouvelle fois « cette bien-pensance qui interdit les débats ». Quels débats seraient interdits selon lui ? « Dès que quelqu’un disait quelque chose sur l’immigration, il était raciste ; dès que quelqu’un prononçait le mot “islam”, il était islamophobe ; dès que quelqu’un posait une question sur l’identité française, c’était un réactionnaire. »
Un ancien président de la République, chef de parti, appuyé par une bonne partie de la presse et du patronat, métamorphosé en dissident dans son propre pays : il suffisait en effet d’y penser. Mais comment le Front national ne remporterait-il pas la bataille des idées quand ses adversaires présumés la mènent pour lui, et sur ses thèmes de prédilection ? Une semaine avant le 21 avril 2002, M. Le Pen pouvait déjà crier victoire : « Les hommes politiques, les journalistes et les politologues parlent un langage qui n’est pas très éloigné du mien, quand il ne le recouvre pas, voire le dépasse. Je me suis normalisé puisque tout le monde parle comme moi. C’est ce qu’on a appelé, à un moment donné, la “lepénisation des esprits” (8). »
Désormais, cette dynamique est relayée par le président de la République lui-même, y compris sur le terrain des libertés publiques (lire « Vers un état d’exception permanent »). S’exprimant devant le Parlement réuni en Congrès, le 16 novembre dernier, M. Hollande a déclaré par exemple : « Nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte de terrorisme, même s’il est né français, je dis bien : même s’il est né français, dès lors qu’il bénéficie d’une autre nationalité. »
Nul n’imagine qu’une telle mesure, directement piochée dans la besace idéologique de l’extrême droite, aurait dissuadé des auteurs d’attentat disposés à sacrifier leur vie. L’annonce solennelle faite par le chef de l’Etat a donc eu pour principale conséquence de légitimer la distinction entre les citoyens français en fonction de leur origine, car ce sont surtout les descendants d’immigrés qui déclarent une double nationalité. Mme Le Pen n’a plus eu qu’à empocher la mise. Elle l’a fait avec gourmandise lors d’un meeting, le 27 novembre : « Le FN a un programme réaliste et sérieux qui est même source d’inspiration pour François Hollande. »
Un regard soupçonneux de tous sur tous
Depuis trente ans, au nom des « réformes nécessaires », des économies à réaliser, d’un endettement public à contenir, les politiques sociales et les services publics sont attaqués : retraites, allocations familiales, aides au logement, gratuité de l’enseignement supérieur et de la santé. Un tel détricotage, surtout quand il intervient en période de chômage de masse, de croissance anémique, exacerbe le regard soupçonneux de tous sur tous, le repli individualiste, le « Il n’y en a plus que pour eux, il n’y a plus rien pour nous ». Les discours vilipendant l’« assistanat », les étrangers et les « pompes aspirantes migratoires » s’alimentent à cette source. Laquelle n’est pas près de se tarir, puisque l’Union européenne interdit, comme elle vient de le confirmer en Grèce, tout changement de cap économique. Il y a deux ans et demi déjà, un ministre socialiste français, M. Arnaud Montebourg, n’avait pas tort d’accuser son président d’alors, M. José Manuel Barroso, d’être « le carburant du Front national (9) ».
Or le lien politique entre insécurité économique et « préférence nationale » s’opère de plus en plus à travers la question des prestations sociales, souvent jugées trop généreuses à Bruxelles. Plus elles sont menacées, ou leur universalité remise en question par des conditions de ressources (allocations familiales, aides au logement pour les étudiants), plus la concurrence pour les obtenir alimente, en particulier dans les fractions fragilisées des milieux populaires, la traque aux fraudeurs, la recherche de boucs émissaires.
Analysant les résultats du premier tour des élections départementales de mars 2015, lors desquelles le FN obtint 25,2 % des suffrages (beaucoup plus auprès des ouvriers, des employés et des chômeurs qui avaient voté ; beaucoup moins auprès des diplômés du supérieur, des professions libérales, des cadres supérieurs), la politiste Céline Braconnier relève qu’au sein de l’électorat d’extrême droite, « le faux pauvre est une figure omniprésente dans les entretiens. C’est la voisine qui vit des aides sociales et dont les enfants ont accès à la cantine gratuitement quand les travailleurs pauvres en sont privés du fait d’un tarif prohibitif ; ce sont les Roms installés gratuitement dans des camps dès leur arrivée alors qu’il est impossible aux immigrés de longue date d’obtenir des HLM dans la ville où ils sont installés depuis des décennies ; ce sont les tricheurs qui profiteraient de la générosité des banques alimentaires en dissimulant la réalité de leur situation (10) »…
La conclusion se déduit sans effort, en particulier quand le travail est rare, dur et mal payé, et que nombre d’allocataires de l’aide sociale appartiennent aux populations issues de l’immigration : la xénophobie au nom de l’égalité, la « préférence nationale » comme refus d’une prétendue préférence immigrée (11). Mme Le Pen peut ainsi déclarer, comme elle le fit le 15 septembre dernier sur France Inter : « Il y a une profonde violence à l’égard des Français aujourd’hui quand ils entendent que l’on met à disposition 77 300 places d’urgence, comme ça, du jour au lendemain [pour les réfugiés politiques], alors qu’il y a un million et demi de foyers français qui attendent un logement social, parfois depuis des années, qu’il y a selon la Fondation Abbé-Pierre des millions de Français qui sont mal logés, ou d’ailleurs pas logés du tout. Eh bien moi, je suis la responsable politique qui dit que les Français ne doivent pas être les derniers servis. »
La hantise du « grand remplacement »
En 2012, le candidat républicain à la Maison Blanche, M. Willard « Mitt » Romney, laissa échapper que son message libéral peinait à convaincre les « 47 % » d’Américains qui dépendaient des aides publiques, proportionnellement plus nombreux chez les Noirs et les Hispaniques. Ces « minorités » s’apprêtaient en effet à voter très majoritairement pour M. Barack Obama alors que, depuis quarante ans, les républicains l’ont presque toujours emporté chez les Blancs.
Trois ans plus tard, tandis que le souci de « contrôler les frontières » se confond avec une panique identitaire, ce raisonnement a débouché sur la théorie d’un « grand remplacement » dans les urnes. Le candidat républicain Ted Cruz, par ailleurs sénateur du Texas, s’oppose à la régularisation des immigrés clandestins en expliquant : « Ce que veulent [le sénateur démocrate] Chuck Schumer et Barack Obama est très simple : ils veulent des millions de nouveaux électeurs démocrates. Voilà ce qui explique que le nouveau terme qu’on doit employer ne soit plus “étrangers illégaux” [illegal aliens], mais “démocrates sans papiers”. »
Le FN pourrait faire son miel d’un pareil discours. Mais la droite française l’a précédé sur ce terrain. Dès 2012, M. Jean-François Copé, alors secrétaire général du parti sarkozyste, prétendait en effet que « les sans-papiers sont désormais presque les seuls à pouvoir bénéficier d’un système 100 % pris en charge, sans aucune contribution de leur part, même symbolique ». Et, soupçonneux, il ajoutait : « Il serait naïf de croire que cet ensemble de décisions, qui créent un appel d’air pour l’immigration clandestine et bradent l’accès à la nationalité, est le fruit du hasard. C’est une stratégie délibérée pour remplacer le vote populaire par un vote communautaire » (12). Autrement dit, un vote ni très européen ni très catholique…
Travailleurs pauvres contre fraudeurs, puis Français contre immigrés, enfin « Blancs » contre « musulmans » : à mesure que la crise économique se durcit, les métastases se propagent au sein des catégories populaires. « Il serait naïf de croire » que de telles fractures, patiemment entretenues, incommodent vraiment ceux à qui cette crise profite. Tant que chacun regarde ailleurs, ils n’ont plus qu’à fustiger le « populisme » et continuer à gouverner. D’ailleurs, lors des élections régionales, chacun se désola du mécontentement, de la colère des milieux populaires, et se promit de « tenir compte du message » qu’ils enverraient. Pourtant, dès le lendemain du scrutin, le pouvoir socialiste annonçait que le salaire minimum ne serait pas réévalué…
Le premier ministre Manuel Valls estime que la conception de la République portée par le FN est « étriquée, petite » et « n’offre aucune solution à ceux qui souffrent ». Cette description s’applique tout aussi bien à la politique de son gouvernement. Il y a quatre ans, M. Valls réclamait déjà la liquidation des « mots qui ne veulent plus rien dire ou qui sont dépassés : “socialisme”, “camarade”, “parti” ». Son vœu idéologique rejoint à présent le calcul électoral du président de la République, désireux de balayer tout héritage de gauche pour disputer l’année prochaine aux dirigeants de droite le rôle de candidat d’une grande nébuleuse « modérée », « républicaine ». Lequel serait automatiquement élu au second tour de la présidentielle, puisque seul rival du Front national.
Le programme de ce candidat, quel qu’il soit, ne comporte aucun mystère : il lui reviendra de tenir le cap « européen » pris par François Mitterrand en 1983, lorsqu’il renonça à une politique économique s’écartant de l’orthodoxie libérale et trouva divers expédients pour se maintenir au pouvoir pendant deux septennats. Au nombre desquels, bien sûr, l’utilisation cynique et répétée du « combat contre l’extrême droite ».
Si elle aboutit, la reconduction obstinée d’un projet aussi désespérant devra beaucoup au Front national. Car ce système et ses hommes ont besoin de lui. Et savent qu’ils n’auront rien à redouter, rien à changer, rien à céder tant qu’il demeurera leur principal adversaire.
Serge Halimi





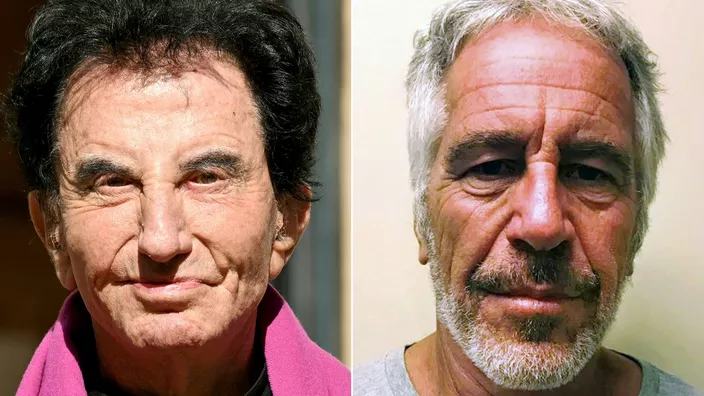

Les commentaires sont fermés.