Par Pierre Soumarey
Du conflit entre l’immunité et l’impunité Le cas du Président Guillaume Soro, prétexte à une réflexion générale sur les relations internationales sous le rapport du droit. ___________________
Synopsis de la Problématique : Philosophie du droit, analysée sous l’angle du régime de la territorialité de la loi, conflit entre immunité et droit, appréciation de la valeur de la norme interne et de la norme internationale, sous le rapport de la souveraineté des États et du droit international.
1ère Partie – Du régime des immunités dans le cas qui nous occupe.
L’immunité est un droit particulier qui déroge à la Loi ordinaire. Au regard de son origine historique, il s’analyse comme un privilège. En est-il vraiment ? C’est un concept, qu’on retrouve aussi bien dans le droit national que dans le droit international. Elle s’applique de manière spécifique à plusieurs sujets de droit, suivant le statut du justiciable concerné. À la circonstance de l‘actualité, relative à la procédure intentée à l’égard du Président Guillaume Soro et compagnie, en France, suite à la plainte de M. Michel Gbagbo, et le mandat décerné récemment à son encontre par la Juge chargée de cette Instruction, Sabine Khéris, nous nous intéresserons aux deux, en commençant prioritairement, par l’immunité internationale (actualité oblige).
«L’immunité internationale peut être défini comme l’obligation qui est faite à un Etat donné, en vertu du droit international public de ne pas exercer sa juridiction contre un Etat étranger ou ses représentants. Le terme « juridiction » étant entendu dans un sens, couvrant l’exercice de l’ensemble des compétences juridiques internes ». Cette définition distingue l’immunité reconnue à un Etat, de celle de ses représentants. En droit international, ces derniers sont considérés comme des individu-organes d’un Etat (Chefs d’État, chefs de Gouvernement, Chefs d’institutions, membres du Gouvernement, diplomates). On ne s’intéressera donc à l’immunité internationale, que sous l’angle que le droit international public leur confère, et non à celle, dont ils bénéficient par ailleurs, dans les différents systèmes juridiques nationaux. Au cas d’espèce, il ne s’agit donc pas de l’immunité parlementaire, qui appartient au droit interne.
Le développement de l’histoire du droit international, sur les 20 dernières années, soulève de nombreuses interrogations sur la doctrine, la philosophie, et l’application de ce droit. En effet, depuis l’arrestation d’Augusto Pinochet en 1998, à la demande de la magistrature espagnole, en passant par l’Arrêt de la Cour de Cassation Française, concernant le Président Mouammar Khadafi en 1999, jusqu’à la mise en accusation de l’ex-Président yougoslave, Milosevic, et de certains Chefs d’États Africains, dont l’ex-Président de Côte d’Ivoire, Laurent Gbagbo, se pose avec acuité le problèmes de la compétence des Juridictions nationales et internationales, devant lesquelles sont conduites ces procédures. Ce mouvement traduit-il une remise en cause de certains principes de droit, ou au contraire permet-il une clarification des règles ? En tout état de cause, nous devons constater une mise à niveau des règles du droit international public.
Le principe de l’immunité absolue dont jouissent les personnes qui incarnent ou représentent un état, tire son origine du principe d’immunité des États eux-mêmes. Battre en brèche ce principe moderne, nous ramènerait au moyen âge, voire à la féodalité, où le monarque ne jouissait d’aucune sorte d’immunité en dehors de son territoire, en raison d’une application stricte du principe de territorialité des lois nationales. Aujourd’hui, elle trouve sa source principale, en droit international, dans la combinaison de 3 conventions internationales :
1 – Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, de 1973
2 – Convention sur les missions spéciales de 1969, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, dite Convention de New-York
3 – Convention sur l’immunité juridictionnelle des États et de leurs biens, adoptée également par l’ONU en 2004.
Son concept trouve sa justification dans la théorie de l’intérêt de la fonction, car l’immunité vise comme but, de garantir à ses bénéficiaires, le libre exercice de leur fonction, sans laquelle, leur État se trouverait paralysé, déstabilisé, ou handicapé, d’une façon ou d’une autre, dans son fonctionnement régulier ou l’exercice de sa souveraineté. Il ne s’agit pas de leur accorder une immunité dans leur intérêt personnel, mais dans l’intérêt de l’État qu’ils représentent ou incarnent. Par extension, elle contribue aussi, à l’intérêt de la communauté internationale toute entière, en permettant des relations harmonieuses entre États, gage de la paix dans le monde. Aussi, en vertu de cette théorie, les États étrangers, et les organes qui en constituent l’émanation, ou encore les personnes qui l’incarnent ou le représentent, bénéficient de l’immunité de juridiction, pour autant que l’acte qui donne lieu au litige (civil) ou la mise en cause de leur responsabilité (pénal), participe par sa nature, ou par sa finalité, à l’exercice de la souveraineté des États qu’ils représentent. Il s’agit des actes ayant pour origine l’exercice du pouvoir régalien de l’Etat. Les mesures propres à assurer la sécurité et la stabilité d’un État, se rangent dans la catégorie des missions de souveraineté, que celui-ci exerce sur son territoire. L’arrestation de M. Michel Gbagbo, dans le contexte de la crise post-électorale ivoirienne, qu’elle soit justifiée ou pas, s’inscrit dans l’accomplissement d’un acte de souveraineté, en ce sens qu’elle adresse au départ, une question de sécurité et de stabilité, indépendamment de la question de son fondement juridique et du traitement de sa détention. Dès lors, l’exercice de cette prérogative d’État, confère une immunité de juridiction, qui résulte à la fois des usages, et des Conventions internationales. Elle est conforme au droit international coutumier, tel que reflété par la Convention des Nations Unies, du 2 décembre 2004, sur l’immunité juridictionnelle des Etats. Cette dernière n’est pas non plus contraire, à la conception française de l’ordre public international, pour que sa juridiction puisse trouver matière à s’y opposer.
Notons cependant, qu’un Etat et ses représentants ou encore un diplomate étranger, peut renoncer au bénéfice de cette immunité, à condition que cette renonciation soit certaine, expresse et non équivoque. (1ère Civ. – 9 mars 2011, pourvoi n°09-14. 743, BICC n°745 du 1er juillet 2011 et Legifrance). Ce choix se déduit nécessairement du fait que la personne bénéficiaire de l’immunité, ait pris volontairement sur lui, l’initiative et la liberté de se présenter devant une juridiction étrangère, en dehors du cadre prévu à cet effet. Il s’analyse comme le choix informé et manifeste, d’accepter une procédure, en dehors de la mise en œuvre des mécanismes prévus par une Convention d’entraide et de coopération juridique lorsqu’elle existe, et à défaut, des instruments internationaux. Une telle Convention existe entre la France et la Côte d’Ivoire depuis le 24 Avril 1961. C’est donc elle qui a naturellement vocation à s’appliquer au cas d’espèce, et non le droit national Français (immunité de juridiction), renoncer d’y recourir, prive le concerné, du bénéfice des immunités attachés à son statut et de la garantie des droits contenus dans cette Convention, comme il ne pourra plus évoqué l’immunité de juridiction, puisqu’il aura tacitement, mais clairement reconnu sa compétence.
L’immunité de juridiction d’un Etat privant de tout pouvoir le for saisi, le magistrat instructeur ou le juge de la mise en état, est tenu de surseoir à statuer sur toutes les exceptions de procédure dont il est saisi, jusqu’à la décision du tribunal compétent sur la fin de non-recevoir tirée d’une telle immunité. L’État Ivoirien est donc parfaitement fondé, à opposer une immunité de juridiction, dès lors que la nature criminelle (enlèvement et séquestration) de l’acte invoqué dans le cas du Président Guillaume Soro Kigbafori, ne permet pas, à elle seule, d’écarter une prérogative de souveraineté. En effet, cette immunité comporte 2 aspects. L’un est dit, immunité fonctionnelle, parce qu’il couvre les actes accomplis dans l’exercice des fonctions officielles de ceux qui en bénéficient. Or, à moins de privatiser la responsabilité, le Président Guillaume Soro, exerçait en qualité de Premier Ministre et de Ministre de la défense, aux moments des faits qui lui sont reprochés. En se plaçant sous l’angle de la responsabilité du Gouvernement qu’il dirigeait, c’est la responsabilité indirecte du Gouvernement Ivoirien qui est mise en cause, pris en la personne de son Premier Ministre de l’époque. Cette immunité n’est pas limitée temporellement, à l’image de celle de l’irresponsabilité pour les parlementaires ou de l’irresponsabilité politique du Président de la République. On pourrait donc dire qu’elle est absolue, puisque l’intéressé la conserve à vie, quand bien même il n’occuperait plus la fonction. Ce principe est également acté dans la Constitution Française, qui énonce indirectement, mais nécessairement, l’irresponsabilité politique. Comment méconnaître dans ces conditions, ce même principe, s’agissant des autres États ? L’autre aspect, est dit « immunité personnelle », puisqu’il existe indépendamment que le bénéficiaire ait agit dans le cadre de ses fonctions (antérieurement ou en dehors de celles-ci). Ce deuxième type d’immunité, au contraire du premier, cesse d’exister dès lors que l’intéressé perd son statut et sa fonction. Il se rapproche de celui de l’inviolabilité de l’immunité parlementaire, en droit national.
L’ensemble de ce régime d’immunité accorde concrètement aux bénéficiaires, une immunité de juridiction en matière civile et pénale, (compétence juridictionnelle) et d’exécution (contraintes physiques et saisie des biens), appelée aussi « immunité d’inviolabilité ». L’étendue de ces immunités varie sur une échelle allant de l’absolu au relatif, suivant qu’il s’agit d’actes officiels publics ou d’actes privés. Par ailleurs, et d’une manière générale, lorsqu’ils sont en visite officielle ou en mission spéciale, la Convention de New-York de 1969 sur les missions spéciales, leur accorde une immunité personnelle, donc l’inviolabilité personnelle, celle de leur lieu de résidence et de leur documentation. Nous avons, un cas typique à la faveur de l’actualité, en ce qui concerne toujours le Président Guillaume Soro Kigbafori, en mission de représentation à Paris, pour la COP21 sur le climat. Peu importe à ce niveau, la réalité de celle-ci, dès lors qu’elle existe formellement au plan juridique. Le Juge Français a, une fois de plus, agi en méconnaissance, de cette règle de droit et dans l’ignorance du caractère du séjour de l’intéressé, sur le sol Français. Même si la France n’a pas formellement ratifiée ladite Convention, elle ne s’y est toutefois pas opposée. Dès lors, elle s’applique au titre du droit international coutumier, selon une jurisprudence constante de la Cour Internationale de Justice. Il en résulte donc, une violation flagrante du droit international, de la part de la Juge Sabine Khéris, dans la conduite de son instruction. Sous-information, pression, précipitation, acharnement ? Au surplus, un mandat d’amener ne peut viser qu’une personne déjà tenue pour auteur ou complice des faits qui lui sont reprochés (Jean-Paul Doucet, Dictionnaire de droit criminel) à tout le moins, sur qui pèse des indices graves et concordants, rendant vraisemblable le fait qu’il est commis personnellement ou participé à la commission de l’infraction qui lui est reprochée. C’est le passage du statut de simple témoin assisté à celui de mis en examen. Comment la responsabilité pénale d’un individu, peut elle être retenue, alors que l’instruction n’a pas encore procédé à l’audition des parties en conflit (le plaignant ou victime, le Pr. Michel Gbabo, non autorisé à sortir de Côte d’Ivoire, donc dans l’incapacité d’être entendu à Paris, et le mis en cause, le Président Guillaume Soro, refusant d’y déférer, au motif de n’être pas saisi officiellement de la procédure). Il faut rappeler que les conseils ne sont pas autorisés à les représenter dans cette procédure, ni même à intervenir lors de l’audition, et que l’instruction doit être conduite à charge et à décharge. Cette décision prématurée en l’absence d’une véritable enquête, viole de manière flagrante, le principe du contradictoire, découlant lui-même du principe du procès équitable, notamment du respect du droit du mis en cause, d’être informé des éléments mis à sa charge, et surtout de se voir reconnaître la possibilité d’assurer effectivement et efficacement la protection de ses intérêts. Mouvement d’humeur, abus de pouvoir ? Rappelons que l’instruction est soumise par ailleurs à une triple exigence de dignité, de nécessité et de loyauté. L’obtention d’une audition dans de telles conditions coercitives, au regard du statut et de la personnalité du mis en cause, plus est, d’un pays étranger, répond-elle au critère de dignité ? L’existence d’une convention d’entraide et de coopération entre la Côte d’Ivoire et la France rendait-elle l’acte nécessaire ? Les délais d’attente étaient-ils déraisonnables par rapport à la durée moyenne de ce type de procédure ? Dès lors, la loyauté du Juge Sabine Khéris, à l’égard des principes d’indépendance, d’impartialité, d’immunité, et de souveraineté est-elle démontrée ?
En ne retenant que la violation de l’immunité, la contrariété de cette décision au droit international coutumier, tel que codifié par la Commission de Droit International (Convention de New-york, 1969), rend de fait, sa décision nulle et de nul effet (nullité absolue) au plan du Droit International. Point n’est besoin d’une ordonnance de révocation, comme le prétend Me Habiba Touré. En effet, « Les articles rédigés par la Commission du Droit International (de l’ONU) consacrent expressément l’obligation de ne pas reconnaître les situations issues d’une violation grave des normes impératives du droit international. Chaque violation grave implique un devoir de non reconnaissance des effets juridiques qui en découlent… » (André BIANCHI). La non reconnaissance de l’immunité d’un État étranger, doublée de celle de l’exception d’immunité de juridiction, viole une norme impérative, et se range dans cette catégorie de violation grave. Il faut rappeler, qu’il en va de même quand c’est l’inverse qui se produit, pour permettre d’engager la responsabilité pénale des bénéficiaires de l’immunité, malgré l’existe de celle-ci (déchéance de celle-ci pour des violations très précises). Zèle injustifié, méprise ou mépris ?
Les limites qui peuvent être posées à cette immunité, sont liées à la nature des actions envisagées, appréciée par rapport à leur capacité à empêcher en tout ou partie, le plein et libre exercice de la fonction des bénéficiaires ou l’accomplissement de leur mission. Elles sont de 2 ordres. Le premier concerne, l’immunité civile et administrative relative aux actes de la vie privée. Le second concerne la protection pénale spéciale, contre les atteintes à l’honneur (liberté de la presse, liberté d’expression, de manifester). Il s’agit de ne point les protéger contre la critique ou les protestation de masse, dans le contexte d’une démocratie moderne. J’observe que les violations des droits de l’homme ne constituent ni une limite, ni une exception, aux immunités de juridiction aux termes des articles 11 et 5.1 de la Convention Européenne sur les immunités de juridictions (Jurisprudence de la CEDH, puisqu’il s’agit d’acte posé par une juridiction Française, dont l’État est membre de la Communauté Européenne).
L’absence d’immunité proprement dite, est consacrée par le droit international, en matière de crimes, dont le caractère et la nature, y sont définis de manière très précise. Il s’agit des violations reconnues et condamnées, comme telles. Ce principe a été posé dès 1946 par le Tribunal Militaire International de Nuremberg. Il s’agit de crimes massifs d’agression, de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité, et de génocide, qui permettent de retenir la responsabilité individuelle des intéressés, depuis la jurisprudence des statuts des Tribunaux de Nuremberg, de Tokyo, de la Yougoslavie, du Rwanda et du TPI. Le principe d’absence d’immunité ne joue que dans ces cas très limités. Sans préjuger de la qualification pénale des faits visés dans la procédure de M. Michel Gbagbo, en tant qu’ils se rapportent au droit international (Art.5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, reprise presque dans toutes les Constitutions des États modernes) ou à la catégorie visée par la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984, ou encore de la Convention Européenne des droits de l’homme, en son article 3, puisque la Juridiction saisie est Française (soumission à la Loi communautaire). J’’observe, de manière oblique, que la responsabilité individuelle du Président Guillaume Soro est examinée par la juridiction Française, sans établir au préalable, la règle de référence à suivre en la matière. Or, celle-ci est fortement polémique et reste très variable suivant la jurisprudence et les Tribunaux. Les cas où les Chefs d’États ou de Gouvernement sont personnellement responsables, sont des anomalies, d’un point de vue constitutionnel, justifiant au plan national, l’institution de juridiction d’exception (Haute Cour de Justice et Cours Spéciales) pour les traduire en justice, pour des cas toujours extrêmement limités (haute trahison, intelligence contre l’État, etc. ). Il s’agit au plan national, de juridictions compétentes pour juger les membres d’un Gouvernement pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leur fonction. Ce principe est en quelque sorte transposé au plan international, en ce sens qu’ils continuent de jouir d’une immunité à l’égard des juridictions de droit commun des pays étrangers. Dès lors, ils constituent une catégorie de justiciables, radicalement autres, différents des justiciables ordinaires, car ils ne sont pas justiciables devant une justice ordinaire, peu importe le territoire. Leur immunité s’impose tant au plan national, qu’au plan international. C’est un autre des aspects de l’immunité de juridiction. Aussi, et nous le voyons bien, le surgissement de la question « immunitaire » pose, une question nouvelle, donc plus difficile à résoudre, « qui est celle de savoir si l’irresponsabilité politique de principe, peut coexister avec une forme différente de responsabilité (pénale ou civile) », tel que semble vouloir l’entendre la Juridiction Française (droit national), déduction tirée du fait, qu’elle ne s’en remette pas au Droit International pour conduire sa procédure. Ici, réside la complexité et la difficulté de la procédure qu’elle conduit devant une juridiction ordinaire.
2ème Partie – Du régime de la territorialité de la loi et de l’exception de l’immunité de juridiction à l’impunité.
Pour appliquer la règle de la responsabilité individuelle d’un Chef d’État ou Chef de Gouvernement, il convient d’examiner au préalable, si toutes les conditions sont réunies, pour constater le principe de l’absence d’immunité. Au cas qui nous occupe dans l’affaire Michel Gbagbo vs Guillaume Soro K., ce dernier étant Premier Ministre au moment des faits allégués, il eu fallu que les faits incriminés se rangent dans la catégorie définie par le Droit International (génocide, crime contre l’humanité, crimes de guerre, ect.), pour permettre de faire jouer le principe de l’absence d’immunité, donc d’engager la responsabilité personnelle et individuelle du mis en cause. Peut-on volontairement ignorer cette règle, au motif d’une interprétation différente du droit international ? Or, si norme il doit y avoir en la matière, elle doit nécessairement provenir des Juridictions Internationales, comme la Cour Internationale de Justice, par exemple. Des Juridictions nationales sont elles aptes à l’établir ? Du point de vue de la rationalité juridique, ce questionnement interpelle, et conduit à constater l’existence d’une sorte de « privilège ou de supériorité de Juridiction » au sens strictement technique du terme, qui donne une place à part, aux Juridictions Nationales de certains États (grandes puissances), difficilement conciliable avec les principe d’égalité et de souveraineté des autres États (petits pays). À supposer, qu’il y ait une totale indépendance des procédures criminelles et politiques, comme aux Etats-Unis, de sorte que toute Juridiction ordinaire serait compétente à recevoir une plainte contre un représentant ou un individu-organe de l’État, pour des actes strictement privés (couverts ailleurs, par l’immunité personnelle dite d’inviolabilité), il ne s’agirait que d’une norme interne, fondée sur des principes différents et dirigée vers des objectifs différents. Dès lors, la question de leur portée se pose avec acuité, lorsque des juridictions nationales se prévalent du principe d’absence d’immunité en matière pénale, pour les crimes et les violations des droits de l’homme commis en dehors de son territoire, et néanmoins conduites devant leurs tribunaux, sur le fondement de la possession de la nationalité de la victime, comme c’est le cas de la France (Art 113_7, NCP). Autrement dit, cela revient à se poser, d’une part, la question de la compétence des juridictions nationales à juger des crimes internationaux ; et d’autre part, la question de savoir si les juridictions nationales, sont qualifiées et compétentes, pour déterminer quand est-ce que le principe d’immunité, notamment l’immunité de juridiction, s’applique ou pas. De quelle force contraignante, se prévaut son droit interne, pour pouvoir ensuite l’imposer aux autres États ? Un État peut-il de sa propre autorité, s’arroger la fonction d’interprète dans la détermination du droit international. Cette situation soulève une question préjudicielle. Me Habiba Touré m’a répondu, lors du débat radiophonique que nous avons eu le 10/12/20215, sur twitafrica (Ovajab), qu’il revenait à la Côte d’Ivoire de s’en prévaloir devant la Juridiction compétente en la matière (CIJ), et j’en conviens avec elle, bien que je ne sois ni le conseil du Gouvernement, ni celui du Président Guillaume Soro, et encore moins, juge sur le fond de l’affaire. Le cas Michel Gbagbo vs Soro Guillaume, est pour moi un prétexte à une réflexion plus générale sur le droit. Je ne fais que conduire une analyse, sous l’autorité de la rationalité juridique. Donc, à priori, et de mon point de vue, l’immunité de juridiction étant une notion du droit international, il serait plus objectif et logique, que la tâche de dire quelle juridiction est compétente, revienne aux Tribunaux Internationaux, et non à un État, en l’occurrence la France, à travers son Code Pénal (Art 113-7 NCP).
Cependant, la solution la plus simple et la plus efficace (délai raisonnable à supporter par la victime, car il ne faut pas perdre de vue ses intérêts), est dans l’application des Conventions qui lient les deux États, ou auxquelles ils ont librement adhéré, car c’est à travers elles, que cette force contraignante peut trouver sa justification ? Seules celles-ci ont force de loi entre les parties, en créant entre elles des obligations. Le principe de l’absence d’immunité est accepté par la majorité de la communauté internationale et l’ONU, que lorsqu’il concerne les procédures conduites devant les Tribunaux Pénaux Internationaux et les Cours Internationales, ce qui revient à leur reconnaître au plan international, une compétence universelle certaine et incontestable. Pourquoi leur superposer des droits internes concurrents, qui comportent entre eux, des contradictions dans certaines de leurs dispositions, et qui peuvent se heurter à des accords internationaux ?
Il revient en dernier ressort, à la Cour Internationale de Justice de trancher de l’applicabilité du principe d’absence d’immunité dans les procédures conduites devant des Juridictions nationales. Or, la jurisprudence de cette Cour, à travers l’Arrêt du 14 février 2002, relatif à l’affaire du mandat d’arrêt émis contre un ministre des affaires d’un autre État, a jugé que la Juridiction nationale, violait l’impunité pénale et l’inviolabilité de celui-ci. La Cour Européenne des Droits de l’Homme à laquelle la France est assujettie, a aussi affirmer à travers de nombreuses décisions, que « l’immunité constitue une limitation légitime et proportionnée au droit d’accès au Juge » (Sally El Sawah). Cette convergence jurisprudentielle interdit aux autorités d’un État quelconque, d’adopter une compétence universelle, à plus forte raison d’adopter des mesures coercitives à l’encontre d’une personne jouissant de l’immunité. C’est en définitive, la question de la licéité vis à vis du droit international qui est posée, pour tous les actes relevant du droit interne d’un pays, lorsqu’une juridiction nationale engage une procédure pénale à l’encontre d’une personne d’un pays étranger, jouissant de l’immunité, sans recourir aux instruments internationaux ou aux mécanismes prévus par les conventions qui régissent ces deux Etats. Mieux cette décision renforce la conception d’une immunité absolue, allant au delà de l’immunité fonctionnelle, rentrant dans le cadre de l’exercice normal des fonctions souveraines, des personnes qui en bénéficient, puisqu’elle y inclus l’immunité d’inviolabilité. Toujours dans le même débat, Me Habiba Touré a affirmé, sans pouvoir en rapporté la preuve, du fait de l’impossibilité pour elle, de faire état d’éléments appartenant au dossier de l’instruction, (secret de l’instruction), que la procédure avait obéit aux obligations prévues par la Convention, notamment la délivrance d’une commission rogatoire internationale restée à ce jour sans suite. De l’autre côté, le Gouvernement Ivoirien affirme de manière constante, que les mécanismes de la Convention de coopération et d’entraide juridique de 1961, n’ont pas été mise en œuvre par le magistrat instructeur Français, et exige en conséquence, son application intégrale, sans en rapporté également la preuve, du fait pour lui aussi, de l’impossibilité de démontrer un fait négatif. Nous n’allons pas entrer en religion, pour croire ou ne pas croire. Le fait objectif est que la procédure prévue par la convention n’est pas activée en l’état de ces informations contradictoires. Dès lors, subsiste une difficulté non résolue, à l’origine de l’incident diplomatique que nous avons connu. J’observe, d’un point de vue purement logique et de l’usage, que c’est à l’expéditeur d’une chose, qu’incombe la charge de la preuve, et non au destinataire. Sous l’angle de l’intérêt, qui a le plus d’intérêt, à ne pas coopérer au regard du régime des immunités, qui s’impose à la procédure, sans toutefois lui faire obstacle, qu’il s’agisse d’incrimination, de compétence ou d’exécution ?
Dans la réalité, l’immunité de juridiction, ne s’oppose pas au droit, car elle n’élimine aucune infraction, et ne rend pas conforme au droit, ce qui le contredit. Elle interdit simplement à un juge d’un État donné, en tant qu’acteur ou organe étatique de ce pays, de constater les éventuelles contrariétés au droit, d’un autre État ou de l’un des ses organes, ou encore représentants. Dès lors, Il faut plutôt comprendre que les immunités témoignent de ce que ce système juridique entend confier la répression des violations visées, à d’autres autorités, selon d’autres mécanismes. Sous cet angle d’analyse, ce n’est pas un déni de justice, puisqu’il est adossé, à un transfert de droit, qui ne l’éteint pas pour autant.
La volonté du législateur Français de protéger les droits de l’homme, sur son territoire et même en dehors de celui-ci, pour ses citoyens, est certes louable, mais cette extension spatiale, s’accorde mal, avec le droit international public, qui prévoit expressément des immunités de juridiction et d’exécution. Les violations graves ou systématiques des droits de l’homme, ne sont pas acceptables, où qu’ils se produisent, encore moins en Côte d’Ivoire. Il ne s’agit pas de faire primer l’immunité sur la violation, mais d’analyser leur finalité et leur compatibilité, et nous n’étudions pas la question sous l’angle des violations des droits de l’homme, mais de celui du droit d’accès à un Tribunal national, et du régime de territorialité de la Loi. En effet, force est de constater, que la plupart des droits nationaux répriment les violations des droits de l’homme. C’est le cas de la Côte d’Ivoire. Dès lors, les Juridictions de ces États sont compétentes pour connaître de cette cause. Dès lors aussi, seule une justice de substitution ou de complémentarité, peut prendre le relais, en cas de défaillance avérée des Juridictions nationales. Lorsqu’il en est autrement, les Conventions Internationales de défense des droits de l’homme peuvent être mises en œuvre utilement. Dans ces conditions, rien ne fonde à donner préférentiellement, compétence exclusive à un droit national en cette matière. On perçoit tout de suite la disproportion d’une telle prétention. Dans le prolongement de ce constat, se pose la question de l’opportunité de poursuivre au plan national, sans rentrer en concurrence avec d’autres droits nationaux, dotés des mêmes dispositions et outils juridiques. Les problèmes que cette question soulève, présentent un lien très étroit avec le droit international public du fait que différentes souverainetés et nationalités sont intéressées au conflit. Aussi, pour conclure mon propos, je persiste de penser, que les Juridictions Nationales dans ces matières, doivent appliquer les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les États en litige, se référer à la coutume internationale, en tant que pratique générale, acceptée par la grande majorité des États, comme une forme de droit, non écrit. Ce sont là, des principes généraux de droit reconnus par tous les États. Ceci éviterait de créer un conflit inutile entre d’une part, immunité et droit. Est-il possible qu’une restriction du droit d’accès à un Tribunal, à la suite d’une violation des droits de l’homme, poursuive un but légitime ? C’est une question qui oppose la nature de la violation à la valeur de la norme. Dès lors, pour ne pas que l’immunité conduise à l’impunité, il convient de s’assurer de l’existence de moyens alternatifs adéquats, permettant de satisfaire à la demande de justice de la victime (principe du contrôle de proportionnalité), et d’autre part, entre États dans leurs relations. Est-il possible de limiter sa souveraineté, sans contrepartie équilibrée et sans réciprocité ? Vouloir ignorer cette règle, sans faire la balance des intérêts, est faire preuve d’une arrogance inacceptable, qui s’analyse comme un mépris ou un complexe de supériorité. Le Droit Français, protecteur et nationaliste, gagnerait à intégrer les nouvelles évolutions intervenues dans les relations internationales, en reconsidérant son système juridique, qui s’arroge un privilège de Juridiction injustifié, là où sa compétence aurait du être logiquement écartée, au regard du régime de territorialité de la Loi (absence de liens de connexité, et lorsque le principe d’indivisibilité de l’acte délictuel, ne trouve pas d’application). Sa logique judiciaire introduit donc, de fait, un arbitraire, insupportable pour la souveraineté des autres États. En effet, peut-on donner une valeur égale à la norme interne et internationale ? Le but poursuivi par cette dénonciation est de parvenir à faire observer, à égalité, le droit international par tous les pays, malgré ses insuffisances et ses imperfections, car celui-ci est évolutif, donc perfectible. Comme le souligne, à juste raison, le Pr. Brigitte Stern « toute la question est de savoir si l’on peut vraiment en toute rigueur juridique et non du point de vue des préférences politiques, tenir un tel raisonnement qui pourrait avoir des conséquences bouleversantes pour l’ordre juridique international.». Comment accepter qu’un État décide unilatéralement de mettre en cause la responsabilité d’un autre État, pour acte de torture ou de traitement dégradant, alors que ce dernier n’a pas reconnu la compétence de sa Juridiction ? La règle de droit exige le consentement de l’Etat concerné pour que celui-ci puisse être poursuivi devant la juridiction nationale Française. Il est évident, que le droit d’accès au Tribunal de compétence nationale, en matière internationale, est de nature, à troubler l’ordonnancement des règles du droit international public, dès lors qu’il s’agit d’affaires qui n’ont aucun lien avec son territoire, et à plus forte raison, lorsqu’il s’agit de personnes appartenant à un groupe national différent du sien (nationalité Ivoirienne des parties à la procédure). S’attribuer une compétence de juridiction, au regard du seul critère de la nationalité, se heurte aux dispositions d’Ordre Public International.
Le Droit international et les conventions internationales sont appliqués à travers le système juridique interne des Etats, qui en réalisent la mise en œuvre effective dans leur droit national (transposition du droit international ou communautaire dans le droit interne). Dès lors, on ne saurait contester que l’objet même d’un accord international, dans l’intention des parties contractantes ou adhérentes, puisse être l’adoption par les parties à ces accords, de règles déterminées, créant des droits et des obligations, susceptibles d’être appliquées par les tribunaux nationaux à leurs ressortissants. Au cas d’espèce, il s’agit de l’application en droit interne Ivoirien des conventions relatives à la protection des droits de l’homme. Dès lors, il est tout à fait incompréhensible qu’un État tiers (la France) veuille les faire appliquer à nouveau, dans un autre état (la Côte d’Ivoire) qui l’applique déjà au niveau interne. Il y a manifestement redondance et concurrence, mais surtout une absence de confiance dans les autres systèmes juridiques (un à priori justifié ou pas). Dès lors, il y a nécessairement un mépris culturel, lorsqu’on exige des autres États et des autres peuples, qu’ils respectent les standards minima de civilisation, reflétés par les droits de l’homme, ou notre propre civilisation ou encore notre développement humain et démocratique (l’efficacité de la justice est aussi une question de moyens). N’ayons pas peur des mots. Nous ne sommes pas à proprement parler, dans la technique du droit ici, mais dans une action ou une mission civilisatrice, via la promotion de la dignité humaine. Il faut éviter que cette mission, à caractère universel, ne face pas écho à un modèle de type colonial, dans sa conduite. Or, comme je l’ai déjà dit dans ma tribune précédente, la Civilisation que nous voulons bâtir ensemble, pour l’Humanité, doit être une œuvre collective, « un rendez-vous de l’Universel » (pour emprunter à L. S. Senghor), avec des valeurs de partage et des intérêts réciproques, respectant la souveraineté de chaque État, dans cette belle aventure humaine, sociale, et juridique, pour que triomphe la justice et la dignité de l’homme, et des peuples.
Pierre Soumarey






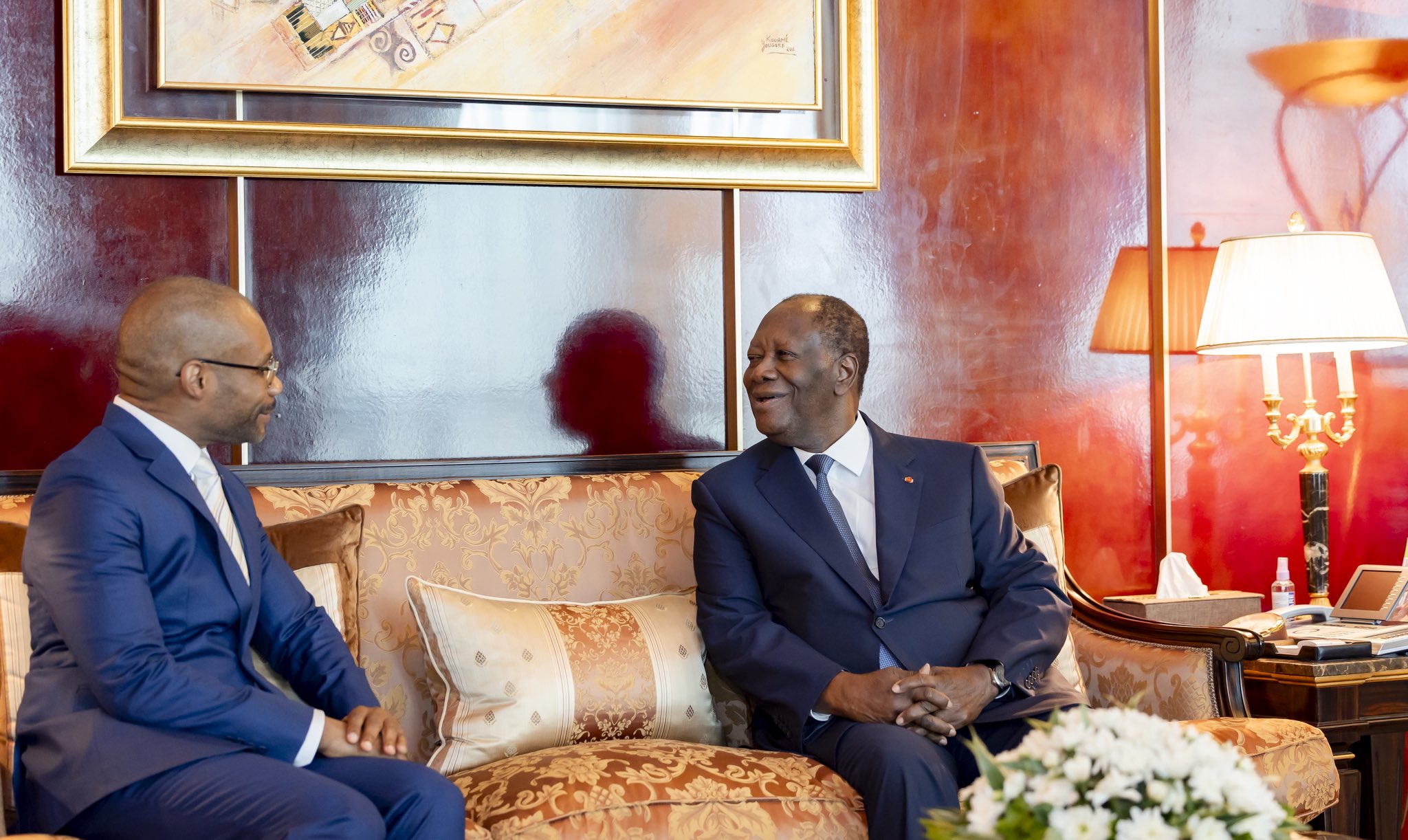

Les commentaires sont fermés.