
Par Pierre Soumarey (Docteur)
La monumentale erreur de certains politiques, sur la prétendue inéligibilité du Président Ouattara, au regard de l’article 35 de la Constitution
1– Incidences de la Décision de la Chambre Constitutionnelle de la Cour Suprême de 2000 (Arrêt N°E 0001-2000), sur l’élection présidentielle de 2015
La décision à laquelle se réfère l’opinion publique et certains partis et hommes politiques de l’opposition, est une décision en « mi-teinte », assisse sur la notion du doute, qui agit à charge et à décharge. Cette dernière, implique en amont les problématiques de l’établissement de la preuve, et de l’imputabilité de la charge de celle-ci. Au plan du raisonnement, on peut se demander si la preuve a pour objectif la vérité, et où cette dernière se situe-t-elle ? Dans la réalité ou dans le discours juridique ? Car le discours est ce qu’on dit de la réalité, c’est la convention par laquelle nous appréhendons cette réalité, autant dire, une construction. Or, le doute, est l’aveu d’un échec dans la manifestation de cette vérité. Une impossibilité à atteindre cet objectif, en apportant la démonstration de la preuve dans les conditions admises par la Loi. En effet, la notion de doute nous renvoie à une difficulté non résolue, voire un impossible, qui s’analyse en droit comme un « avant dire droit », une hypothèse, une présomption, tirée d’un raisonnement logique. Ce n’est ni une certitude, ni un fait, pouvant donner lieu à l’application d’une règle de droit audit fait, de manière directe, pertinente, et incontestable, puisqu’il est réputé ne pas être établi avec certitude. C’est donc une interprétation, une conviction, une perception de la réalité, qui peut faire naître un droit subjectif ou une négation de celui-ci. C’est donc, une décision qui relève de l’appréciation souveraine du juge qui l’a prononcée, au regard des contradictions et incohérences qu’il a relevé dans l’examen du dossier de candidature du Président Alassane Ouattara (par conformité avec sa nouvelle fonction). Celle-ci revêt l’autorité de la chose jugée. Peut-on parler de désastre judiciaire, ou d’instrumentalisation politique de la Justice ? Certainement pas. Les motivations de la décision s’appuient sur un faisceau d’indices et de faits objectifs, de nature à constituer une assiette de doute substantiel, quant à la possession de la nationalité Ivoirienne, de père et de mère eux-mêmes Ivoiriens d’origine, et surtout la permanence de cette possession, au regard des exigences de la Loi. C’est la prérogative du juge électoral. Il est dans son rôle et ses attributions. Cependant, on peut regretter que cette rigueur ou ce zèle, c’est selon, ne se soit pas appliqué de manière égale à tous les candidats, dont certains présentaient des anomalies encore beaucoup plus flagrantes, dans leur État-civil. Pour l’essentiel, on retiendra sur ce sujet fortement polémique, que la rationalité du raisonnement qui a conduit à cette conclusion, ne développe aucune théorie jurisprudentielle, qui puisse faire obstacle, dans d’autres configurations, à l’application du doit formel à des faits de même nature ou strictement identiques, car la recherche de la vérité s’impose toujours au juge, au cas par cas, rien ne le libère de cette obligation. Autrement dit, elle n’a pas le pouvoir de lier un autre juge, comme on se plait à le croire. Comment du reste, un doute pourrait-il lier des juges dans l’avenir ?
« En principe, le doute n’est pas compatible avec une décision de justice. En effet le juge ne peut, pour motiver sa décision, se fonder sur des motifs dubitatifs ou hypothétiques. Il ne lui est pas davantage possible de refuser de trancher le litige au prétexte que la vérité lui paraît inaccessible et incertaine. » (Rapport 2012, Cour de Cassation Française). Le doute ne saurait constituer un fondement légal à la limitation de l’éligibilité d’un candidat remplissant la qualité d’électeur, en tant que droit se poursuivant dans le temps. La conformité à cette appréciation n’est pas davantage une obligation légale. Il en découle naturellement, la perspective d’une nouvelle solution pouvant consacrer une évolution de la jurisprudence par rapport à ce doute. Celle-ci contredit l’idée d’une irrecevabilité acquise, sur la base d’une jurisprudence figée. Il n’existe aucune interdiction posée par la loi, prévoyant qu’une candidature récusée, ne puisse être renouvelée à l’occasion, d’une autre échéance électorale. Nous ne sommes pas en présence d’une présomption légale, définit expressément par la Loi, comme emportant caractère irréfragable, qui ne peut, ni être contestée dans le temps, ni être reformée par l’administration d’une preuve contraire. Aussi, les éléments de preuve jadis produits dans la procédure de 2000, peuvent parfaitement faire l’objet d’un nouvel examen en 2015, dès lors que le candidat en question, n’est pas privé du droit à l’accès au juge électoral, dans le cadre d’un nouvel acte, posé à l’intérieur d’une nouvelle procédure de candidature. Celui-ci ne constitue pas une remise en cause d’une décision définitive, mais ouvre au juge, une nouvelle opportunité d’appréciation, sur des éléments de fait non résolus par le doute antérieur, ou à la lumière d’ éléments nouveaux apparaissant dans le dossier. L’inéligibilité résultant d’une cause légale, s’analyse toujours, comme une incapacité temporaire à un mandat électif, et non comme l’extinction du droit d’éligibilité, car elle est toujours liée à des critères évolutifs et des situations circonstancielles (âge, résidence, nationalité, appréciation des pièces justificatives, qualité d’électeur). Cette décision ne prononce, ni une déchéance du droit d’éligibilité, comme le ferait une condamnation, ou une interdiction, ni une impossibilité définitive comme le ferait une présomption légale. Comment peut-elle, dans de telles conditions, faire obstacle à une nouvelle candidature ?
L’argument de la jurisprudence invoquée, ne saurait également prospérer. L’uniformisation des décisions de justice, pour éviter une trop grande disparité dans les décisions des Tribunaux et des Cours, quant à l’interprétation des textes et des faits qui leur sont soumis, dans une matière donnée, s’impose généralement aux juridictions inférieures. En outre, le doute ne se range dans aucune de ces catégories (faits et droit textuel). D’ailleurs aucune règle de droit, ne s’oppose à ce qu’un juge rende une décision, contraire à un principe formulé par une juridiction donnée, ou son interprétation des faits, et rien ne permet à priori, de penser qu’une appréciation plus pertinente ou une analyse différente, ne puisse être finalement trouvée par une même Cour, par un moyen autre que le doute, dont l’efficacité est défaillante. En l’espèce, il s’agira d’un nouvel acte de candidature, ouvrant l’opportunité de rechercher en cette circonstance, une réponse pertinente, à la définition juridique de l’expression « Ivoirien d’origine », auprès du Code de la Nationalité, par exemple. Or que dit celui-ci ? « « Est ivoirien : L’enfant légitime ou légitimé, né en Côte d’Ivoire, sauf si ses deux parents sont étrangers …» (Art 6, Al. 1). Aussi, le Conseil Constitutionnel est parfaitement fondé à accueillir la candidature du Président Alassane Ouattara en 2015. Il incombe à ce dernier, mais surtout aux partis politiques qui présentent sa candidature, de supporter la charge de la preuve, puisqu’ils se réclament du bénéfice d’un droit.
Le juge électoral était souverain pour apprécier que les éléments apportés par le candidat Alassane Ouattara, ne lui permettaient pas d’établir de manière certaine, au moment de sa saisine en 2000, qu’il remplissait pleinement les exigences des dispositions prévues à l’article 35. Il en a tiré la conclusion de l’existence d’un doute. En se prononçant ainsi, la Chambre Constitutionnelle de la Cour Suprême, s’est libéré de son obligation, par une décision « mi-figue, mi-raisin » qui n’a jamais apporté la preuve de son hypothèse, pour qu’elle puisse être considérée aujourd’hui, par une frange de l’opposition et de l’opinion publique, comme un fait acquis et solidement établi. En conséquence, la question de la preuve reste toujours pendante, si et seulement si, le dossier demeure en l’état. Comme hier, elle relève de l’appréciation souveraine du juge électoral. Donc, laissons le travailler dans la sérénité. D’où nous vient l’idée de vouloir faire pression sur la plus haute juridiction de notre hiérarchie judiciaire, dans le sens qui nous arrange ou que nous souhaitons ?
Cette imprécision n’a pas été élucidée dans le passé, par la juridiction compétente pour établir la vérité, qu’elle avait l’obligation de rechercher. Il n’appartient pas aux politiques de le faire à sa place. S’ils le font, ils sont manifestement dans l’erreur, en ce qu’ils dérogent à leur rôle et leur place. Ils ne peuvent pas se prévaloir d’un doute pour se lancer dans des exigences, des revendications, et des affirmations gratuites et vexatoires. J’invite tous les politiques à respecter l’indépendance des juges et de l’Institution Judiciaire, et à mettre un terme à leurs procès d’intention et à leurs jugements de valeur. C’est cela aussi la démocratie. C’est cela être républicain. Vouloir faire rentrer la politique dans le droit, nous renvoie aux pages les plus sombres de notre histoire. Non seulement elle constitue une régression, une irresponsabilité, mais une menace sur la paix civile. En droit, le doute n’a jamais été une certitude, une vérité, ou un fait. La passion, les calculs électoraux, et les enjeux de pouvoir, ne doivent pas faire déraper certains politiques. Ils doivent savoir raison garder. C’est à la justice, et à elle seule, de trancher cette question de preuve. Cependant, j’observe que les poids lourds de l’opposition, que sont Messieurs Konan Banny, Essy Amara, Affi N’guessan, et surtout le Président Mamadou Koulibaly, qui s’est clairement exprimé sur cette question, n’en font pas partie. Je salue l’indépendance d’esprit du Pr. Koulibaly, sa probité intellectuelle et morale, pour s’être toujours refusé à la compromission et à l’ambiguïté, de surplus, sur une question aussi fondamentale, qui touche à l’intérêt national. Le silence des autres ténors entretient « un flou » , qui rend leur position équivoque. Ils ont l’obligation morale de sortir de leur réserve ou de la « conspiration du silence », c’est selon. Ont-ils peur d’afficher au grand jour leurs convictions ? Qu’est-ce qui les retient ?
J’observe aussi, que le doute n’a pas bénéficié au candidat Alassane Ouattara en 2000, contrairement à un usage constant dans les autres branches du droit (civil, administratif et pénal en particulier), où celui-ci bénéficie toujours à la demanderesse ou à la défenderesse, suivant le cas. Dès lors, ce dernier est invité à mieux se pourvoir à l’occasion d’un nouvel acte de candidature. Il appartient au postulant, d’apporter un faisceau d’éléments conférant à sa prétention, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance, pour renverser la charge de la preuve, afin que celle-ci repose désormais sur la juridiction qui devra examiner à nouveau ces éléments dans le cadre d’un nouvel acte de candidature. Au vu des pièces et des éléments produits par le postulant, le juge de l’élection, aura l’obligation de former à nouveau sa conviction dans le cadre du contrôle de régularité, d’exactitude et de sincérité qu’il aura à exercer, quant à savoir si les éléments avancés par le candidat et les partis qui le présentent, suffisent pour lever la présomption ayant entaché le premier acte de candidature, si la preuve contraire est apportée, ou s’il existe des éléments pertinents et nouveaux par rapport à la décision précédente, permettant une analyse différentes des pièces, susceptibles de conduire le Conseil Constitutionnel à accueillir favorablement sa candidature. Quels peuvent être ces éléments nouveaux ? Nous les avions déjà mentionnés dans un post précédent, daté de Février 2015, que nous reproduisons ci-après, après l’avoir révisé et adapté à l’objectif de la présente.
2- Incidences de la Décision de la Cour Constitutionnelle de 2010 (Décision N°CI-2009-EP/028/19-11/CC/SG), sur l’élection présidentielle de 2015.
A) – Les dispositions de l’article 35, en sa partie relative à la nationalité sont inopérantes et inapplicables en l’état, pour lever le doute sur la nationalité des candidats de plus de 55 ans.
Le Professeur Wodié (Ancien Président du Conseil Constitutionnel) et au tard, M. Tia Koné (Ancien Président de la Cour Suprême) ont tous deux reconnu l’impossibilité d’établir par un acte juridique, la possession de la nationalité Ivoirienne, avant l’existence même de l’Etat Ivoirien, dont la naissance date de 1960, soit une histoire de 55 ans, en l’an 2015. Cette durée, rapprochée à la limite plancher de l’âge requis pour l’éligibilité à la Présidence de la République, soit 40 ans, implique d’avoir des pères et mères Ivoiriens, ayant conçu leur enfant à un âge inférieur à 15 ans. Voyez l’usage en la matière. Pour la limite supérieure, soit 75 ans, il n’est tout simplement pas possible d’avoir des parents Ivoiriens nés après 1960, sauf à être plus âgé qu’eux.
B) La jurisprudence du Conseil Constitutionnel avec le cas du Sieur Adama DALO, surnommé Dahico
Par décision N° CI-2009-EP/028/19-11/CC/SG intervenue le 19 Novembre 2009, le Conseil Constitutionnel a accordé le bénéfice de l’éligibilité à l’intéressé, en méconnaissance flagrante des exigences posées par l’article 35, qui établissent pourtant très clairement, que la candidature à l’élection présidentielle est strictement réservée aux Ivoiriens d’origine, puisqu’elles prescrivent que le candidat « doit être ivoirien d’origine, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d’origine », alors que le concerné, a acquis la nationalité Ivoirienne par naturalisation. Il s’en suit qu’il n’est pas Ivoirien d’origine, et que ses parents étant Maliens, ne le sont pas eux-mêmes non plus. La conséquence logique de cet état civil, est qu’il s’est nécessairement prévalu d’une autre nationalité, avant d’être naturalisé. Cette décision qui n’a fait l’objet d’aucune réclamation contentieuse, de la part des candidats et des partis politiques en compétition, ni provoqué l’ire des populations, est définitive, et revêt l’autorité de la chose jugée. Cette jurisprudence élimine de fait, toute discrimination dans l’éligibilité aux élections présidentielle futures, sur la base de l’exigence « d’être ivoirien d’origine, né de parents eux-mêmes ivoiriens d’origine, ne s’étant jamais prévalu d’une autre nationalité ». Était-ce réellement l’intention cachée du Conseil Constitutionnel ? On est autorisé à le penser, au vu de ses motivations, qui se limitent à justifier uniquement la levée des incapacités qui frappaient ce dernier, aux termes du Code de la Nationalité, en son article 43-1, relatif à sa qualité d’électeur. En effet, 5 années sont nécessaires, à compter du Décret de naturalisation, pour l’acquérir, et 10 années, pour la possibilité d’être « investi de fonctions ou de mandats électifs pour l’exercice desquels la qualité d’ivoirien est nécessaire ». Il apparaît ainsi, que le Conseil Constitutionnel a lié exclusivement l’éligibilité à la qualité d’électeur. En effet, l’article 48 du Code électoral pose, que « tout Ivoirien qui a la qualité d’électeur peut être élu Président de la République… . Manifestement, cette disposition lie la condition d’éligibilité à la possession de la qualité d’électeur » (Commentaire de Vincent N’GBESSO de la Décision N°CI-2009-EP/028/19-11/CC/SG du 19 Novembre 2009 du Conseil Constitutionnel Ivoirien). Or, au visa de l’article 3, alinéa 1er du même Code « Sont électeurs les nationaux ivoiriens des deux sexes et les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne, soit par naturalisation, soit par mariage, âgés de 18 ans accomplis, inscrit sur une liste électorale, jouissant de leurs droits civils et civiques et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévus par la loi ». Dès lors, les conditions d’éligibilité édictées par la Constitution, qui y ajoute des dispositions plus restrictives ne sont plus en adéquation avec celles du Code électoral. Nous observons aussi, un conflit interne entre ces textes, puisqu’aucune restriction n’est prescrite, pour le mandat électif à la fonction présidentielle, aux termes du Code Électoral. En statuant ainsi, non seulement le Conseil Constitutionnel confirme pleinement cette lecture, mais va beaucoup plus loin dans ses motivations, en excipant sous un angle très novateur, la notion de « service rendu à la nation » contenue dans le Code de la Nationalité, qui relève, celui à qui il est reconnu, de certaines incapacités pouvant faire obstacle, à la pleine et entière jouissance des droits, attachés à la possession de la qualité d’ Ivoirien : « …Considérant, cependant, que l’article 44 du Code de la Nationalité ivoirienne précise que «le naturalisé qui a rendu à la Côte d’Ivoire des services exceptionnels ou celui dont la naturalisation présente pour la Côte d’Ivoire un intérêt exceptionnel peut être relevé en tout ou partie des incapacités prévues à l’article 43 par le décret de naturalisation»: Que l’article 2 du décret n° 2004-465 du 07 septembre 2004 portant naturalisation du Sieur DOLO Adama dispose: «A titre exceptionnel, l’intéressé est relevé des incapacités prévues à l’article 43 du Code de la Nationalité ivoirienne»; Qu’il convient, dès lors, de déclarer Monsieur DOLO Adama éligible à l’élection présidentielle et d’inscrire, en conséquence, ses nom et prénom sur la liste définitive des candidats à ladite élection ….» (Décision n° CI-2009-EP/028/19-11/CC/SG du Conseil Constitutionnel, relatif à la publication de la liste des candidats à l’élection présidentielle )
C) – L’absence d’effets d’une mesure exceptionnelle, caduque et manifestement illégale (Décision Présidentielle N°2005-01/PR du 5 mai 2005)
L’analyse de sa décision dans la configuration des autres candidatures, démontre avec constance, une réelle volonté, de ne pas rompre le principe d’égalité des candidats. En effet, même en présence de la Décision Présidentielle du 5 mai 2005 relative à la désignation, à titre exceptionnel, des candidats à l’élection présidentielle d’octobre 2005, prise sur le fondement de l’article 48, le Conseil Constitutionnel a traité tous les candidats sur le même pied d’égalité. Alors que celle-ci prescrivait en son Article 1er, que les candidats issus des partis signataires des Accords de Linas-Marcoussis étaient dispensés, à la différence des autres candidats, de la productions des actes administratifs et juridiques requis pour le contrôle et la validation de leur éligibilité, le Conseil Constitutionnel, les a néanmoins réclamé, et a déclaré, après examen de ceux-ci, les candidats concernés, éligibles. « Considérant qu’en application des textes en vigueur et par décision n° CI-2009-EP-026/28-10/CC/SG, le Conseil constitutionnel a arrêté la liste des pièces exigibles des candidats à l’élection présidentielle comme suit: …. par la même décision, le Conseil constitutionnel a publié la liste provisoire des candidats, et invité ceux-ci, à compléter leur dossier au plus tard le mardi 10 novembre 2009 à 16 heures ». La conséquence immédiate du dispositif de ladite décision, est de la priver de tout caractère exceptionnel. Celle-ci étant manifestement prononcée sur la base des conditions générales de contrôle d’éligibilité, « normales » et communes à tous les candidats, alors que la Décision présidentielle consacrant ce caractère stipulait que « … les candidats présentés par les partis politiques signataires de l’accord de Linas-Marcoussis sont éligibles… ». Ceci entend qu’ils le sont d’entrée et de facto, sans aucune condition et sans qu’il ne soit besoin d’un contrôle de conformité, puisqu’ils sont d’ores et déjà réputés éligibles. En ôtant à sa décision ce caractère exceptionnel, il convient de la considérer également et pleinement, comme une nouvelle jurisprudence.
Le Conseil Constitutionnel aurait-il voulu juger implicitement la décision présidentielle évoquée, comme étant nulle, et de nul effet (illégale suivant le mot du Professeur Mamadou Koulibaly), qu’il ne saurait mieux s’y prendre, car en effet, l’article 48, prévoit une concentration des pouvoirs (exécutif, judiciaire et législatif), par opposition au principe de la séparation des pouvoirs, et non une extension de ceux-ci, à effet de les placer au-dessus de la souveraineté du peuple, qui était le seul à pouvoir prendre une telle décision, par la voie référendaire, car en dernier ressort, comme nous l’avons souligné précédemment, « La souveraineté appartient au peuple… » (Art. 31, Al 1). Le strict respect de l’esprit et de la lettre de la Constitution, ne permettait à « … aucune section du peuple, ni aucun individu… » quel que soit son rang (Président de la République ou Conseil Constitutionnel) de modifier les dispositions relatives à l’élection du Président de la République. En effet, « Est obligatoirement soumis au référendum le projet ou la proposition de révision ayant pour objet l’élection du Président de la République, l’exercice du mandat présidentiel, la vacance de la Présidence de la République et la procédure de révision de la présente Constitution. » (Art. 126, Al.2).. Par ailleurs, un acte ou une procédure sont réputés entiers, ils ne sauraient être partiels, valable pour les uns, et pas pour les autres. Ce vice entache l’acte ou la procédure de nullité relative. Était-ce l’appréciation du juge constitutionnel, sans le dire, puisqu’il n’a tenu aucun compte de ladite Décision présidentielle ?
Il est remarquable également que ladite décision, mentionnait expressément et de manière restrictive, sa validité « A titre exceptionnel et uniquement pour l’élection présidentielle d’octobre 2005, … » (Art. 1, Déc. N N°2005-01/PR du 5 mai 2005). Du fait de cette limitation expresse, celle-ci ne pouvait plus s’appliquer aux élections de 2010, au regard de la caducité qui la frappe. La nullité absolue de l’acte s’opère ici, de plein droit, du fait de la disparition de la date exclusive et impérative à laquelle la Décision était attachée. Cet ensemble de faits, donne portée générale, aux délibérations du Conseil Constitutionnel, ayant prononcé l’éligibilité des candidats à l’élection présidentielle de 2010, sur la base des dispositions ordinaires, autres que le dispositif de la Décision querellée. Cet axe d’analyse renforce dans le même sens, et de plus fort, la jurisprudence précédente.
3 – Conclusion : ouverture de nouvelles opportunités pour l’élection présidentielle de 2015
La jurisprudence est « la solution suggérée par un ensemble de décisions suffisamment concordantes rendues par les juridictions sur une question de droit. ». Celle dont nous disposons à ce jour, est le rejet de la candidature du Président Alassane Ouattara, en 2000, et l’admission de son éligibilité, en 2009/2010. Comment harmoniser ces deux décisions inconciliables ? En effet, nous sommes en présence d’un important revirement jurisprudentiel. Ceci conduit à s’interroger sur la logique et la portée de ce revirement, marqué par une volonté de réconciliation et d’inclusion, qui traduit la viabilité d’un impératif : l’unité nationale, l’égalité des citoyens et des candidats devant le droit. La mesure d’exception prise par le Président de la République de l’époque, en vertu de l’article 48 de la Constitution, n’est pas un élément jurisprudentiel, car son auteur n’est pas un juge, mais un politique. Une telle décision est inapte à produire une jurisprudence. L’esprit et la finalité des accords politiques qui ont inspiré cette décision, ont ils disparus par enchantement? Que nous reste-t-il alors, pour assurer la continuité de l’ordre constitutionnel sur les questions centrales de « l’éligibilité des candidat » et de « la vérité des urnes » ? Notre Conseil Constitutionnel en développant une doctrine jurisprudentielle contraire au formalisme d’une volonté politique au service des intérêts des pouvoirs successifs et de groupements politiques, a réussi, volontairement ou involontairement, la prouesse de débarrasser définitivement notre Loi fondamentale de la politique. Ceci constitue une avancée notable vers « la construction d’un État de droit démocratique pluraliste ». Cette évolution mérite d’être confirmée en 2015. Cette préférence donnée à la jurisprudence de 2010 et non à celle de 2000, est dictée par l’intérêt national, mais surtout par son adéquation avec l’évolution de la réalité sociopolitique, car en définitive, l’élection est une institution qui assure la permanence du référendum populaire, en tant que consultation directe du peuple. C’est par elle, que le peuple, exprime à travers un processus continu, sans cesse renouvelé, sa volonté souveraine, quant aux représentants et gouvernants qu’il se choisit librement, tout au long de son histoire. Or, en élisant le Président Alassane Ouattara en 2010, le peuple a clairement exprimé dans sa majorité, son approbation à son éligibilité et sa volonté de lui confier un mandat électif. Dans cette perspective, il n’est nul besoin, ni de modifier la Constitution, ni de référendum formel, mais la nécessité de réconcilier les jurisprudences 2000 et 2010, par une révision du Code de la nationalité, en étendant le bénéfice du principe d’exceptionnalité de l’article 44, relatif aux « services rendus à la nation et à l’intérêt que présente un individu pour la Côte d’Ivoire » à tout ivoirien de fait ou de droit, pour le relever de toute incapacité pouvant faire obstacle à la pleine et entière jouissance de sa qualité d’ivoirien. Cette solution est soutenue par la jurisprudence « Dahico » et la jurisprudence « ADO, en l’absence d’une mesure d’exception valide et légale ». Celle-ci, nous permet d’attendre dans la sérénité une révision formelle de la Constitution, qui s’impose de toutes les façons, pour la « dépolitiser », répondre à une demande sociale sur bien d’autres aspects, et mettre en harmonie notre arsenal juridique, relativement au processus électoral. Nous gagnons davantage, à sortir de ce débat passéiste et surréaliste, pour avancer vers une exigence qualitative et inclusive, favorisant la démocratie et la bonne gouvernance. L’outil constitutionnel n’a pas vocation à susciter des crises et des conflits, mais au contraire à les éviter, par son rôle régulateur. C’est pourquoi, dans la conception moderne, le juge constitutionnel, est débiteur de cette obligation vis à vis de la communauté nationale. La Constitution, devient sous cet rapport, un espace social et politique du droit, situé au cœur même de la société, et non en dehors d’elle, qui doit trouver un équilibre entre ses différents plans, pour maintenir la paix et la cohésion sociale, face aux difficultés des situations nouvelles. «La justice est un juste milieu, si le juge en est un » disait Aristote. Son autorité découle donc également de son utilité, en tant qu’arbitre dans la résolution pacifique des conflits d’intérêts ou de pouvoirs, qui peuvent surgir dans la société, au moyen du droit. Ce dernier est d’abord au service de l’intérêt général. Cette conception du rôle de l’instrument constitutionnel est plus proche de celle des Anciens des communautés villageoises africaines, où la justice repose sur une philosophie de médiation, que de celle d’une conception abstraite du droit, où la loi est « sourde et aveugle », parce que fermée aux contingences environnementales. C’est un débat entre Anciens et Modernes, entre conformisme et progressisme. La tendance de la « post-modernité » est de considérer, que la fidélité aux textes n’exclut pas nécessairement la souplesse dans l’application du droit aux faits, faute de quoi, la justice continuera à fabriquer malgré elle, de « l’injustice », alors que ce que recherche avant tout le citoyen, est la justice et le bon sens, et non la lecture du droit. Autrement dit, si l’on peut faire cette violence à la langue, il faut que la justice soit « juste et intelligente », donc qu’elle « se socialise ». C’est ce que nous attendons d’elle, pour les élections de 2015, afin que celles-ci soient suffisamment apaisées, crédibles, et transparentes, pour nous permettre d’entendre, de manière audible, la voix du peuple. Encore et encore, l’organe vocal de ce dernier, est l’urne et non le droit.




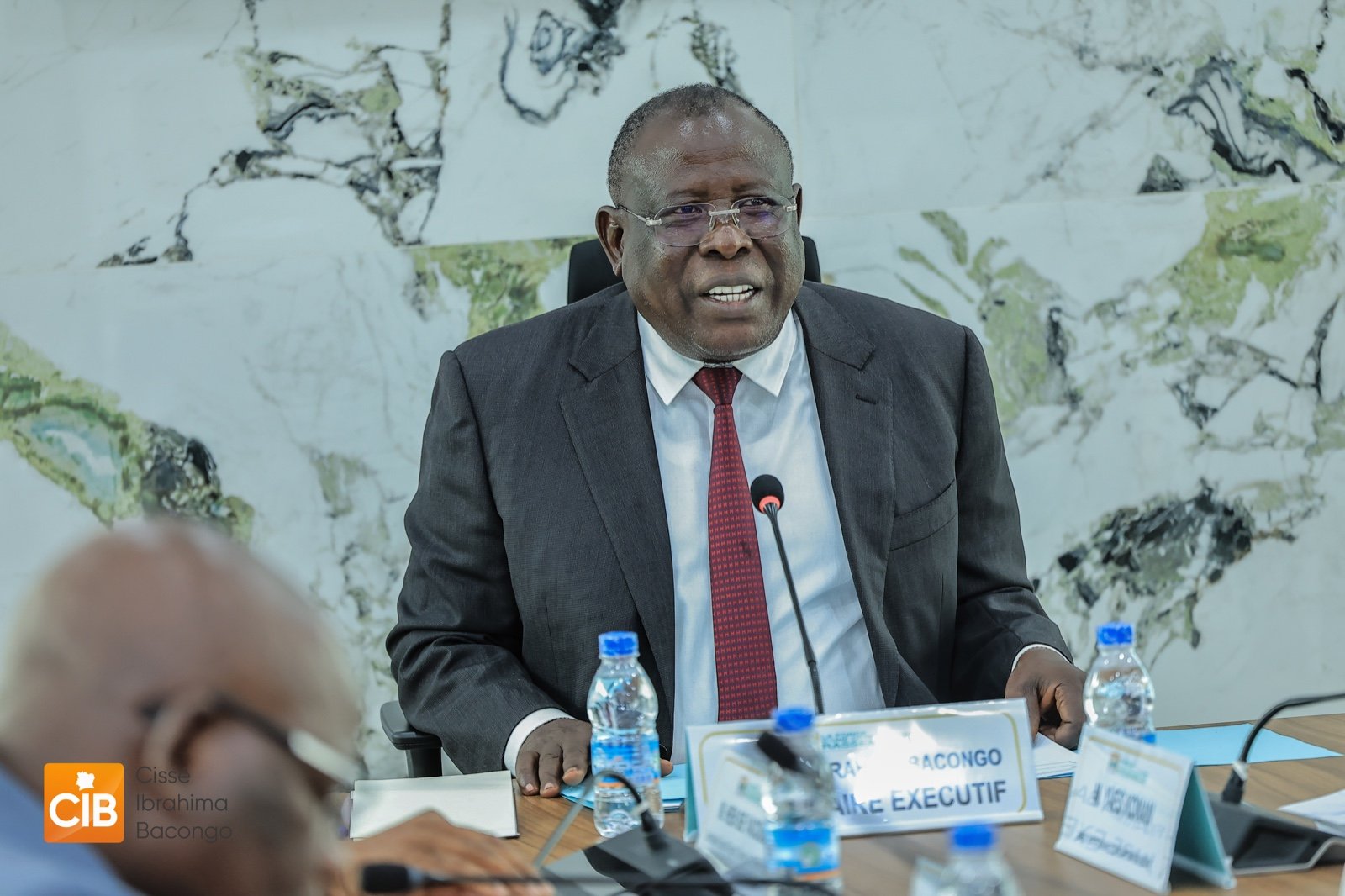


Les commentaires sont fermés.