
Par David Ngoran – Contribution éditoriale Connectionivoirienne.net
Ainsi donc, sa voix vient de s’éteindre de cette sonorité presque rouillée mêlée du son de l’arc, « le dôdô » de notre culture locale. Nous autres de cette génération du renversement, sommes parmi les derniers à avoir bénéficié de l’ombre de l’homme, tel un gros arbre qui offre généreusement de son feuillage. Je le revois encore dans cet amphithéâtre de l’Université de Cocody, encore radieux de son statut de ministre de la culture du gouvernement Duncan, la craie à la main et arborant une chemise au blanc de coton. Le « maître », tel que nous le nommions affectueusement officiait avec la passion qu’on lui connait. Son garde de corps patientait dehors. Bernard Zadi nous parlait, entre autres, de « l’aventure du mot » ou de « la dialectique matérialiste appliquée au texte littéraire », ou encore de « l’axe symbolique » qu’il avait suggéré pour rendre complet le schéma jakobsonien du langage. C’était une véritable célébration, l’amphi refusait du monde. Et nous autres, têtes frêles sur le chemin de la vie, étions installés aux toutes premières rangées, afin de boire allègrement de ce nectar qui donne l’allure aux belles fleurs.
Bien sûr, nous venions trop tard dans un monde assez vieux car au moment où nous foulions le sol de l’Université d’Abidjan, Bottey Moum Koussa que le devin guérisseur du village avait choisi de nommer « Zaourou » de l’incarnation de l’ami-double de la grand-mère (doubéi de la culture bété) était presqu’à l’apothéose de son corps-à-corps avec les temps qui tanguent. Ceux-ci s’irradiaient en deux grandes mythologie de la nuit du monde africain postcolonial que sont la littérature et la politique.
La première jouait en ce temps-là, sa fonction première d’ « arme miraculeuse » des peuples noirs et africains dressés contre l’adversité coloniale et ses déguisements en soleils des indépendances. Bottey Zadi s’était alors levé comme le plus césairien de tous les hommes de plumes sur la Côte des ébènes. Il reprenait en échos ce beau chant qu’avait proposé le monument martiniquais et que psalmodiait la négraille débout et dispersée aux quatre coin du monde. Bottey travailla à réinventer « l’histoire des sans histoires ». Sa sentence était sans appel: « Écoute Dowré, jamais mon peuple et moi n’avons été hors de l’histoire, mais dans le ventre de l’histoire (…) Voici désormais tous mêlés hors espace hors temps la ronde des ombres fortes / les meilleurs de mes fils / ceux dont le front touche aux rivages du soleil ..».
Parce que le viol a commencé par le langage, les sujets nègres que nous sommes ne pouvions occuper notre place au monde que par la maitrise du langage. Zadi contribua à l’élaboration d’un contre-discours littéraire à partir des grands récits de la tradition orale. Ainsi naquit « le didiga », cet art de « l’impensable » dont la forme de représentation empruntait aux récits des chasseurs traditionnels, ainsi qu’à l’art poétique des artistes de son terroir en la personne, par exemple, de Gbazza Madou Dibero, le grand diseur de symboles qui lui légua la symbolique de la pluie diluvienne, « l’étonnante pluie diluvienne, l’extraordinaire pluie diluvienne ».
De tous les genres et de toutes les époques, les œuvres majeures de Zadi ( Fer de lance, 1975. Les Sofas suivi de L’œil 1979, La tignasse 1984, La guerre des femmes, suivi de La termitière 2000) invitèrent à la méditation d’une seule et même leçon : à savoir que nous sommes les fils aînés du monde et que l’œuvre de l’homme ne vient pas seulement de commencer, contrairement à ce que proclamait le discours eurocentriste dominant, à force de nous gonfler de mensonge et de pestilence.
Quant à la deuxième mythologie, c’est-à-dire la politique, elle apparaissait, en ce temps là également, comme le double nécessaire de la chose littéraire. Bernard Zadi, à l’instar de cette génération d’insubordonnés, ses aînés (Harris Memel-Fôtê, Kotchy Barthélemy, Jean Lorougon Guédé, Oupoh Oupoh Joseph, Francis Wodié Romain, Henriette Dagri Diabaté) et ses cadets (Laurent Gbagbo, Moriféré Bamba, Sery Bailly Zacharie, Ouraga Obou Boniface, Yacouba Konaté), avait rêvé d’une cité idéale africaine, selon le modèle des idéaux sociétaires dans sa version marxisante.
Pourtant, sur le terrain de l’action politique, le cœur prit la place de la ruse, la raison surpassa la passion, et l’intelligence surplomba l’instinct du commandement.
Zadi se positionna à droite de ce qui faisait office de « gauche socialiste » à cette époque pour se proclamer « social démocrate ». Suivant la vision réformiste de cette tendance contre l’orthodoxie socialiste traditionnelle, friande de « révolutions » et d’humeur insurrectionnelle, Zadi tourna, par exemple, le dos au boycott actif de 1995. En 1999, certains acteurs politiques saluèrent le coup d’État de Robert Guei, parce que « salutaire pour la démocratie » (Laurent Gbagbo) ou d’une « révolution des œillets » (Alassane Ouattara), quand Zadi disait « Non » à la dérive du bateau ivoire qui venait ainsi d’entonner le chant du « kwali » ou le rythme de la mort. Il nous mit en garde contre « les frasques de Pap’Rémo, mauvais fils et cauchemar d’Eburnie, héros dont la seule et maudite victoire est d’avoir violé et vaincu sa mère ». Il pleura pour ce pauvre peuple naïf « qui croyait qu’un père Noël lui venait du ciel ténébreux en tenue de combat (godillots et treillis) et sabre au clair pour en finir en un duel à mort avec la misère et la dette prédatrice » Zadi nous demanda d’ouvrir les yeux là où « le bal de mutins devînt bal de butin, essaims d’assassins, bals des coquins ».
Bottey Moum Koussa, fier et digne fils de Yacolo s’est dressé contre les combines nocturnes tendant à imposer une constitution confligène, comme il le disait lui-même « digne d’analphabètes », dans le seul intérêt égoïste et politicien.
C’est ainsi qu’advînt sa part de blues, l’angoisse terrible de tous les intellectuels africains dignes de ce nom, et dont l’expérience de l’entrisme a débouché sur des ailes calcinées, le portrait défait, une figure acéphale, un sujet aphone, un monstre pour ses pairs,désormais sans conscience parce que l’âme en ruine, offrant au reste de la société, tout le profil du personnage tragique.
Heureusement, pour nous et pour lui-même, Bottey Zadi a su se détourner à temps de ce chemin qui ne mène nulle part, si ce n’est dans la vallée de la mort ou au cœur de la grande nuit, à proximité de la forêt noire, là où résident les bêtes sauvages, mi-hommes, mi-bêtes, alchimistes du vrai et du faux, ivres du sang de leurs concitoyens.
On ne la jamais entendu se proclamer messie, il n’a jamais su acquérir de grosses cylindrées, il n’a rien volé, il n’a jeté personne en pâture pour le pouvoir . Il a juste proposé à au moins 32 générations d’ivoiriens et d’africains, une vie simple de citoyens de leurs pays et du monde, loin des bruits et des fureurs.
Pour ceci, Il a vécu la vie de la termitière. Or, que dit la devise du tambour à propos de la termitière? « Si la termitière vit, qu’elle ajoute de la terre à la terre! ».
Dr David N’goran, Université de Cocody IEP de Strasbourg
……………………
Comme suit, un entretien qu’il m’accorda le 11 aout 2003 au GRTO dans le cadre de mes recherches doctorales.
Il est extrait de de mon prochain livre, Les Illusions de l’africanité, une analyse socio-discursive du champ littéraire, sous presse chez Publibook, à Paris.
Entretien avec ZADI Zaourou, Écrivain
Réalisé par David N’goran
David N’Goran : Votre nomination connaît une sensible évolution: de Bernard Zadi Zaourou, vous vous faites appeler Bottey Moum Koussa, un peu comme James N’gugi passant à N’gugi WA Thiongo, Comment l’expliquez-vous?
Bernard Zadi : Le problème des noms est un problème que tous les Africains ont en commun ; il n’y a pas un africain qui ait un nom unique. C’est tellement vrai que dans la société dite moderne, certains parents appellent leurs enfants Yves-Charles-Joseph-Pierre. Un peu comme si être appelé Pierre ou Joseph ne suffisait pas. Mais c’est le réflexe de la tradition qui inspire ce chapelet de prénoms. Nous les Africains nous n’avons pas un nom unique. On passerait des jours à dire de quoi ils retournent ; un tel par exemple n’a pas le nom de son père ; un tel autre porte un nom de guerre. Telle autre femme porte un nom de coquetterie. Il y a des gens qui, devenus célèbres, reçoivent des noms que leur donnent différents poètes qui les célèbrent.
Pour les écrivains africains, il y a par exemple le cas d’Eza Boto, vous avez parlé de James N’gugi, Charles Nokan qui devient N’gbessi Zégoua Nokan … enfin c’est tellement courant qu’on ne peut pas épiloguer là-dessus.
Mais la raison dans mon cas est assez simple. D’abord, il y a la fantaisie de tous les créateurs comme chez les musiciens où des gens se font baptiser de noms à plusieurs consonances. Par exemples, Johnny Halliday ne s’appelle pas Johnny Halliday. Parmi les écrivains français, la pratique est courante. Alors pourquoi le créateur, l’écrivain a-t-il besoin de masquer son nom ? Je crois en dehors des cas extrêmes des pays où la dictature se dresse contre les créateurs et les assassine, en général les créateurs, particulièrement, les écrivains ont recours à cette pratique parce que le nom de famille leur apparaît souvent comme prosaïque et aussi parce que les autres noms ont souvent une valeur symbolique. Moi dans mon cas, mon nom et mes prénoms c’est Zadi Zaourou Bernard. Mais j’ai été confronté dans mon enfance à une maladie qui a failli m’emporter. Ma mère, de sa ferme volonté de me faire recouvrer la santé est allée voir le grand féticheur traditionnel, d’un village voisin ; ce prêtre après avoir consulté a révélé que mon nom initial donné par mes parents Bottey Moum Koussa n’était pas le vrai et qu’en réalité mon nom était Zaourou c’est-à-dire que j’étais la réincarnation d’un ami intime (doubei c’est-à-dire ami sans commerce de la chair) de ma grand-mère. Il fallait donc me faire débaptiser. Bottey Moum Koussa est donc devenu Zaourou. Devenu écrivain, j’ai jugé bon de dépasser ce nom rituel pour ce nom initial qui est quand même le mien. Mais cela dit, j’ai tant d’autres noms par lesquels les poètes qui m’aiment et qui m’admirent m’ont baptisé et me reconnaissent.
DN : Au-delà de cet apparent ‘‘retour aux sources’’, on remarque aussi que sous votre plume, comme chez celles de plusieurs autres écrivains africains, ‘‘oralité’’ se conjugue avec ‘‘tradition’’ et ‘‘Afrique’’, établissant ainsi une coupure avec l’Europe. Peut-on alors savoir à quel public avez-vous pensé particulièrement lorsque vous écriviez vos premières œuvres ?
BZ : Mais comment d’ailleurs un écrivain africain peut-il se prétendre écrivain africain en tournant le dos à l’Afrique. Bien sûr quelques complexés avant la Négritude ont joué à ce petit jeu-là. Mais ça ne peut pas être le destin de toute une nation entière ou de tout un peuple d’écrivains. Il arrive aussi des cas où un enfant qui grandit dans un environnement ne peut rendre compte que des réalités inspirées par cet environnement. Parce que quelqu’un comme Damas qui est un nègre et un grand écrivain français ne peut pas rendre compte des réalités bambara, baoulé ou bassa ou encore yoruba dans ses œuvres. Il ne pourrait que parler de la France et de son époque. Pour nous autres poser le problème est étonnant. Personnellement quand j’écris, mon histoire m’a déjà précédé. J’ai été avant tout un enfant de l’ouest de la Côte d’Ivoire. En tant qu’écrivain ivoirien donc, je ne pouvais pas rendre compte de la Bretagne que j’ai découverte plus tard. Mes racines ne pouvaient pas épouser ces contrées-là que je n’ai rencontrées que plus tard. Il y a donc d’abord un problème de racine. Il y a ensuite le problème de la servitude linguistique de l’Africain. Nous sommes pris dans la contradiction du désir de parler à notre peuple, pour notre peuple et le fait que nous sommes phagocytés par l’étant d’une langue étrangère. Ce problème-là est celui de tous les écrivains francophones ; il a donné lieu à des débats multiples dans les arcanes desquels nous ne voulons pas entrer ici : Je tiens surtout à souligner que l’écrivain africain voudrait dire sa part de vérité culturelle là où la langue devrait permettre d’expliquer cette vérité-là. Qu’est-ce à-dire concrètement ?
La langue française a son esthétique propre. On ne peut y échapper. C’est-à-dire que vous faites une belle image, ça ne sera pas plus qu’une image française. Si j’intègre un rythme à ma phrase, à mon vers, ça ne sera jamais qu’un rythme français. L’image appartient à une langue. Elle emprunte la matière constructive à la nature de l’environnement, à l’univers qui s’offre à nos sens, au socle dans lequel nous évoluons … Donc rendons à l’Afrique, à partir de ces présupposées, sa part de vérité culturelle. Évidemment quand Césaire dit que « la mer est un chien qui mord la plage au jarret », c’est une image universelle, elle n’est pas proprement négro-africaine, bretonne, russe. La mer d’ailleurs n’est pas partout agressive ; signalons que la méditerranée n’est pas une mer qui se bat. Elle est calme et n’a pas de vagues. Et donc déjà le type d’élément marin auquel nous avons affaire ne laisse pas indifférent ; la méditerranée n’est pas l’atlantique. Mais l’élément marin reste au moins une image de type universel. Mais quand il dit : « terre grand sexe élevé vers la nature de Dieu », quiconque a un minimum de culture africaine sait que cette image est bien de chez nous et est susceptible de restituer à l’Afrique sa part de vérité dans cette image dont les noms sont essentiellement français. J’ai dans mes recherches étudié la forme de base du rythme africain qui est essentiellement monochrome, binaire, ternaire. Et se sont ces trois éléments démultipliés auxquels il est accordé des vitesses différentes à l’infini qui donnent le rythme africain. Si bien que quand tu entends un rythme bamiléké tu peux le danser sans être bamiléké bien entendu … Voilà donc ce que je peux dire ; je suis contraint d’écrire pour l’élite lettrée. C’est pourquoi d’ailleurs je me réjouis d’avoir pratiqué l’art dramatique parce que cet art transcende les cloisons de l’écriture ; il y a tous les langages dans l’art dramatique : le langage du corps, du costume, du décor, etc. ; si bien que quelqu’un qui ne sait pas lire peut se retrouver dans la représentation d’une pièce. Dans une œuvre comme la termitière par exemple, il y a plus de didascalies que de paroles.
DN : Il y a certaines notions qui m’ont interpellé ; les notions par exemple de « racine », de « servitude linguistique », d’ « écrivain africain ». Si bien que j’ai l’impression que vous conjuguez la littérature avec la notion d’identité. J’aimerais alors savoir votre approche de cette notion.
BZ : Ça tient en deux mots : c’est être soit même sans avoir à faire d’effort pour le demeurer et de continuer de l’être. Moi Bernard Zadi, je suis un homme tellement libre en moi-même que dans ce pays il y a une chose que les gens me reconnaissent, c’est que je ne suis pas un homme trafiqué. La langue française par exemple m’a été imposée par la défaite militaire que mon peuple a subie ; donc je suis un infirme comme je l’ai dit plus haut, dont la force n’est pas de se complaire dans son infirmité mais plutôt de la compenser. J’ai la chance de pratiquer plusieurs arts : la musique, l’art dramatique, etc. qui me permettent d’échapper aux exigences de l’écriture pour célébrer l’art traditionnel et oral qui constitue l’essentiel de ma culture. Donc je crois que la question de l’identité pour le négro-africain est un lien total entre sa chute à un moment de l’histoire et des efforts pour se relever de cette chute. L’Afrique est en marche, c’est la renaissance aujourd’hui.
DN : En investissant ainsi la notion d’« identité » et celle de « renaissance », ne craignez-vous pas qu’il y ait une interférence malheureuse entre le champ culturel et le champ politique ?
BZ : Ce n’est pas parce que les politiciens nagent et continuent de nager dans leur marre que les philosophes, les artistes, les religieux et tous ceux qui ont un autre univers doivent abdiquer. Mais qui sont-ils les politiciens ? Ils ne sont rien ! Ils ne sont que des instruments aux mains des financiers ? Pensez-vous que nous allons laisser les politiciens gouverner l’ensemble de la planète ? Ce serait gravissime; ce serait la mort certaine de la pensée ! Voyez un peu ce que sont en train de faire les mondialistes mus par la seule logique de la haute finance. Mais au nom de quoi peut-on interdire à un groupe, à une nation d’affirmer et de vivre son identité ? Parce qu’une institution a décidé d’établir un cordon de terreur intellectuelle ? Mais non ! Disons que l’identité est un phénomène essentiel même à notre existence, c’est notre histoire. C’est pourquoi, face à ce débat, il ne faut pas abdiquer.
Il faut plutôt ramener le débat sur l’identité à sa juste mesure. En Côte d’Ivoire, la constitution a été saluée sous Guéi. J’ai été un des rares à avoir expliqué à des prétendus juristes que cette constitution était porteuse des germes de la guerre actuelle dont nous aurions pu faire l’économie. S’il faut adopter cette fausse approche de la notion d’identité comme dans notre cas, il aurait alors fallu renier les courants anciens de la Négritude, de la négro-renaissance, le mouvement indigéniste et même le congrès panafricain des écrivains tant à Paris qu’à Rome. Il faut même renier les combats d’Houphouët-Boigny, de Nkrumah, de Senghor et de tous les nationalistes de l’histoire qui ont lutté pour refuser la politique d’assimilation que voulaient nous imposer la France, la Grande-Bretagne et tous les grandes puissances colonisatrices. Il fallait alors renier tous ces combats qui sont des combats identitaires. Notre identité ne devrait et ne saurait être un concept de reniement de l’autre. Bien sûr, il y a les politiciens dont la pensée est tellement faible qu’ils ne manquent pas de velléités de manipuler la question identitaire.
En revanche, pour ce qui est de « l‘ivoirité », disons que jamais le Président Bédié qui l’a inventé ne lui a donné un contenu exclusionniste. La source même de ce concept relève des fleurs du jardin Senghorien : « sénégalité », « francité », « arabité », « malgacité » à partir desquelles Niangoran Porquet affirme pour la première fois que sa « griotique » n’est que l’expression de son « ivoirité ». Récupéré par le Président Bédié, « l’ivoirité » était plus rassembleur que diviseur. En tout cas, elle devrait rassembler à la fois les nationaux et les étrangers vivant sur le sol ivoirien.
En tant que Ministre de la Culture de l’époque, je n’ai pas mémoire d’une telle définition réductionniste. J’aurais d’ailleurs été le premier à la combattre. Donc pour cette question de l’identité, on ne peut pas demander aux philosophes, aux créateurs d’abdiquer face aux politiques.
DN : Vous parlez des politiciens comme d’une race particulière d’hommes. Mais vous avez vous aussi nagé dans la marre de la politique.
BZ : Mais je n’ai jamais dit qu’il était mal de faire la politique. J’ai formé des centaines d’hommes politiques de ce pays ; même la gauche actuelle au pouvoir est passée dans mes mains. Mais au stade où je suis, je ne peux pas recommencer en politique. C’est pourquoi, alors même que j’en avais le pouvoir, j’ai préféré ne pas dégommer les jeunes qui, à l’intérieur de mon parti, dévoyaient mon idéologie ; j’ai préféré dis-je me retirer afin de ne pas me salir jusqu’à l’âme. J’ai donc effectivement été politicien et je n’en ai pas honte. Cela dit, je peux toujours prendre part au débat public.
DN : Revenons à la littérature. Pourquoi Zadi publie toujours chez CEDA ou NEI contrairement à ses pairs comme Kourouma ou Pacéré qui eux préfèrent publier chez Seuil l’Harmattan et P.J. Oswald. Est-ce un choix particulièrement motivé ?
BZ : Non, pas particulièrement mais mon principe est très simple. L’essentiel pour moi c’est que l’œuvre existe et s’impose au temps. Le problème pour moi n’est pas le lieu d’édition en tant que tel ; c’est vrai que nous les artistes sommes peu modestes. Mais pour ma part je n’ai jamais eu de complexe particulier pour faire éditer mes œuvres. Je n’ai jamais déposé mes manuscrits chez les éditeurs occidentaux sinon j’aurais été certainement édité. Tenez ! Le livre I de Fer de lance qui n’appartient ni à Seuil ni à Plon figure dans toutes les anthologies de la littérature négro-africaine.
DN : Le couronnement, ce n’est pas uniquement les anthologies, mais c’est aussi le fait d’être consacré par l’obtention des prix littéraires, or comme Césaire, vous n’avez jamais reçu de prix.
BZ : Les prix, ce n’est pas un problème ; je ne m’en soucie même pas car il ne faut pas que l’œuvre soit faite à la hâte non plus pour une question de prix. Adiaffi disait à propos des prix : « les prix ont leur prix ». Je ne le dis pas pour dénigrer ceux qui ont déjà été primés mais je pense que l’essentiel pour l’écrivain ne réside pas dans le prix. Le prix ne peut pas toujours servir à percevoir le génie du créateur. Pour tout dire, l’essentiel pour moi c’est que l’œuvre existe. Cela dit, il y a quand même tout récemment le Centre International des Études Francophones (CIEF) qui a choisi sans tractation aucune et librement, de m’octroyer un prix pour l’ensemble de mes recherches. Cette consécration me va droit au cœur dans la mesure où j’ignorais l’existence même de ce centre.
DN : Sans être chasseur, le maître serait-il initié aux secrets de l’art de la chasse ?
BZ : Non, non. Je suis un intellectuel ; je ne suis pas un « dozo » . Ce sont des éléments d’expression dans la perspective de ma création artistique. D’ailleurs le groupe ethnique auquel j’appartiens n’a pas une grande culture de l’initiation.
DN : Maître Pacéré dit être initié aux secrets des arts sacrés.
BZ : Mais pourquoi voulez-vous que je sois maître Pacéré ? C’est quelqu’un avec qui j’ai une profonde amitié. D’ailleurs mon regretté ami Massan Makan Diabaté ne dit pas autre chose à propos de l’art du griot. Mais ça c’est à laisser à l’appréciation de chacun. Personnellement ma création se fait à partir d’un art de la parole qui a bercé mon enfance. Au demeurant, si l’on dit parler d’initiation dans mon cas, il s’agira d’une initiation moderne en tant qu’universitaire.
DN : Vous marquez aisément la distinction entre littérature française, littérature anglaise, espagnole … mais lorsqu’il s’agit du cas africain vous parlez de littérature africaine comme s’il était impossible de concevoir une littérature ivoirienne, ghanéenne c’est-à-dire nationale n’intégrant pas forcément une homogénéité africaine. N’êtes-vous pas en train de nier l’existence d’un génie africain en dehors du groupe.
B Z : Je crois que la question est très importante mais on ne peut pas refuser d’assumer l’histoire. Quand vous dites comme ça « la Côte d’Ivoire » ou « le Ghana », que représentent-ils comme entités ? La Côte d’Ivoire par exemple devenue un État en 1893. Et notre littérature écrite ivoirienne ne date que de 1959. Le père de cette littérature, B. Dadié est là, il est encore plus frais que vous et moi. Alors, à votre avis que représente une telle littérature dans ce vaste océan de la littérature africaine dont l’histoire se conjugue avec l’esclavage, la colonisation et l’indépendance?. Donc, notre vision des choses doit d’abord être d’ordre panafricaniste, malheureusement brisé par les politiciens. Les visions micro-nationalistes sont une régression par rapport la pensée panafricaniste qui habitait tous les intellectuels. La Côte d’Ivoire d’aujourd’hui par exemple est une déviance de ce point de vue. Je crois donc qu’il ne faut pas s’en désoler ; il faut plutôt mettre dans la tête des jeunes que la Côte d’Ivoire actuelle n’est qu’un passage, c’est-à-dire une étape transitoire. Au-delà du côté idéologique de votre question, disons que pour en revenir à la littérature, parler d’ « une littérature orale ivoirienne » est plus intéressant que parler d’ « une littérature écrite ivoirienne » qui est très jeune.
DN : Pour finir, quelle peut être, selon vous la fonction de l’écrivain aujourd’hui ?
BZ : Mais il n’y a pas de fonction standard. Sa fonction principale c’est de créer des mots. Quelle autre fonction peut-il avoir au-delà ? Dire que l’écrivain africain ne crée pas, c’est même une insulte. C’est même une hérésie du point de vue linguistique. La parole est toujours spécifique d’un individu à un autre individu. Il en est de même pour la parole artistique c’est-à-dire la littérature. En tant que art de la parole, la littérature demeure un lieu d’exploitation des possibilités artistiques de la langue. La langue en est la matière première et son usage artistique constitue la fonction principale de l’écrivain.





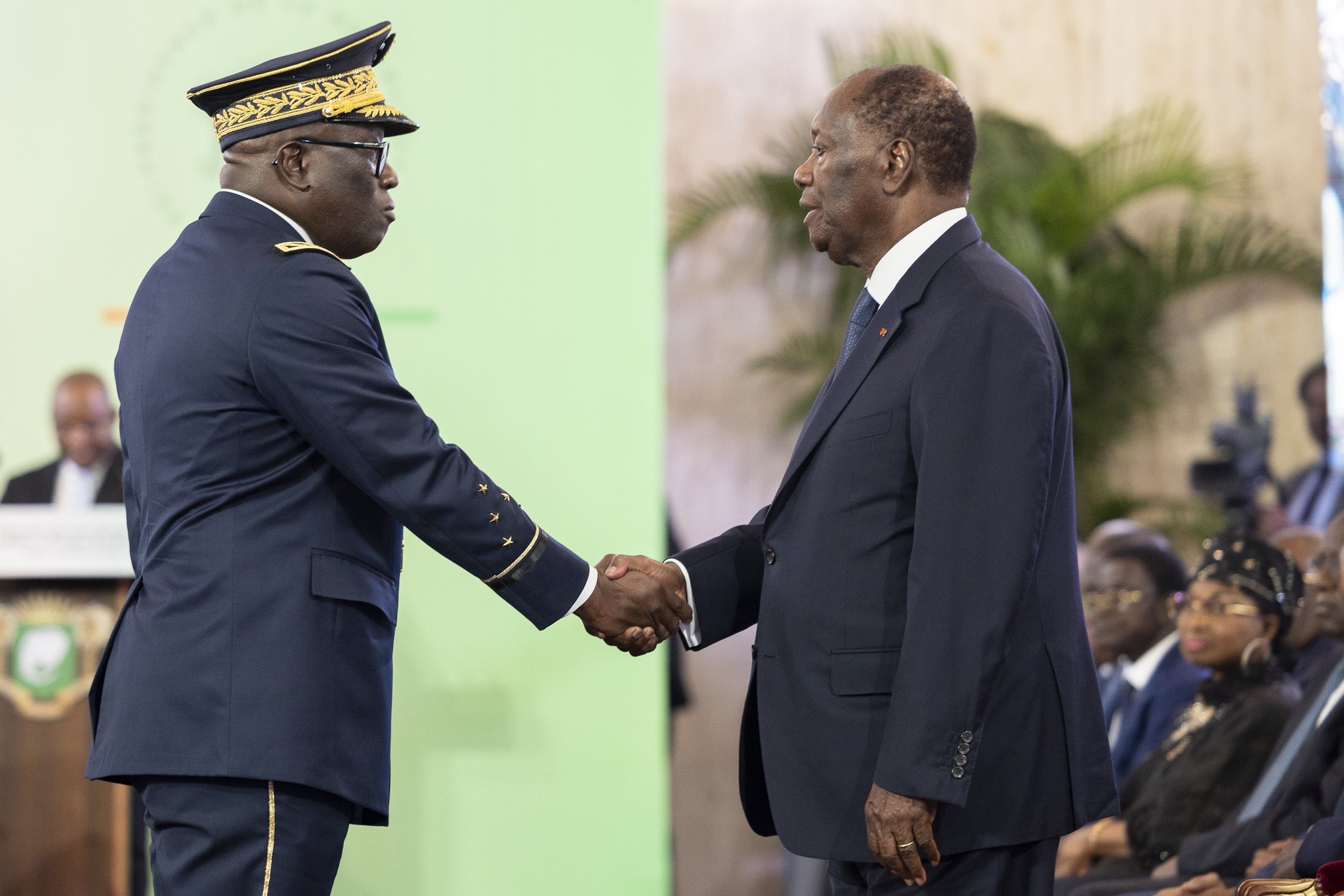
Commentaires Facebook