
Au Royaume-Uni, le scandale créé par les agissements du groupe de M. Rupert Murdoch a révélé les liens délétères entre journalisme, police et politique. Aux Etats-Unis, où le milliardaire possède de nombreuses chaînes de télévision, le rôle du complexe médiatico-financier dans la vie institutionnelle s’est encore accru depuis un arrêt de la Cour suprême qui déplafonne les investissements des entreprises dans les campagnes électorales.
par Robert W. McChesney et John Nichols lu dans le monde-diplomatique.fr
Deux semaines avant les élections de mi-mandat de novembre 2010, tel le magicien d’Oz s’exclamant : « Ne faites pas attention à l’homme derrière le rideau », M. Karl Rove, ancien stratège de M. George W. Bush à la Maison Blanche et lobbyiste, tentait de dissimuler l’essentiel. Tandis que le président Barack Obama venait d’accuser les consultants républicains de dénaturer le scrutin en récoltant pour leurs candidats des centaines de millions de dollars auprès des multinationales et des milliardaires conservateurs, l’ex-conseiller déclara aux journalistes : « Obama est complètement à côté de la plaque lorsqu’il parle de manière obsessionnelle de la chambre de commerce, d’Ed Gillespie (1) et de moi-même. Le président a déjà gaspillé une des quatre dernières semaines de la campagne électorale à ne parler que de cette broutille (2). »
Cette « broutille » représente en fait l’élément crucial de l’élection de mi-mandat la plus coûteuse de l’histoire américaine, élection qui s’est traduite par un spectaculaire coup de barre à droite (3) : la captation de la vie politique par une caste financière et médiatique plus puissante que n’importe quel parti ou candidat. Il ne s’agit pas seulement d’un nouveau chapitre dans l’interminable romance entre argent et pouvoir, mais d’une redéfinition de la politique elle-même par la conjonction de deux facteurs : le déplafonnement des donations électorales versées par les entreprises et le renoncement de la presse à examiner les dessous des campagnes.
Il en résulte un système dans lequel un petit cercle de conseillers mobilise des sommes folles pour orienter le vote au profit de ses clients. Ce « complexe électoral argent-médias » constitue à présent une force presque imbattable, soustraite à toute forme de régulation, délivrée de toute obligation de prudence par une presse qui a capitulé, et relayée sans relâche par des chaînes de télévision commerciales qui ont, en 2010, encaissé 3 milliards de dollars grâce aux publicités politiques. L’année dernière, sur les cinquante-trois circonscriptions où M. Rove et les siens ont arrosé les candidats républicains à la Chambre des représentants de financements « indépendants » bien supérieurs à ceux dont bénéficiaient leurs rivaux démocrates, les conservateurs en ont gagné cinquante et une. Environ trois quarts des républicains élus à la Chambre cette année-là — pour certains parfaitement inconnus avant que les dollars ne les fassent surgir de terre — sont issus des circonscriptions où l’argent de la chambre de commerce ou de l’American Crossroads, le club de M. Rove, coulait à flots.
Un dollar, une voix
Le pouvoir politique de l’argent se renforce à mesure que s’effondre la résistance naguère opposée par un journalisme indépendant et critique. Autrefois, le tempo d’une campagne électorale était donné par une presse qui tentait, avec plus ou moins de succès, d’éclairer le jugement des électeurs. A présent, ce sont les annonces publicitaires qui battent la mesure. Si les chaînes de télévision jouent toujours les chefs d’orchestre, la partition qu’elles interprètent est payée et composée par les élites économiques, qui cherchent non plus seulement à orienter le résultat du scrutin, mais à modeler le visage et la politique du gouvernement lui-même. Négliger la coagulation de l’argent et des médias ou, pis, imaginer que les forces progressistes pourraient l’emporter sur elle, risque d’amplifier lors de l’élection présidentielle de 2012 les phénomènes à l’œuvre dans le scrutin de mi-mandat.
L’arrêt rendu le 21 janvier 2010 par la Cour suprême dans l’affaire opposant l’association conservatrice Citizens United à la Commission électorale fédérale (Federal Election Commission, FEC) a joué un rôle essentiel. En donnant gain de cause aux conservateurs, qui revendiquaient le droit de diffuser un film contre Mme Hillary Clinton au prétexte de la « liberté d’expression », les juges — à cinq voix contre quatre — ont balayé un siècle d’une régulation qui empêchait jusque-là les grands groupes privés d’user de toutes leurs ressources pour peser dans la balance. Les personnes morales (associations, syndicats, entreprises privées, etc.) bénéficient désormais du même droit que les personnes physiques à faire valoir leurs opinions ; elles peuvent mobiliser les moyens qu’elles désirent pour produire et diffuser des films et publicités à caractère politique.
La décision de la Cour suprême provoque aussitôt des réactions nombreuses et souvent vives. M. Obama y voit « une grande victoire pour les multinationales du pétrole, les banques de Wall Street, les compagnies d’assurance-maladie privées et tous les autres groupes d’intérêts privés qui, chaque jour, mobilisent leurs forces à Washington pour noyer la parole du peuple américain (4) ». Selon le fondateur du National Voting Rights Institute, M. John Bonifaz, la possibilité donnée aux multinationales d’user sans limites de leur trésorerie générale pour diffuser leurs opinions politiques va faire d’elles les « propriétaires effectifs de notre démocratie ».
Les milieux d’affaires ne tardent pas, en effet, à profiter de l’aubaine. « Les premiers secteurs à investir le terrain de jeu électoral sont l’industrie des services financiers, l’industrie énergétique et l’industrie des assurances privées (5) », reconnaît M. Scott Reed, le vétéran des consultants républicains. Son club de lobbying, la Commission on Hope, Growth and Opportunity, dépense des dizaines de millions de dollars pour acheter des spots télévisés hostiles aux parlementaires démocrates dans les Etats-clés. Selon l’association Media Matters Action Network, le trésor de guerre d’un Reed ne représente cependant que des « cacahuètes » au regard du total des financements privés : en octobre 2010, un mois avant le raz de marée électoral républicain, plus de soixante groupes de lobbying avaient déjà déboursé 4 milliards de dollars pour diffuser cent cinquante mille annonces publicitaires et assurer l’envoi aux électeurs d’un nombre incalculable de courriels de propagande. Cette débauche de moyens surpasse les frais de campagne occasionnés par l’élection de 2004, au cours de laquelle, en sus des consultations législatives habituelles (Chambre des représentants et Sénat), se déroulait un scrutin présidentiel.
De leur côté, les démocrates vont s’empresser d’entrer dans la course et de lever un maximum de fonds auprès des multinationales. Mais le jeu est trop inégal. « En 2010, estime le Center for Media and Democracy, qui étudie les liens de collusion entre le monde des affaires et le milieu politique, les contributions versées par les groupes d’intérêts étaient au moins cinq fois supérieures à celles du scrutin précédent, et les groupes prorépublicains ont réuni sept fois plus de fonds que leurs concurrents prodémocrates. »
D’une certaine manière, toute cette histoire est aussi ancienne que la nation américaine elle-même. « Ceux qui possèdent le pays doivent aussi le gouverner (6) », professait il y a plus de deux siècles John Jay, l’un des Pères fondateurs de la Constitution. Le combat pour bâtir un système politique fondé sur le principe « une personne, une voix » — et non « un dollar, une voix » — parcourt l’histoire des Etats-Unis. « Dans ce pays, nous pouvons avoir soit la démocratie, soit une immense richesse concentrée dans les mains d’une infime minorité, mais nous ne pouvons pas avoir l’une et l’autre », observait avant la seconde guerre mondiale le juge de la Cour suprême Louis Brandeis.
Démocratie ou ploutocratie, tel est le choix. Le complexe argent-médias installe un paysage électoral plus verrouillé que tout ce que les Américains ont connu depuis la fin du XIXe siècle (7). Les experts ont déjà diagnostiqué un « reflux de l’enthousiasme » lors des élections de 2010. Quoi d’étonnant ? Les citoyens ont compris que leurs modestes donations personnelles, et même leurs bulletins de vote, ne pèsent pas lourd face à une avalanche de 4 milliards de dollars. Mais ceux qui tirent les ficelles de ce système profitent du cynisme et de l’apathie des électeurs : plus vite on tournera la page sur la participation record des jeunes aux élections de 2008 — 51 % des moins de 30 ans se sont rendus aux urnes (contre 40 % en 2000) —, mieux ils se porteront, car rien ne leur bénéficie davantage qu’un dépérissement de la vie civique, propice à leur opération de mainmise sur l’Etat.
Les candidats qui refusent de se soumettre au nouveau complexe électoral médiatico-financier prennent le risque de la défaite. C’est sans surprise que les prétendants les plus intègres ou les plus ouvertement hostiles à la corruption ont été battus aux scrutins de novembre 2010, comme le sénateur du Wisconsin Russel Feingold, figure de l’aile progressiste du Parti démocrate, pionnier des lois de réglementation des dépenses électorales, ou le représentant du Delaware Michael Castle, un modéré du Parti républicain éliminé au cours des primaires par l’égérie du Tea Party Christine O’Donnell. Et cela ne devrait pas s’arranger l’année prochaine : « Nous avons planté notre drapeau, et nous sommes certains de jouer un rôle majeur en 2012 (8) », claironne M. Robert Duncan, le président d’American Crossroads.
Les multinationales et leurs consultants disposent d’une alliée décisive : l’industrie de la télévision. L’an passé, celle-ci a connu la saison électorale la plus juteuse de son histoire grâce à sa nouvelle vache à lait : la publicité politique. Les deux tiers environ des sommes englouties dans la campagne de 2010 ont en effet atterri dans ses caisses. Dans les années 1990, les spots politiques représentaient 3 % des revenus publicitaires d’une chaîne commerciale ; aujourd’hui, cette proportion atteint 20 %. Et les régies s’en donnent à cœur joie : selon le Los Angeles Times, le tarif local d’un spot de trente secondes est passé de 2 000 dollars en 2008 à 5 000 dollars en 2010.
Permis de mentir
Toutes les chaînes commerciales bénéficient pourtant d’une concession gratuite, offerte par l’Etat contre la promesse de « servir l’intérêt public » — par exemple en éclairant les choix des électeurs. Or la couverture télévisuelle des campagnes électorales n’a cessé de se dégrader au cours des trente dernières années. Selon le centre d’études Norman Lear, de l’université de Californie du Sud, trente minutes de programmes télévisés en période électorale contiennent plus de publicités politiques que d’informations politiques (9). « Informations » étant d’ailleurs un bien grand mot, puisque les journalistes se contentent de plus en plus souvent de commenter les messages publicitaires des candidats…
Loin d’être propre à la télévision commerciale, le déclin du journalisme politique touche aussi la presse écrite. Les médias indépendants agonisent (10) ; les journaux ferment boutique les uns après les autres, envoyant pointer au chômage des dizaines de milliers de reporters et d’employés de presse — un tiers des journalistes professionnels américains ont été licenciés au cours des dix dernières années, dont onze mille depuis seulement trois ans (11). Les titres qui survivent encore n’ont plus les moyens d’entretenir un réseau de correspondants à travers le pays, ni même parfois de maintenir un bureau à Washington. Les nouveaux sites d’information sur Internet fournissent certes un travail estimable, mais qui ne suffit pas à combler le vide, faute notamment d’un modèle économique permettant de lancer des enquêtes sérieuses.
Les bouleversements qui affectent le financement et le traitement médiatique des campagnes électorales ont un effet redoutable sur la politique américaine en général. Si de nombreuses théories circulent pour expliquer la débâcle du camp progressiste aux scrutins de 2010, toutes sous-estiment curieusement le rôle joué par la coagulation de l’argent et des médias dans le jeu électoral.
Elucider le fonctionnement de ce système n’en demeure pas moins essentiel, à moins de partager l’idée que les démocrates pourraient rebondir s’ils dénichaient des donateurs aussi généreux que les milliardaires amis de M. Rove. Mais ils ne réussiraient à rallier le complexe médiatico-financier à leur cause qu’au prix de leur âme : un projet véritablement progressiste n’a en effet aucune chance de gagner la course aux dollars (lire « M. Barack Obama déçoit Wall Street »).
M. Rove, M. Reed et leurs affidés — dont le chef de la minorité républicaine au Sénat, M. Mitch McConnell, et son homologue président de la Chambre des représentants, M. John Boehner — vont répétant que l’argent profite à la démocratie et que la publicité « éduque le public ». Ces trouvailles orwelliennes reprennent l’idée qui a présidé à une longue série d’arrêts conservateurs de la Cour suprême, depuis l’affaire Buckley contre Valeo en 1976 (12) jusqu’à la décision de janvier 2010 : aux Etats-Unis, consacrer son argent à des fins politiques est une forme de la liberté d’expression (« Money is speech »).
Le conseil donné aux candidats ne varie pas : levez des fonds et encore des fonds, ne faites et ne dites rien qui risque de refroidir les donateurs potentiels. Cette manière de voir a imprégné ce qui reste de la presse, de sorte qu’elle préfère parler de l’argent récolté par les candidats, leurs partis et leurs groupes d’intérêts — qui est en tête, qui est derrière ? — plutôt que de décortiquer le bilan et le programme des élus et des prétendants. La réclame étant désormais la première source d’information politique, le débat public s’appuie, dans le meilleur des cas, sur des demi-vérités isolées de leur contexte.
Dans un spot favorable à Mme Sharron Angle, candidate républicaine dans le Nevada, une femme accuse le sénateur sortant, M. Harry Reid, d’avoir « approuvé l’utilisation des impôts des citoyens pour financer le Viagra, les personnes qui battent leurs enfants et les agresseurs sexuels ». Dans une publicité « approuvée » par M. David Vitter, candidat républicain au poste de sénateur de Louisiane, le sortant démocrate, M. Charles Melancon, fut quant à lui accusé de favoriser l’immigration illégale et d’empêcher la police d’arrêter les clandestins. Les images renforcent alors le propos : le grillage qui fait office de frontière entre les Etats-Unis et le Mexique est percé. Au-dessus du trou, un écriteau lumineux clignote : « Entrez ici ». Des Mexicains se faufilent et, parvenus sur le sol américain, sont accueillis par une fanfare et des feux d’artifice ; des partisans de M. Melancon leur tendent un immense chèque, à l’ordre de « tous les étrangers clandestins » et d’un montant équivalant à celui d’« une grande partie des impôts des contribuables ». La Louisiane n’a pas de frontière commune avec le Mexique…
Les spots électoraux ont le droit de mentir ouvertement, contrairement aux annonces commerciales. Il y a trente ans, M. Robert Spero, alors directeur de l’agence de communication Ogilvy & Mather, justifiait cette exception en invoquant qu’obliger les candidats à répondre aux mêmes critères que les vendeurs de lessive condamnerait les publicités électorales à être jugées frauduleuses par la Commission fédérale du commerce…
Refuser les « débats » télévisés
Ayant acheté leur accès au public, plusieurs candidats ont même, lors de la campagne de novembre dernier, décidé de se soustraire aux sollicitations de la presse, telle Mme Angle, ou de refuser un face-à-face avec leur concurrent. Il fut un temps où les prétendants faisaient des pieds et des mains pour débattre avec le sortant dont ils briguaient le siège. Dorénavant, des sortants comme M. Alan Grayson, représentant de la Floride, doivent courir après leurs concurrents richement dotés. Quand M. Feingold a proposé une série de débats publics à son rival républicain, le millionnaire Ron Johnson, celui-ci, pourtant inconnu du public et dépourvu de toute expérience politique, a d’abord dédaigné l’invitation — tout comme il décline les demandes d’entretien.
M. Johnson a en effet jugé plus prudent de laisser la chambre de commerce, l’American Action Network et d’autres organisations dorées sur tranche parler à sa place, en submergeant les électeurs de publicités hostiles au sénateur Feingold. Lorsqu’il a enfin accepté de participer à un forum conçu pour les heures de grande écoute de la télévision, plusieurs chaînes locales ont refusé de diffuser la rencontre en direct. M. Ed Garvey, ancien candidat malheureux au poste de gouverneur du Wisconsin, racontera avoir zappé sur le câble dans l’espoir de tomber sur le débat tant attendu. Ayant fait chou blanc, il a appelé une chaîne locale, qui lui a conseillé de chercher sur Internet. « En tant que citoyen, conclut-il, je n’avais d’autre choix que de visionner les publicités. La télévision ne nous a apporté aucune information digne de ce nom. Je croyais qu’elle devait servir l’intérêt public. »
Cet exemple parmi d’autres indique ce qui devrait constituer le point de départ d’une offensive contre le complexe argent-médias : pointer la responsabilité des grands moyens de communication et de leurs actionnaires. La liberté de la presse étant inscrite dans la Constitution, il appartient aux agences de régulation de veiller à la sauvegarde des intérêts du public (lire « Des propositions trop radicales ? »). La Commission fédérale des communications (Federal Communications Commission, FCC) et la FEC doivent établir combien d’argent a été dépensé, par qui et à quelle fin, et déterminer si les chaînes de télévision, qui amassent des fortunes en diffusant des réclames électorales, répondent aux critères d’intérêt public auxquels sont (théoriquement) astreints leurs propriétaires.
Si les commissions d’enquête du Sénat et de la Chambre des représentants soumettaient le complexe électoral argent-médias à des auditions publiques, M. Peter DeFazio, représentant démocrate, aurait sans doute beaucoup à dire. Ce franc-tireur de l’Oregon fut la cible en 2010 d’une campagne publicitaire haineuse orchestrée par un adversaire obscur et par un groupe de pression dont personne n’avait entendu parler. Il contre-attaqua en conviant une équipe de tournage à visiter la luxueuse résidence de Washington où ce groupe était domicilié. On apprit alors que le commanditaire de la campagne n’était autre qu’une société d’investissements spécialisée dans les fonds spéculatifs : elle n’avait pas apprécié que le parlementaire démocrate ait réclamé des comptes à Wall Street.
Robert W. McChesney et John Nichols
Respectivement journaliste et professeur en communication à l’université de l’Illinois d’Urbana-Champaign.
Une version de cet article a été publiée par l’hebdomadaire américain The Nation (New York), le 29 novembre 2010.




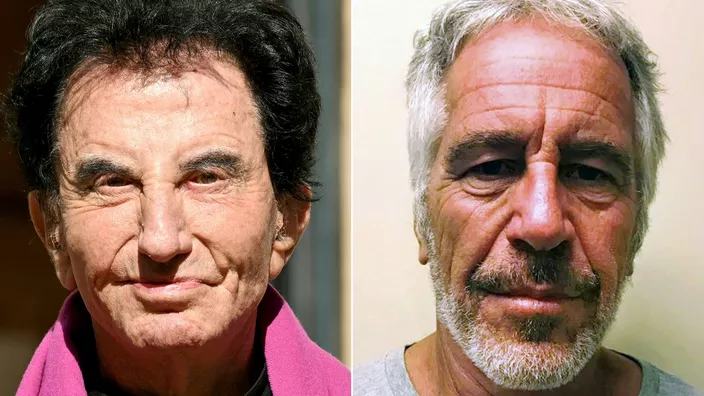

Commentaires Facebook