Jeune-Afrique par Francis Kpatindé
C’était il y a tout juste 10 ans. Un « kadogo » du nom de Rachidi, un simple soldat, se dirige vers Laurent-Désiré Kabila, dégaine et tire. Revivez la mort du « Mzee » dans un article de Francis Kpatindé, publié dans Jeune Afrique l’intelligent n° 2089, du 23 au 29 janvier 2001.
Mardi 16 janvier, aux environs de 13 heures. Laurent-Désiré Kabila travaille dans son bureau, au palais de Marbre, situé dans le quartier huppé de Binza, sur les hauteurs de Kinshasa. Dans la matinée, le président congolais a accordé quelques audiences. « La routine », assure un collaborateur. Des hommes d’affaires, quelques politiciens. Rien de plus. À l’heure du déjeuner, il reçoit son conseiller économique, Mota, qui doit normalement l’accompagner le lendemain à Yaoundé, où le président prévoit de retrouver ses pairs africains et français pour le XXIe sommet Afrique-France.
Parvenu au pouvoir en mai 1997, après avoir délogé le maréchal Mobutu, Kabila a travaillé, dans un premier temps, au palais de la Nation, à proximité du fleuve qui sert de frontière naturelle entre l’ex-Zaïre et le Congo-Brazzaville. Puis, craignant de faire les frais d’un éventuel obus tiré à partir de l’autre rive, l’ancien maquisard a déménagé à la Cité de l’OUA. Mais, obligé de traverser tous les jours, lors de ses déplacements, une caserne (le camp Tshashi, naguère réputé pour avoir abrité la garde prétorienne de Mobutu), il choisira finalement de s’installer au palais de Marbre, l’ancienne résidence des hôtes de marque, où, pensait-il, sa sécurité serait mieux assurée.
Panique générale
Rien d’anormal donc, en ce mardi 16 janvier. Devant la porte du bureau présidentiel, quelques militaires devisent tranquillement avec un fonctionnaire du protocole. Peu avant 14 heures, un jeune soldat de la garde – selon nos informations, un caporal du nom de Rachidi – arrive et demande à aller « présenter ses civilités » au président. En d’autres termes, il veut aller saluer Kabila. Ailleurs, pareille chose est peut-être impensable. Ici, comme dans beaucoup d’autres pays africains, n’importe quel quidam peut pénétrer dans le bureau présidentiel, pour peu qu’il compte des amis ou des parents au sein de la garde ou du protocole. « C’était un vrai foutoir autour de Kabila, raconte ainsi Jean-Claude Vuemba, qui préside le Mouvement du peuple congolais, un parti d’opposition. On y entre et on en sort comme on veut. Les conseillers, les ministres, voire de simples plantons, entrent à leur guise, interrompent de manière tonitruante les audiences pour faire parapher des documents, pour annoncer un autre visiteur ou, simplement, pour saluer le maître des lieux. »
Les soldats de faction devant le bureau présidentiel laissent donc Rachidi, un kadogo, un simple soldat de base, pénétrer dans le saint des saints. Il se dirige calmement vers Kabila, en pleine conversation avec son conseiller, dégaine son arme et lui tire dessus. Le chef de l’État s’écroule, atteint au cou et au bas-ventre. Mota se met à hurler pour rameuter la garde. L’aide de camp (qui est, en même temps, le chef d’état-major particulier du président), le colonel Eddy Kapend, un « Katangais » formé en Angola, et quelques soldats font irruption dans le bureau. Ils découvrent le président allongé par terre, « en plein délire » et se vidant de son sang. À ses côtés, accroupi, le conseiller économique essaie de le soulager par un massage. Le caporal Rachidi tente de s’enfuir. Il est aussitôt abattu par la garde. Selon une indiscrétion, ce jeune soldat semble avoir mal vécu l’exécution pour « indiscipline », quelques jours plus tôt, d’un de ses meilleurs amis, kadogo comme lui. « C’est un soldat originaire du Kivu [flanc oriental du pays occupé par les troupes rwandaises et ougandaises] qui a tiré sur le président », explique pour sa part au téléphone le ministre de la Communication, Dominique Sakombi, en affirmant tout ignorer de la personnalité et des motivations de l’auteur de l’attentat.
Les militaires bouclent aussitôt le périmètre autour du palais de Marbre. Dans une atmosphère de panique générale, ils font venir un hélicoptère de l’aéroport de Ndjili pour transporter le blessé à la clinique Ngaliema (ex-clinique Reine-Elisabeth), située dans le quartier résidentiel de la Combe, où les médecins lui prodiguent les premiers soins. Pendant ce temps, au palais, les politiques essaient de reprendre la situation en main. Arrivé au pouvoir par les armes, Laurent-Désiré Kabila avait été investi président en vertu d’un simple décret-loi pris pour les besoins de la cause et qui ne prévoyait pas – on comprendra aisément pourquoi – de vacance du pouvoir exécutif. En présence de ce vide juridique, Gaëtan Kakudji, le ministre d’État chargé des Affaires intérieures, prend les opérations en main. Dans l’ordre protocolaire, ce cousin et proche parmi les proches de Kabila est, en effet, le numéro deux du régime.
« Nous sommes en guerre »
Il organise donc, selon nos informations, une « réunion de crise» à laquelle prendront part le colonel Eddy Kapend, le ministre d’État Pierre Victor Mpoyo (l’homme de Luanda auprès de Kabila), l’ambassadeur angolais en République démocratique du Congo (ROC), ainsi que les chefs des détachements militaires angolais et zimbabwéens. « Le président est en train de mourir et nous sommes en guerre, explique d’emblée Kakudji à l’assemblée. Il sera difficile, dans ces conditions, à un civil de faire face à la situation et de maintenir la continuité de l’État. »
Le représentant de l’Angola suggère alors au colonel Eddy Kapend de « prendre ses responsabilités ». L’intéressé décline l’offre, craignant, semble-t-il, de passer aux yeux de l’opinion, dans la confusion ambiante, pour l’inspirateur du régicide. Tout au plus consent-il à aller, après la réunion, lancer un appel au calme à la télévision et à la radio. Il s’y rendra d’ailleurs, encadré par des soldats angolais, pour annoncer la fermeture des frontières terrestres et de l’aéroport de Kinshasa, l’instauration d’un couvre-feu et la mise en état d’alerte des forces armées.
Après la renonciation de Kakudji et le « niet » du colonel Kapend, un des participants à la réunion de crise évoque alors, comme possible « président intérimaire », le général Denis Kalume Numbi, ministre du Plan et de la Reconstruction nationale. Mais, après une longue discussion, Pierre Victor Mpoyo sortira de son chapeau le nom du général-major Joseph Kabila, resté, lui, aux côtés de son père à la clinique Ngaliema. Outre qu’il porte le même patronyme que ce dernier, il présente l’avantage d’être un militaire et d’incarner une certaine continuité.
Mince, fine moustache, plutôt beau gosse, timide, l’aîné des Kabila a, selon les sources, entre 29 et 32 ans. Sa maman est une Tutsie rwandaise, qui a vécu avec Laurent-Désiré Kabila en Tanzanie et en Ouganda. Elle y vivrait toujours avec deux de ses filles. Kabila Junior serait même le demi-frère (du côté de sa mère) du général James Kabare, chef d’état-major adjoint des… Forces armées rwandaises, les FAR. Et il serait très proche de Deogratias Bugera, ancien secrétaire général de l’Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo (AFDL, opposition armée à Mobutu) et ex-ministre d’État de Kabila, qui a, depuis, fait dissidence et rejoint la rébellion.
Kabila fils n’est pas vraiment un officier, du moins au sens classique de la fonction. Par la volonté de son père, qui l’a récupéré peu avant le début de la marche triomphale sur Kinshasa de l’AFDL, en 1996, il a commencé sa carrière comme « commandant ». Envoyé par la suite en formation en Chine, il a été bombardé, à son retour, général, nommé chef d’état-major adjoint des Forces armées congolaises (FAC), puis, devant la multiplication des mouvements de rébellion armée, responsable des forces terrestres. Petit détail qui a son importance, il ne parle ni le lingala, la langue la plus utilisée à Kinshasa, ni vraiment bien le français, et s’exprime de préférence en anglais, en kinyarwanda et en kiswahili. « Si l’on tient compte de nos traditions matrilinéaires, il est tutsi », relève un ancien mobutiste.
« Sa mort est sûre à 101 % »
En cet après-midi du 16 janvier, les nouvelles qui parviennent de la clinique Ngaliema sont contradictoires. Selon la rumeur, qui court les rues désertées de la capitale, le président serait mort, de même que son fils, le général-major Joseph Kabila, qui tentait de le protéger. De Tripoli, où il est en visite officielle, le ministre délégué à la Défense, Godfroid Tchamlesso, croit même savoir que Kabila serait mort « deux heures après avoir été blessé par l’un de ses gardes du corps ». Il ne fournit pas pour autant de détails sur les circonstances du drame. Pour sa part, le ministre de la Communication, Dominique Sakombi, indique qu’il a été blessé mais reste en vie. Son collègue, le ministre d’État Gaëtan Kakudji, y va de son couplet en affirmant, sans rire, sur les ondes que c’est Kabila lui-même qui, peu après l’agression, a décrété le couvre-feu et mis les troupes en état d’alerte.
La première indication sérieuse de la « mort » du Mzee (le « Vieux ») congolais viendra d’une capitale ennemie, plus précisément de Kampala.
Les services secrets de Museveni, l’ancien parrain de Kabila, annoncent aux agences de presse, dans l’après-midi même du mardi 16 janvier, sa mort « sûre à 101 % ». Les Ougandais prennent ainsi de vitesse le ministre belge des Affaires étrangères, Louis Michel, qui confirmera plus tard, dans la soirée, la disparition du président congolais. « Il est mort, abattu par l’un de ses gardes qui, semble-t-il, a tiré deux balles en présence de généraux que le président venait de limoger. » Bruxelles, on le sait, est généralement bien informé des affaires de son ancienne colonie, jadis considérée comme une propriété personnelle du roi des Belges. Le département d’État américain, ajoutant à la confusion, ne confirme pas le décès, du moins dans un premier temps, tout en le tenant « pour probable ».
Évacué vers un « pays voisin »
Kinshasa, de son côté, persiste et signe. Le président est blessé mais bel et bien vivant. Le lendemain du drame, Sakombi admettra néanmoins qu’il a été évacué, avec plusieurs membres de sa famille, dans la nuit du 16 au 17 janvier, vers « un pays voisin », en fait le Zimbabwe, qui entretient un important corps expéditionnaire en RDC. Il annonce, dans la foulée, la réunion d’un Conseil « extraordinaire » des ministres à la Cité de l’OUA, pour confirmer dans ses nouvelles fonctions le général-major Joseph Kabila. Ce dernier devient le coordonnateur de l’action gouvernementale et le patron du haut commandement de l’armée, autrement dit le président par intérim. L’annonce de cet ensemble de mesures contribue à accentuer le malaise.
L’ambassadeur de RDC à Harare, Kikaya Bin Karubi, interviendra à la télévision pour « confirmer » que Kabila était effectivement soigné à la base aérienne de Manyame, située près de l’aéroport de Harare, où il était arrivé à bord de l’avion présidentiel congolais avec une partie de sa famille : « Il se trouve dans un état critique, mais n’est pas encore décédé. » Apprenant la nouvelle, le président zimbabwéen, Robert Mugabe, quitte précipitamment le sommet Afrique-France de Yaoundé et rentre au pays. Pendant ce temps, les Kinois semblent avoir définitivement refermé la parenthèse Kabila Ier, qu’ils surnomment déjà, dans les quartiers, le « mort-vivant» ou « le président-fantôme ».
À Yaoundé, surprise ! Dans la matinée du jeudi 18 janvier, et sans attendre le feu vert de Kinshasa, le président togolais Gnassingbé Eyadéma demande une minute de silence à la mémoire de son « frère et ami Kabila ». Comme un seul bloc, toutes les délégations se lèvent, y compris celle de la RDC. La confirmation officielle, tant attendue, interviendra quelques heures plus tard par la voix de l’inénarrable Sakombi, ex-chantre du mobutisme rallié à Kabila : « Le Congo est en deuil, dira-t-il d’une voix solennelle, et le Gouvernement de salut public a la profonde douleur et le douloureux devoir d’annoncer la mort du président Laurent-Désiré Kabila, ce jeudi 18 janvier à 10 heures. » Il annonce trente jours de deuil national.
Des funérailles grandioses devaient se tenir à Kinshasa, ce 23 janvier. Les Congolais ont perdu Kabila Ier. Tout indique qu’ils ne sont pas pour autant sortis de l’ornière …






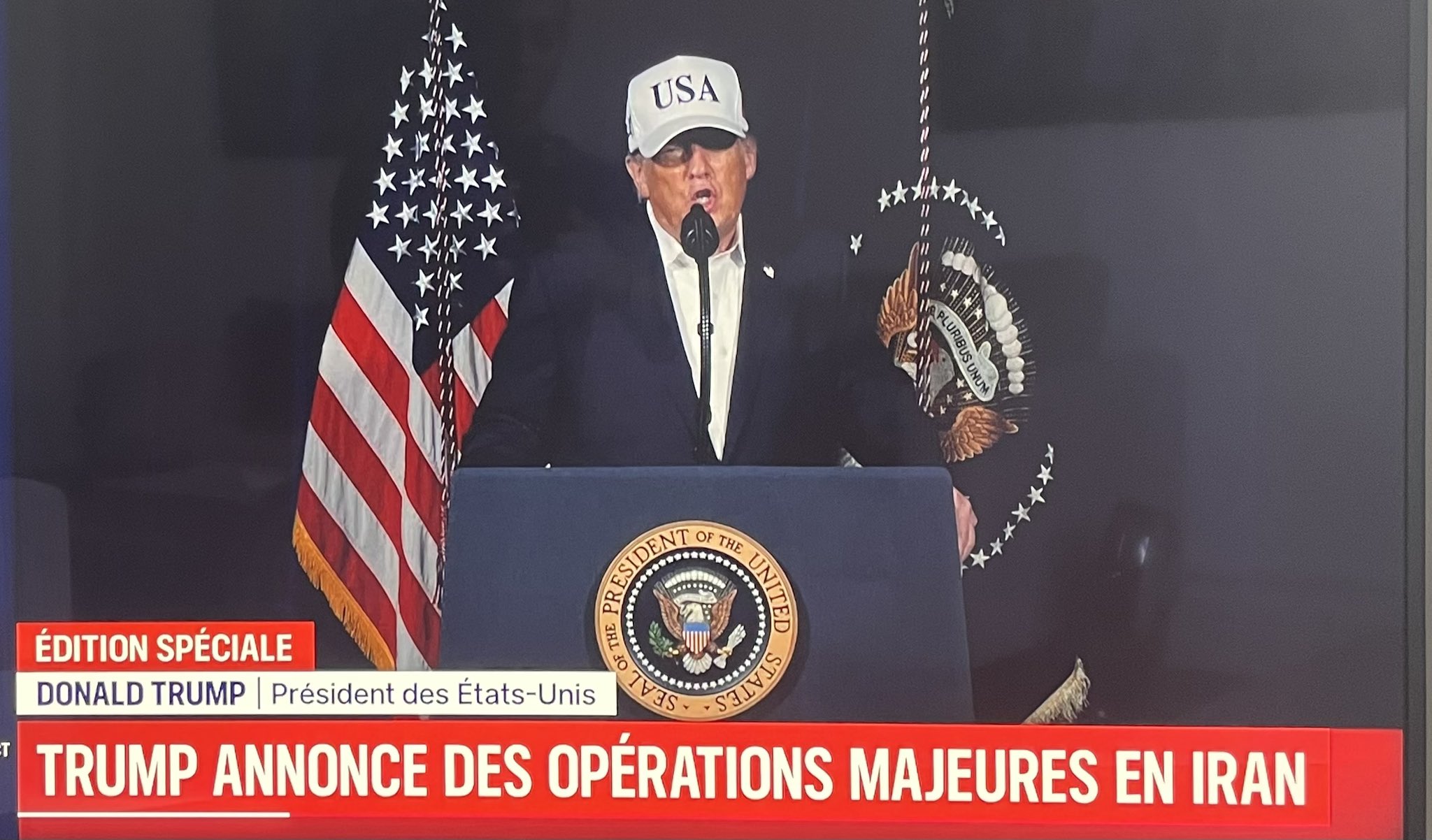
Les commentaires sont fermés.