Par Jean-pierre BEJOT – La Dépêche Diplomatique
La question mérite d’être posée. Elle semblera abracadabrante à ceux qui me lisent régulièrement et, plus encore, à ceux qui ne cessent de dénoncer ma « proximité » avec le Burkina Faso.
Mais entre un deuxième tour de la présidentielle guinéenne et un deuxième tour de la présidentielle ivoirienne, l’un et l’autre porteurs de tous les dangers (et de bien des surprises : Alpha Condé vainqueur en Guinée et Alassane Ouattara qualifié pour le second tour en Côte d’Ivoire), le déroulement sans heurt, mais aussi sans éclat, de la présidentielle burkinabé (21 novembre 2010) et la quasi certitude de tous les commentateurs que Blaise Compaoré sera reconduit à la présidence du Faso, pourrait laisser penser que la démocratie, au Burkina Faso, a été « confisquée » par le pouvoir.
Près de 15 millions d’habitants (la diaspora ne vote pas) ; 3.239.774 d’inscrits sur les listes électorales ; en gros, 50 % d’électeurs se seraient rendus aux urnes et environ 85 % des voix seraient pour Compaoré. Le calcul est simple : Compaoré serait réélu par moins de 10 % de la population burkinabè. Mais, pour autant, l’opposition a joué le jeu ; et si quelques têtes d’affiche n’ont pas souhaité participer à la « confrontation », des personnalités non négligeables (cf. LDD Burkina Faso 0235 à 0237/Mardi 5 à Jeudi 7 octobre 2010) ont eu le courage de s’engager dans une campagne électorale nécessairement coûteuse. Par ailleurs, la présidentielle s’est, pour l’essentiel, déroulée sans entraves ; et la population ne défile pas dans les rues pour dénoncer une « mascarade » électorale même si la majorité des Burkinabè (enfin, plus exactement, la majorité des Burkinabè des centres urbains) pense que c’était une élection sans enjeu. D’abord, parce que la victoire de Compaoré était annoncée ; ensuite parce qu’il n’y a pas grand monde pour contester le bilan de l’équipe en place et penser que les « autres » pourraient faire mieux.
Quand on constate la violence qui règne ailleurs, en Guinée et en Côte d’Ivoire, la nécessité de l’irruption de l’armée dans le jeu politique au Niger, les tensions souvent exacerbées entre l’opposition et le pouvoir au Sénégal, au Bénin, au Togo…, on ne peut que se réjouir que tout aille bien au Burkina Faso ; enfin, que tout semble aller bien puisque le chef de l’Etat est réélu sans contestation et que la population n’a pas organisé de manifestations de grande ampleur (ce que les Burkinabè savent très bien faire).
On peut s’étonner, bien sûr, que dans un pays qui, depuis la « rectification » de la « révolution » s’est donné les moyens de se structurer en « démocratie », l’alternance politique ne soit jamais à l’ordre du jour. Est-ce à dire que la démocratie burkinabè est un leurre et que les institutions mises en place ne sont que des cadres vides. Je ne le pense pas. Dans ce pays, je ne cesse de le dire parce que je ne cesse de le constater, la présidence préside, le gouvernement gouverne, l’administration administre, les entrepreneurs entreprennent, les étudiants étudient, etc. Sans oublier que la presse n’est pas incompétente, loin de là, ni même inactive ; que les syndicats savent jusqu’où ils peuvent aller ; que les Burkinabè ne sont pas dépourvus de conscience politique et sociale et que les partis politiques d’opposition savent, tout à la fois, ce qu’est un parti et ce que c’est que l’opposition.
Mais, vu de l’extérieur comme de l’intérieur, un président au pouvoir depuis… 1987, cela fait non pas désordre mais un peu trop « ordre stalinien » ou « totalitaire ». C’est sans doute là que le bât blesse : au Burkina Faso, l’homme a tué la fonction présidentielle ; ce n’est plus un job politique, c’est une activité tutélaire. Blaise Compaoré n’est pas perçu comme le président de la République mais comme le « protecteur » du Burkina Faso. Plus présent sur le terrain politique et pourtant moins omniprésent que les autres chefs d’Etat d’Afrique noire francophone, il a su faire évoluer la fonction de Premier ministre, chef du gouvernement, rendre l’administration plus performante qu’elle n’avait vocation à l’être, l’armée plus républicaine qu’elle ne l’avait été par le passé, etc. Ce n’est pas que tout baigne, loin de là, mais le bilan est visible et les performances sont mesurables. C’est le point faible de l’opposition : elle a une vision trop classique de sa fonction ; Compaoré est inattaquable pour ce qui est de l’histoire du dernier quart de siècle ; enfin, inattaquable compte tenu des résultats qui sont ceux du Burkina Faso aujourd’hui. Un pays totalement métamorphosé dans une sous-région où tout a implosé et où, justement, c’est Ouaga qui s’efforce (non sans mérite mais pas sans arrière-pensée non plus) de recoller les morceaux.
On peut considérer que le système fonctionne dès lors que la population s’en accommode. Sauf que, pour une grande majorité d’entre elle, elle n’aura connu, à « l’âge d’homme », que la démocratie politique et le libéralisme économique (autrement dit « l’après-révolution ») mais sans en être véritablement l’acteur ; tout au plus le spectateur.
On me rétorquera (en tout premier lieu mes amis ivoiriens) qu’il vaut mieux être spectateur d’une « émergence » (aussi limitée soit-elle) que d’une désintégration politique, économique, sociale, ethnique. Sauf qu’il faut que le système « vive » pour évoluer et que, aujourd’hui, il semble figé. C’est le résultat de l’évolution qui a été imprimée à la société burkinabè à la suite des errements et dérives de la « révolution » (cette « rectification », pas évidente, est à mettre à l’actif des équipes qui ont, avec Compaoré, métamorphosé le pays) ; c’est aussi une résultante de l’évolution de la sous-région : les relations extérieures, dans un contexte diplomatique d’autant plus difficile qu’il avait des implications économiques et sociales graves, sont devenues la variable d’ajustement de la société burkinabè. Non sans effets induits, positifs et négatifs. Ouverture sur l’extérieur, visibilité continentale et internationale, primauté dans les relations Nord-Sud, diversification des partenaires, etc. Mais, aussi, de plus en plus d’ambitions alors que le pays ne dispose guère de plus de moyens.
D’où des frustrations de plus en plus notables et des fractures de plus en plus irréparables. Les campagnes par rapport aux villes ; les enfants par rapport aux parents ; le monde réel par rapport au monde virtuel. Les étudiants, cellulaire dans une main, ordinateur portable dans l’autre, sont en connexion, via internet, avec les problématiques du monde entier ; jusqu’au moment où ils reviennent à la maison, dans des quartiers sans eau potable, sans électricité, sans « goudron », sans services publics de transport, etc. Et, à la limite, sans perspective d’avenir.
Le Burkina Faso a une technostructure plutôt efficace et performante. Mais c’est une démocratie qui n’est, véritablement, ni participative ni représentative ; c’est une démocratie « confisquée » où une élite sait ce qu’elle doit faire et le fait plutôt bien mais sans toujours prendre conscience que la structure, quant à elle, a aussi… conscience de ce qu’elle veut faire et de ce qu’elle peut faire, qui voit Ouaga 2000 illustrer l’évolution du pays quand Ouagadougou a trop souvent les pieds dans la boue, qui s’agace de la montée en puissance de personnalités ou de groupes sociaux qui sont, eux, dans les « bons réseaux » d’influence (et, parfois même, de mauvaise influence).
Plutôt socialement homogène par le passé, le Burkina Faso tend à devenir hétérogène. C’est l’expression de son évolution historique. Mais cette évolution doit pouvoir s’exprimer dans des institutions démocratiques représentatives et/ou participatives. Or, l’évolution politique du pays tend à laisser penser que le bonheur d’un peuple est dans « l’émergence » alors que ce peuple souhaite, semble-t-il, la prise en compte de sa « différence » ; pas de son indifférence.
Jean-pierre BEJOT
La Dépêche Diplomatique



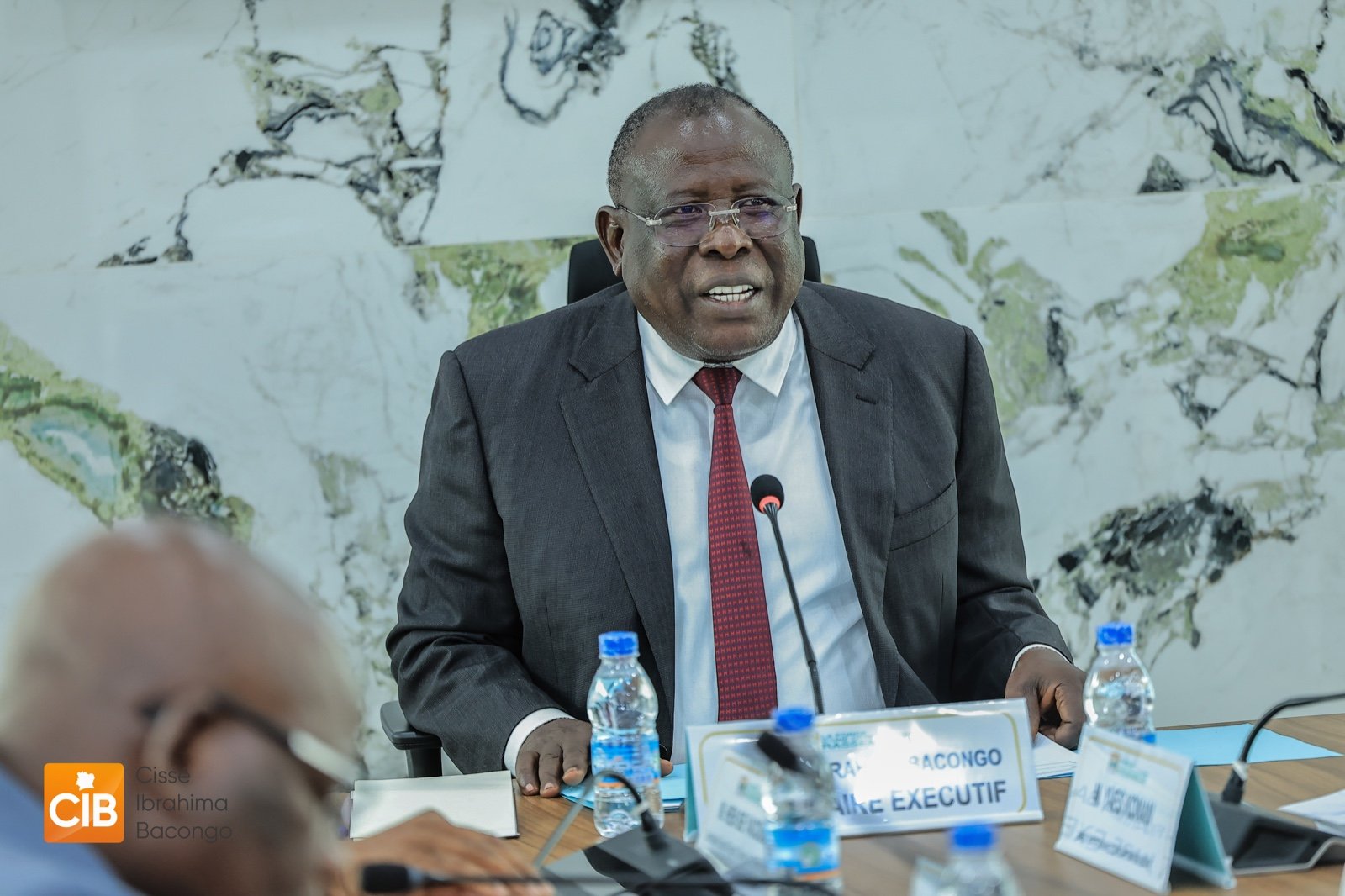



Commentaires Facebook